Neocor Therapeutics change le paysage de la thérapie cardiaque
Neocor Therapeutics obtient 370 000 € d'i-Lab 2025 pour révolutionner la thérapie génique des maladies cardiaques.
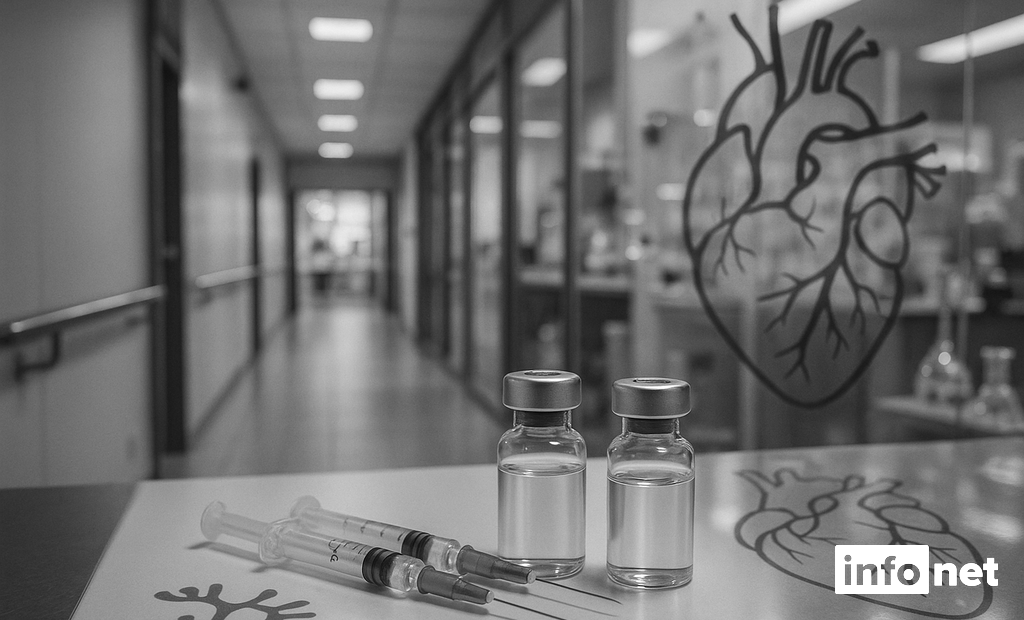
À Marseille, Neocor Therapeutics s’installe dans le radar des investisseurs et des industriels de la santé. Lauréate du concours i-Lab 2025, la jeune pousse issue de travaux académiques franchit un palier stratégique avec une subvention de 370 000 euros, de quoi accélérer un programme de thérapie génique adressant des pathologies cardiaques graves. Le signal est clair pour l’écosystème: la médecine régénérative cardiaque gagne en crédibilité industrielle.
Neocor Therapeutics lauréate d’i-Lab 2025 : cap franchi pour la thérapie génique cardiaque
Le concours i-Lab 2025 distingue Neocor Therapeutics parmi les projets les plus prometteurs de la deeptech française. L’appui financier, confirmé à 370 000 euros au bénéfice de la société, valide une ambition rare dans le traitement des maladies cardiovasculaires: changer de paradigme, du palliatif vers le curatif.
Au cœur du projet, une thérapie génique par injection intraveineuse unique destinée à restaurer la fonction cardiaque après des atteintes sévères, notamment l’infarctus du myocarde et la cardiomyopathie dilatée d’origine génétique. La promesse tient en deux mots: réparation durable. L’approche, développée à partir d’un socle académique marseillais, s’appuie sur une technologie protégée par brevet, décrite par Neocor et son réseau comme visant à prévenir et traiter des dysfonctionnements cardiaques avec un effet régénératif.
L’entreprise assume une position de rupture: là où les traitements actuels ralentissent la décompensation, elle vise la régénération du myocarde. Des données précliniques issues de la recherche locale soutiennent ce positionnement et justifient l’entrée dans une phase d’industrialisation accélérée. Dans l’optique d’i-Lab, l’enjeu est double: convertir une promesse scientifique en actif clinique évalué et structurer une chaîne de valeur biopharmaceutique en France.
Ce que finance i-Lab chez Neocor
Les usages annoncés de la subvention s’articulent autour de la préparation à l’industrialisation et au passage clinique.
- Montée en échelle des procédés de production en vue d’une diffusion clinique à partir de 2026.
- Optimisation pharmaceutique de la formulation injectable pour renforcer sécurité et efficacité.
- Structuration réglementaire en amont d’une première étude chez l’humain programmée pour 2027.
Eurobiomed : effet réseau et ancrage marseillais
Neocor appartient à la communauté Eurobiomed, qui rassemble les acteurs santé du Sud. Le cluster a annoncé sept lauréats i-Lab 2025 issus de son écosystème, confirmant la densité d’innovations en biotechnologies dans la région. Pour Neocor, cet ancrage offre un accès à des compétences, des infrastructures et des partenariats académiques clés à Marseille, levier utile pour accélérer la translation vers l’essai clinique.
France 2030 et i-Lab : capillarité des financements publics dans la biotech
Le plan France 2030, doté de 54 milliards d’euros, cible explicitement la santé et les biotechnologies. i-Lab en est l’un des instruments phares, piloté par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec un objectif clair: faire émerger des technologies de rupture et les amener jusqu’au marché. La trajectoire de Neocor illustre ce continuum, du laboratoire à l’entreprise, puis de l’entreprise au patient.
Au-delà des subventions individuelles, France 2030 finance des plateformes structurantes. Le programme national autour des organes et organoïdes sur puces, piloté par le CEA, le CNRS et l’Inserm, en est une manifestation.
Il est doté de 48,4 millions d’euros sur six ans, avec une mise en avant gouvernementale en date du 4 juillet 2025 (info.gouv.fr, 4 juillet 2025). Pour des sociétés comme Neocor, ces investissements amont évitent des goulets d’étranglement méthodologiques au moment de la qualification préclinique.
CEA, CNRS et Inserm : un continuum recherche-industrie
L’architecture France 2030 favorise la coopération entre instituts publics et jeunes pousses. Dans le cas de Neocor, l’adossement à une recherche académique marseillaise et l’ouverture vers des outils nationaux structurants accroissent la probabilité d’un dossier expérimental robuste. Le bénéfice attendu est direct: accélérer le de-risking préclinique, fiabiliser les choix technologiques et soutenir le passage à l’échelle des procédés tout en maîtrisant la qualité.
i-Lab cible des projets technologiques à fort potentiel. Les lauréats bénéficient d’un financement non dilutif et d’un accompagnement qui catalysent des étapes clés: consolidation de la propriété intellectuelle, recrutement d’experts réglementaires, et structuration d’un plan d’industrialisation. En santé, ce soutien est particulièrement déterminant pour financer les études précliniques exigées avant toute soumission à l’ANSM.
Thérapie génique par injection unique : le pari clinique de Neocor
La proposition de Neocor se démarque par sa simplicité d’administration et son ambition clinique. Une injection intraveineuse unique doit suffire pour délivrer le matériel génétique thérapeutique aux cardiomyocytes ciblés. Le mode d’action vise la régénération fonctionnelle du tissu cardiaque endommagé, pilier d’une stratégie curative.
Cette approche s’adresse à deux terrains cliniques majeurs. D’abord, l’infarctus du myocarde, première cause d’hospitalisation cardiaque, qui touche environ 80 000 personnes chaque année en France (Santé publique France).
Ensuite, la cardiomyopathie dilatée, souvent d’origine génétique, avec une prévalence d’environ 1 personne sur 2 500. Dans les deux cas, la standardisation actuelle des soins s’appuie sur des médicaments et dispositifs qui gèrent les symptômes et prolongent la survie, sans restaurer pleinement la fonction contractile.
Les données précliniques issues de la recherche marseillaise évoquent un potentiel de réparation tissulaire, un jalon critique avant la phase I. L’hypothèse clinique est claire: en évitant la chronicisation des symptômes, une stratégie de régénération pourrait réduire les coûts médicaux indirects et réhospitalisations. Seuls les essais chez l’humain permettront d’en apprécier la réalité thérapeutique et économique.
Infarctus et cardiomyopathies : le fardeau en France
En cardiologie, la charge de morbidité et l’empreinte économique restent élevées. Les infarctus récurrents, la progression vers l’insuffisance cardiaque et la nécessité d’implants ou d’assistances mécaniques pèsent lourd sur les chaînes de soins. Une thérapie disruptive, si elle confirme sa durabilité d’effet, pourrait infléchir cette trajectoire en réduisant les hospitalisations et la dépendance aux dispositifs invasifs.
Définitions clés pour suivre le dossier Neocor
- Thérapie génique : administration d’un matériel génétique pour corriger ou compenser un dysfonctionnement cellulaire.
- Injection intraveineuse : voie d’administration dans la circulation sanguine, choisie pour maximiser la distribution systémique.
- Régénération cardiaque : restauration de la structure et de la fonction du myocarde après lésion.
Calendrier de développement : industrialisation et essai clinique
Neocor annonce deux jalons. D’abord, une montée en capacité industrielle en 2026, centrée sur l’optimisation des procédés pour une injection sûre et efficace. Ensuite, un premier essai clinique en 2027, étape déterminante pour établir un début de preuve d’efficacité et de sécurité chez l’humain.
Ces échéances s’inscrivent dans la promesse d’i-Lab: accélérer le passage de la préclinique à l’évaluation clinique. L’enjeu, pour l’entreprise comme pour l’écosystème, est de sécuriser la chaîne opérations-réglementaire, en consolidant la qualité pharmaceutique, la reproductibilité et la traçabilité du produit expérimental.
Eurobiomed et Neocor : point d’étape confirmé au 29 juillet 2025
La fiche de Neocor publiée par Eurobiomed et mise à jour le 29 juillet 2025 confirme le positionnement de l’entreprise, sa technologie brevetée et son ancrage thérapeutique. Le cluster souligne la vocation curative de la solution et l’objectif d’adresser des dysfonctionnements cardiaques majeurs. Cette consolidation publique d’informations favorise la lisibilité du dossier auprès des partenaires industriels et institutionnels.
- Production en qualité pharmaceutique avec validation de procédés et contrôles qualité renforcés.
- Dossiers non cliniques comprenant pharmacologie et toxicologie sur modèles pertinents.
- Saisie réglementaire auprès de l’ANSM et d’un comité d’éthique, en conformité avec le cadre MTI/ATMP.
- Design d’essai prudent, phasé, privilégiant la sécurité et des critères précoces de fonction cardiaque.
Gouvernance de l’innovation : cadre réglementaire et propriété intellectuelle
Les thérapies géniques relèvent en Europe des médicaments de thérapie innovante et impliquent un dialogue étroit avec l’ANSM et l’EMA. Pour Neocor, l’alignement précoce sur ces exigences sera déterminant. Il s’agit d’articuler exigences de sécurité, démonstration de bénéfice clinique et qualité de fabrication, tout en planifiant la montée à l’échelle.
Sur la propriété intellectuelle, la technologie décrite comme brevetée confère un avantage concurrentiel initial. La discipline consistera à étendre et défendre ce socle face à l’évolution des standards, en combinant brevets, secrets de fabrication et données cliniques exclusives. Un verrouillage IP efficace est souvent un prérequis à la signature de partenariats industriels et à l’attrait d’investissements de croissance.
ANSM et EMA : jalons réglementaires à anticiper
Pour un produit de thérapie génique, la trajectoire de développement doit intégrer les avis préalables et réunions scientifiques. Les exigences portent sur la caractérisation du vecteur, la maîtrise du procédé, la biosécurité et la surveillance post-administration. Chaque étape conditionne la suivante, ce qui justifie l’usage de subventions i-Lab pour crédibiliser un plan de développement phasé et documenté.
Propriété intellectuelle en biotech : points de vigilance
- Périmètre des revendications : couvrir méthodologie, vecteurs, cibles et usages thérapeutiques.
- Liberté d’exploitation : cartographier les brevets tiers pour limiter le risque contentieux.
- Données cliniques : les résultats d’essais renforcent la valeur IP et la position de négociation.
Effets attendus pour la filière santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le succès de Neocor pourrait stimuler un effet d’entraînement dans la région. L’industrialisation de thérapies avancées nécessite des compétences diversifiées: bioproduction, contrôle qualité, affaires réglementaires, essais cliniques. La Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’atouts avec ses plateformes techniques et son tissu de laboratoires, atouts dont Eurobiomed fait un vecteur de coopération entre académiques et industriels.
Au plan économique, une technologie à visée curative repositionne la France sur la carte des thérapies avancées. Si l’essai de 2027 confirme les attentes, l’attractivité pour des co-développements ou des licences pourrait s’en trouver renforcée, avec à la clé des investissements complémentaires et des emplois qualifiés. La subvention i-Lab tient ici le rôle d’amorçage pour franchir les barrières initiales de coût et de risque.
Nuevocor : stratégie et résultats
À titre de comparaison sectorielle, la société Nuevocor a annoncé en mai 2025 la clôture d’un tour de 45 millions de dollars pour le développement clinique d’une thérapie centrée sur la mécanobiologie de la cardiomyopathie. L’exemple illustre l’appétit des investisseurs pour des programmes cardiaques de rupture et souligne l’intérêt d’un capital non dilutif initial pour atteindre des jalons cliniques décisifs avant d’envisager des tours de croissance.
France 2030 alloue des moyens stratégiques aux biotechnologies et à la santé, avec un objectif d’impact de long terme. Deux repères saillants pour ce dossier:
- 54 milliards d’euros de dotation globale au plan.
- 48,4 millions d’euros sur six ans pour le programme national organes et organoïdes sur puces soutenu par le CEA, le CNRS et l’Inserm.
Ces dispositifs créent un environnement propice à la maturation technologique et à la dé-risquisation avant l’entrée en clinique.
Qui est Neocor Therapeutics : de l’idée au candidat clinique
Neocor est née des laboratoires marseillais, avec un positionnement précis: des solutions curatives pour réparer une fonction cardiaque dégradée, et non seulement freiner la progression de la maladie. Son programme phare vise une administration unique, calibrée pour des pathologies où l’échec myocardique est la pente naturelle en l’absence de greffe ou d’assistance durable.
Le rôle d’i-Lab est ici structurant. Par le financement, mais aussi parce qu’il crédibilise un plan d’exécution auprès des partenaires cliniques, des sous-traitants de bioproduction et des autorités. Comprendre la valeur temps est crucial: chaque mois gagné entre la préclinique et le premier patient exposé peut optimiser l’architecture de financement ultérieure et la protection intellectuelle.
L’écho sectoriel de l’annonce i-Lab 2025
- Validation par les pairs d’une approche de régénération cardiaque portée par une start-up française.
- Signal aux investisseurs en vue d’un tour de financement futur une fois le protocole d’essai prêt.
- Renforcement régional du pôle marseillais en biotechnologies appliquées au cardiovasculaire.
Ce que la trajectoire de Neocor dit de la biotech française
L’obtention d’i-Lab 2025 place Neocor sur une trajectoire lisible: montée en échelle en 2026, première évaluation clinique en 2027. Pour la filière, l’enjeu dépasse le seul projet. Il s’agit de démontrer que la combinaison recherche publique, financement non dilutif et ancrage régional peut faire émerger des candidats thérapeutiques de niveau international sur des indications à forte charge médicale.
Si les résultats cliniques confirment les indices précliniques, la France marquerait des points sur le segment exigeant des thérapies géniques cardiologiques. En attendant, l’annonce i-Lab envoie un message simple aux acteurs du marché: la régénération cardiaque se joue aussi ici.
Infonet.fr continuera de suivre le dossier Neocor Therapeutics au fil des jalons techniques, réglementaires et financiers.