L'Union européenne débloque 140 milliards € pour soutenir l'Ukraine
Découvrez le mécanisme de prêt de 140 milliards € à l’Ukraine, ses implications juridiques et ses impacts économiques sur l’UE.
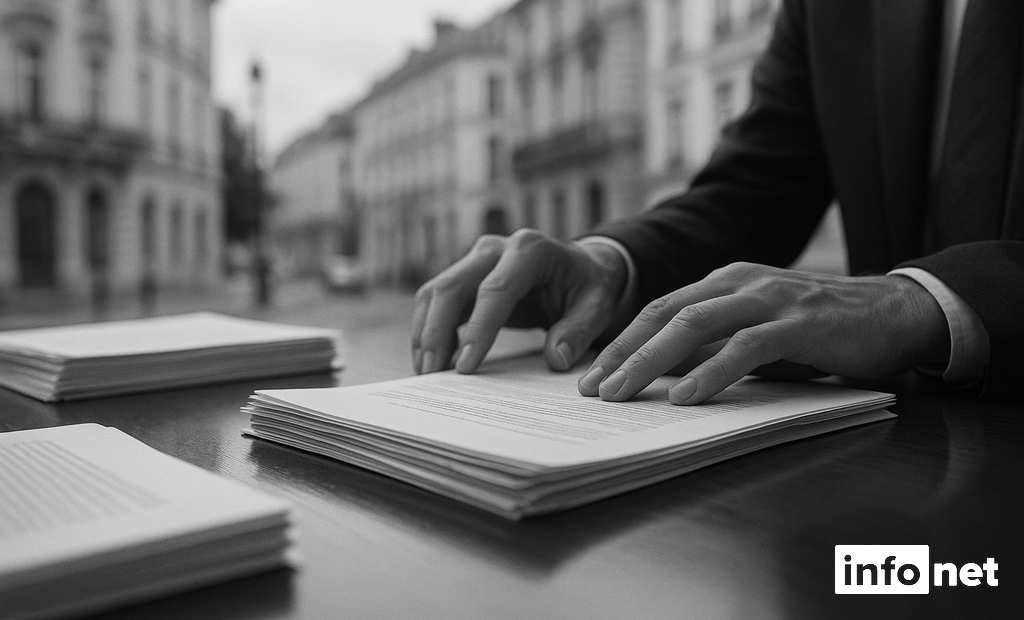
140 milliards d’euros sur la table et un montage inédit adossé à des avoirs russes gelés : à Copenhague, le 1er octobre 2025, la proposition portée par Friedrich Merz a fait entrer l’Union européenne dans un débat autant financier que juridique. Derrière l’urgence ukrainienne, c’est l’architecture budgétaire et légale européenne qui est testée.
Un mécanisme de 140 milliards d’euros adossé aux avoirs russes
Le cœur du projet consiste en un prêt de 140 milliards d’euros à l’Ukraine, garanti par des actifs russes immobilisés dans l’UE, évalués à environ 210 milliards d’euros. La pièce maîtresse se situe en Belgique : Euroclear conserverait près de 183 milliards d’euros de ces avoirs. La proposition s’inspire du précédent du G7 en 2024, qui a mobilisé un financement de 50 milliards de dollars sur la base des intérêts générés par les mêmes actifs.
Structurant pour les équilibres européens, le montage repose sur une séparation stricte entre propriété des actifs et usage des revenus associés. Les États membres apporteraient une couche de garanties budgétaires complémentaires. L’objectif est double : apporter une réponse financière d’ampleur à l’Ukraine et alléger le coût immédiat pour les finances publiques nationales.
Chiffres clés du montage
Repères pour mesurer l’impact et l’ordre de grandeur du projet.
- Montant du prêt : 140 milliards d’euros.
- Avoirs russes gelés : environ 210 milliards d’euros, dont 183 milliards d’euros chez Euroclear.
- Intérêts captés : 4,4 milliards d’euros rapportés en 2024 par Euroclear sur ces avoirs.
- Effet macro : environ 0,8 % du PIB de l’UE et près de 90 % du PIB ukrainien.
Le prêt serait sans intérêt, avec un début de remboursement conditionné à l’indemnisation de l’Ukraine par la Russie. Autrement dit, l’effort financier côté Kiev ne s’activerait qu’en présence de réparations.
Côté Européens, les décaissements interviendraient par tranches, sous contrôle renforcé et avec une destination limitée à l’acquisition d’équipements militaires. L’enjeu est explicite : soutenir l’effort ukrainien tout en dynamisant la base industrielle et technologique de défense européenne.
Pour contenir les risques, la proposition prévoit la création d’un véhicule ad hoc (SPV) chargé de gérer les flux de trésorerie issus des intérêts des actifs, ainsi que la remise à Euroclear d’obligations zéro coupon assorties de garanties publiques. Une bascule vers une garantie UE est évoquée à partir de 2028, dans le cadre financier pluriannuel.
La confiscation d’actifs souverains pose un problème de droit international public. En revanche, capter les intérêts produits par des actifs gelés et s’en servir comme garantie relève d’un terrain juridique moins balisé mais discuté.
L’UE a déjà autorisé la taxation et la mobilisation de certains rendements pour l’Ukraine. Le prêt à grande échelle adossé à ces revenus constituerait toutefois une montée en gamme, ouvrant la voie à des contestations.
Rapport de forces politique : soutiens, réserves et oppositions
L’accueil a été contrasté au sein du Conseil européen. La Commission européenne ainsi que des États membres comme la Finlande, la Suède et le Danemark y voient une voie crédible pour garantir la continuité de l’aide.
La France et le Luxembourg affichent des réserves juridiques sur la robustesse du schéma. La Belgique et la Hongrie s’y opposent plus nettement.
Belgique et Euroclear : sensibilité financière
La Belgique héberge Euroclear, pivot technique du dispositif. Bruxelles redoute des risques opérationnels et réputationnels si le régime juridique venait à être contesté. La perspective d’actions en justice pourrait mobiliser des ressources publiques belges et impacter la place financière locale, un point de crispation majeur.
France : prudence juridique
Paris ne se prononce pas contre l’objectif, mais insiste sur la sécurisation légale du montage. En France, un décret de mars 2025 a déjà entériné un accord de don à l’Ukraine, signe d’un engagement durable, mais la généralisation à un prêt massif adossé à des actifs d’un État tiers appelle des garanties juridiques et budgétaires supplémentaires.
Hongrie : souveraineté et relation bilatérale
Budapest invoque des considérations de souveraineté et de relations avec la Russie. La Hongrie s’inscrit dans une ligne de prudence stratégique et cherche à contenir tout dispositif perçu comme escalatoire.
La majorité qualifiée requiert 15 États représentant 65 % de la population de l’UE. Ni la Belgique ni la Hongrie ne disposent seules d’une minorité de blocage.
Toutefois, les traités excluent la majorité qualifiée pour des domaines comme la politique étrangère, la défense ou les ressources propres. Activer les clauses passerelles exige l’unanimité, d’où le débat juridique sur le bon fondement procédural.
Risques juridiques et financiers : zones de vigilance
Le principe de non-confiscation des actifs souverains demeure une ligne de force du droit international. Utiliser des actifs gelés temporairement comme collatéral pour un prêt de très long terme ouvre un front contentieux probable. La Russie pourrait engager des actions devant plusieurs juridictions, contestation qui serait susceptible de durer des années.
Sur le plan financier, le point critique réside dans un défaut de remboursement des réparations par la Russie. Dans ce scénario, le fardeau se reporterait sur les États garants.
D’où la création envisagée d’un SPV pour isoler les flux, assimiler les intérêts des actifs et remettre à Euroclear des instruments zéro coupon portant la garantie publique. À l’horizon 2028, une garantie portée au niveau UE est évoquée, ce qui suppose un ancrage clair dans le cadre financier pluriannuel.
Points de vigilance pour les acteurs français
Les entreprises et établissements financiers doivent se préparer à plusieurs implications si le projet avance.
- Exposition réglementaire : conformité aux embargos, traçabilité des flux liés aux actifs gelés.
- Comptabilisation : traitement prudentiel des garanties publiques et des instruments adossés au SPV.
- Assurances et litiges : provisionnement pour risques juridiques en cas de contestations prolongées.
- Relations bancaires : procédures KYC renforcées sur les chaînes de paiement liées aux décaissements.
Pour mémoire, Euroclear a déclaré environ 4,4 milliards d’euros d’intérêts en 2024 sur les actifs russes immobilisés. Ces revenus constituent le principal socle financier du SPV envisagé et un indicateur de la capacité de service du montage. À ce stade, les autorités européennes évoquent un schéma qui ne suppose pas d’appui supplémentaire du G7, selon des propos attribués à la Commission européenne et rapportés par la presse économique internationale.
Les fonds seraient libérés par étapes, selon des jalons d’exécution et de conformité. L’usage admissible serait restreint à l’équipement militaire, avec une supervision communautaire. Dans ce cadre, la mise en place de procédures d’achat coordonnées au niveau européen est un levier attendu pour agréger la demande et sécuriser les délais de production.
Conséquences industrielles : commandes ciblées et montée en capacité
La restriction d’usage aux équipements militaires ancre ce prêt dans une logique de réarmement capacitaire. L’objectif affiché est la stimulation de l’industrie de défense européenne et la consolidation de chaînes de valeur paneuropéennes. Ce levier comporte un effet de demande immédiat, mais aussi un effet signal pour les investissements industriels.
Si l’Ukraine obtient un accès pluriannuel à des lignes de financement pour des achats européens, la coordination des commandes peut accélérer la standardisation et la mutualisation des plateformes. Les États baltes, nordiques et d’Europe centrale, très engagés sur l’Ukraine, pousseraient dans ce sens. La Suède et la Finlande, désormais membres de l’OTAN, figurent parmi les partisans d’un soutien renforcé.
Thales : électronique de défense et systèmes de communication
Dans un scénario d’achats coordonnés, les segments capteurs, communications sécurisées, guerre électronique et missiles pourraient connaître une demande accrue. Pour un groupe comme Thales, l’enjeu serait d’abord la capacité de production et l’approvisionnement en composants critiques. Une planification sur plusieurs années aiderait à sécuriser la chaîne d’approvisionnement, un point sensible depuis la recomposition des flux industriels post-2022.
Dassault Aviation : effets indirects sur la base industrielle
Si l’Ukraine priorise les équipements terrestres, drones, munitions et systèmes C4ISR, les effets d’entrainement pourraient toucher des acteurs aéronautiques via la montée en charge des écosystèmes de sous-traitance, la MCO et les capacités d’essais. Pour Dassault Aviation, il s’agirait davantage d’un effet de diffusion sur la filière que d’un flux direct, l’articulation exacte dépendant des listes d’équipements éligibles et des choix d’achats.
Au-delà des champions, le maillage de PME et ETI de la défense pourrait bénéficier des effets de série, sous réserve de calendriers d’engagements de commandes clairs. Le rapport bénéfice-risque pour les industriels dépendra de la vitesse d’exécution du dispositif et de la stabilité de la gouvernance financière.
Lecture macroéconomique : faible choc à court terme, pari industriel à moyen terme
Le calibrage annoncé équivaut à environ 0,8 % du PIB de l’UE et près de 90 % du PIB de l’Ukraine. L’impact macro à court terme serait limité par un étalement pluriannuel des décaissements, tandis que l’UE escompte un retour via la relance du secteur défense et l’intégration des chaînes d’approvisionnement. Les flux seraient pilotés par un dispositif budgétaire qui, dans la mesure du possible, éviterait des déconsolidations risquées pour les dettes nationales.
Ce schéma prolonge le mouvement pointé par la presse économique sur un financement de la défense qui progresse par paliers, avec des arbitrages complexes sur les règles budgétaires européennes. Il fait également écho à la sécurité des voyageurs et à la dimension diplomatique rappelées par les autorités françaises dans leurs communications publiques sur l’Ukraine. La capacité réelle d’absorption par l’industrie européenne demeure un point limite bien identifié.
À noter : en 2024, le G7 a validé un mécanisme de financement sur intérêts d’actifs gelés, sans usage restriction radicale, un précédent qui inspire ce projet. Une évaluation technique a été engagée au niveau de la Commission européenne et une discussion politique est programmée lors du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2025 (Le Monde, 30 septembre 2025).
Cadre d’adoption et contentieux possibles
Sur le plan institutionnel, la question centrale demeure le fondement juridique de l’acte européen autorisant ce montage. Plusieurs voies sont débattues pour limiter l’exigence d’unanimité, l’idée d’une approbation à majorité qualifiée circulant parmi certains partisans. Cette interprétation se heurte toutefois aux limites sectorielles des traités sur la PESC et les ressources propres.
D’un point de vue procédural, la Belgique et la Hongrie ne disposent pas, à elles seules, d’une minorité de blocage. Néanmoins, la sensibilité politique de l’objet, le rôle d’Euroclear et la juridicité du mécanisme poussent plusieurs capitales à demander des assurances renforcées. Le débat pourrait également être judiciarisé en cas d’adoption rapide, avec des recours internes et externes qui pèseraient sur la mise en œuvre.
Sur le volet communication, l’idée que l’UE ne dépendrait pas des autres membres du G7 pour la viabilité financière du montage est portée dans l’espace public, la Commission étant citée par les médias internationaux. Il ne s’agit pas encore d’une position juridiquement encadrée par un acte adopté, mais d’un signal politique sur l’autonomie financière européenne.
Trois sujets concentrent l’attention : 1 la compatibilité avec la protection de la propriété publique étrangère, 2 la durée entre gel administratif et obligations financières de très long terme, 3 l’articulation avec les règles de vote des traités et les clauses passerelles. Des contentieux sont dès lors crédibles, ce qui plaide pour une rédaction précise des actes et une documentation complète des risques.
Ce que guetteront les entreprises françaises d’ici au Conseil européen
À court terme, l’attention se portera sur trois fronts : la clarté juridique du texte proposé, la granularité des listes d’équipements éligibles et la trajectoire des garanties publiques, nationales puis possiblement européennes. Les acteurs industriels chercheront des contrats fermes et un calendrier d’engagement qui justifient des investissements d’extension capacitaire.
Côté financier, la capacité de l’UE à structurer un SPV robuste, à sécuriser les flux d’intérêts et à encadrer les risques litigieux sera déterminante. Pour les entreprises françaises, l’opportunité est réelle si le cadre est prévisible et exécutable. À défaut, l’aléa juridique pourrait diluer l’effet industriel attendu et retarder des décisions d’investissement clé.
Le rendez-vous du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2025 dira si l’UE franchit un cap financier et juridique inédit au service de l’Ukraine et de sa propre base industrielle.