Baisse de 35% des levées de fonds de la French Tech au premier semestre 2025
Au premier semestre 2025, les start-up françaises ont levé 2,78 milliards d’euros, soit -35 % sur un an, face à la concurrence allemande et britannique.
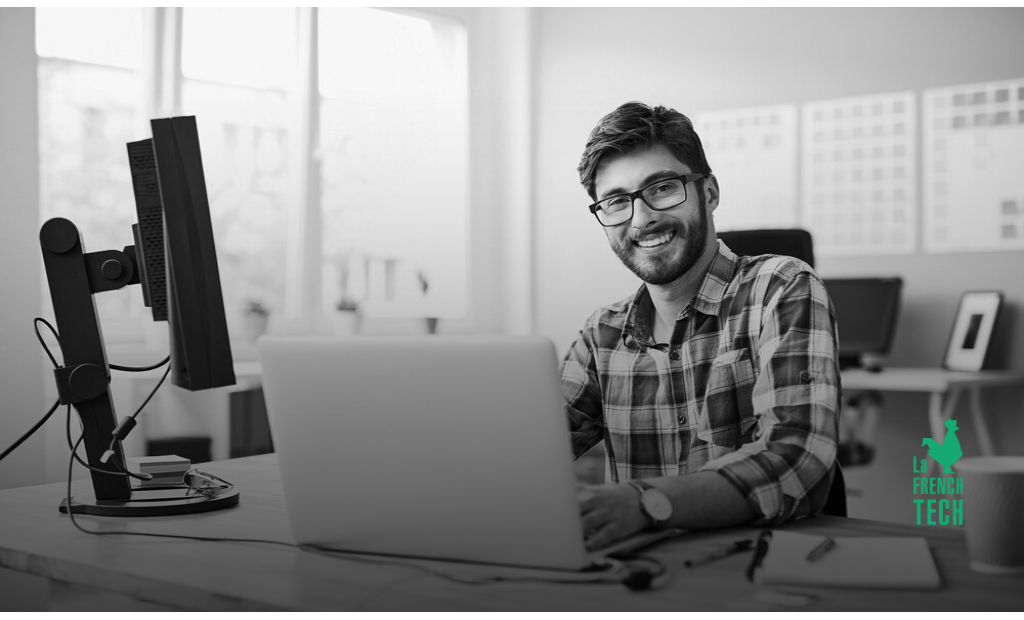
La jeune scène numérique française, longtemps portée par un enthousiasme débordant, enregistre aujourd’hui un recul qui fait grand bruit dans le milieu de l’investissement.
D’un côté, les start-up hexagonales peinent à lever des capitaux.
De l’autre, les écosystèmes voisins en Europe maintiennent, voire renforcent, leur niveau d’attractivité.
Cette conjoncture porte un coup sérieux aux ambitions de la French Tech.
La place de deuxième écosystème européen s’effrite
L’élan qui avait propulsé la French Tech au rang de deuxième écosystème européen de capital-risque appartient désormais au passé. D’après le baromètre EY, les start-up françaises n’ont récolté que 2,78 milliards d’euros au cours du premier semestre 2025, marquant une baisse estimée à 35 % par rapport à la même période en 2024. L’Allemagne, en comparaison, enregistre 3,6 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année, n’ayant perdu que 2 % en valeur sur un an, tandis que le Royaume-Uni consolide son leadership avec 7,4 milliards d’euros levés.
Ce basculement ne surprend pas totalement. Selon plusieurs experts, la France montrait déjà quelques signes de faiblesse à partir de la fin 2023, dans un contexte où l’inflation et le resserrement monétaire ont découragé les financeurs à prendre des risques. Bien que le pays demeure attractif pour certains secteurs de pointe, la configuration actuelle met en évidence un trou d’air durable dans le financement des jeunes pousses tricolores.
L’ancien record en 2022
En 2022, les start-up françaises avaient franchi un seuil historique avec 13,49 milliards d’euros levés sur l’année, illustrant un véritable âge d’or pour la French Tech. Deux ans plus tard, la donne a bien changé, tout comme l’environnement macroéconomique et politique.
Outre la moindre disponibilité de capitaux, la France se heurte à une concurrence de plus en plus vive. Tandis que l’Allemagne profite d’une certaine stabilité politique et d’une spécialisation forte dans les secteurs de la défense et de l’industrie 4.0, le Royaume-Uni demeure imbattable dans la Fintech et le logiciel de haute performance. En dépit d’un passé proche fort de succès, l’Hexagone doit donc composer avec une dynamique européenne moins à son avantage.
Retour sur une année 2025 mal engagée
Dès le début 2025, plusieurs signaux d’alarme avaient émergé. La fin de l’argent bon marché, enclenchée dès 2022 avec la hausse générale des taux d’intérêt, s’est renforcée au fil des trimestres, impactant toutes les étapes de financement. Les grands investisseurs institutionnels, plus sélectifs, concentrent depuis lors leurs efforts sur un nombre réduit de projets. Les fonds de capital-risque, pour leur part, ajustent leurs stratégies afin de limiter les risques, ce qui limite le volume des tickets accordés.
L’instabilité entourant la gouvernance politique française a également pesé sur le moral des investisseurs. La dissolution de l’Assemblée nationale en milieu d’année 2024, suivie par plusieurs mois d’imbroglio institutionnel, a contribué à diminuer la visibilité sur les orientations gouvernementales. Résultat : un attentisme marqué et une aversion amplifiée pour les placements risqués.
Fin 2022 : hausse notable des taux d’intérêt.
2023 : premiers signes de repli avec un climat géopolitique sous tension.
2024 : dissolution de l’Assemblée nationale, situation politique mouvante.
2025 : accélération de la baisse des investissements, -35 % sur les levées.
Dans le même temps, des mégas levées de fonds qui avaient auparavant permis à la France de rivaliser avec ses voisins, comme celles observées en 2022 et 2023, se sont raréfiées. Au premier semestre 2025, seuls deux tours de table ont dépassé 100 millions d’euros : l’un réalisé par la fintech Knave, l’autre par le spécialiste du quantique Alice & Bob. L’année précédente, on dénombrait pourtant sept opérations de cet acabit sur la même période. Cet élément renforce la sensation que la French Tech n’arrive plus à attirer d’importantes enveloppes financières, handicapant sa progression.
Quand l’intelligence artificielle devient un atout stratégique
Au milieu d’un paysage morose, l’intelligence artificielle (IA) apparaît comme l’une des rares éclaircies. Selon divers rapports, ce segment figure parmi les plus soutenus en 2025, tirant une partie de son élan du plan massif d’investissement de 109 milliards de dollars annoncé en début d’année par Emmanuel Macron. Bien que, dans les rapports traditionnels, l’IA ne soit pas strictement catégorisée comme un secteur en soi, de nombreuses solutions logicielles qui en dépendent se hissent en haut des classements.
Le logiciel au sens large, dopé par l’adoption de l’IA, a réussi à capter 891 millions d’euros au premier semestre 2025, malgré une baisse de 39 % par rapport à l’an dernier. Cette capacité de l’intelligence artificielle à soutenir l’innovation est perçue comme un facteur de résilience, alors que d’autres domaines, comme les greentech, voient leurs capitaux chuter davantage.
Du jeu en ligne à la défense
En Europe, de grands noms concentrent les regards : l’Allemand Helsing (défense) avec 600 millions d’euros, Isomorphic Labs (santé, spin-off de Google) au Royaume-Uni avec 545 millions, ou encore GeoGuessr en Suède, qui a levé plus de 460 millions. Aucun mastodonte français ne figure dans les dix opérations les plus importantes de ce début d’année.
Pour autant, certains observateurs soulignent qu’il ne s’agit pas uniquement de signer des très gros tours de table, mais plutôt d’encourager la création d’une constellation de pépites technologiques de taille intermédiaire. Les experts estiment qu’une série de tours significativement élevés, mais moins concentrés sur une poignée d’acteurs, pourrait exercer un effet d’entraînement. Dans ce scénario, la French Tech miserait sur un tissu entrepreneurial diversifié, notamment dans les segments de l’IA appliquée, du quantique et de la cybersécurité.
Fintech, Greentech : trajectoires contrastées
En dehors du logiciel, la fintech se maintient à un niveau convenable, en enregistrant même une hausse surprenante de 53 % sur un an. Cette performance provient principalement de la maturité accrue du secteur, ainsi que de la forte demande pour des solutions de paiement, de gestion financière et de crypto-actifs. À titre d’exemple, Knave, spécialisée dans l’optimisation de transactions numériques, a réuni 100 millions d’euros, confortant l’idée que les innovations pratiques ont toujours leur place.
À l’opposé, les greentech subissent une véritable cure d’amaigrissement. Après avoir connu une flambée notable à partir de 2020, notamment pour des initiatives s’attaquant à la décarbonation et à l’énergie propre, elles ont levé tout juste 515 millions d’euros au premier semestre 2025, soit une chute de 53 % par rapport à la même période de 2024. Les investisseurs mettent en avant la longueur des cycles de rentabilité et l’absence d’une visibilité immédiate sur les retours, dans une période où le climat économique reste réjoui à la prudence.
Malgré la baisse notable des montants injectés, certains projets greentech résistent. La réduction rapide des émissions de carbone, la détection des fuites d’eau ou encore le stockage d’énergie restent des créneaux porteurs de sens. Toutefois, la volatilité des marchés empêche souvent ces sociétés de sécuriser leur croissance à court ou moyen terme.
La « décélération brutale » constatée en 2025 n’obère cependant pas totalement l’avenir. La société française conserve des avantages structurels dont un vivier de chercheurs reconnus et une expertise scientifique de pointe, soutenus par des politiques publiques incitatives. En capitalisant sur l’IA, la quantique et la fintech, la French Tech pourrait bientôt reprendre des couleurs, à condition d’endiguer une certaine instabilité interne.
Pourquoi un tel retournement de situation ?
Si les circonstances économiques expliquent en partie cette chute, certains éléments conjoncturels viennent en renfort. Les signaux de hausse de taux, déjà perceptibles depuis la fin de 2022, se sont nettement intensifiés mi-2023, faisant craindre des valorisations exubérantes surévaluées. La prudence est en train de devenir la norme : les fonds préfèrent se recentrer sur leurs participations existantes, plutôt que d’aller chercher de nouveaux investissements.
En parallèle, la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024 et les remaniements successifs du gouvernement ont pu renvoyer l’image d’un pays en quête de stabilité politique. Or, les acteurs du capital-risque, sensibles à un environnement réglementaire prévisible, se rangent souvent derrière une volonté de limiter l’incertitude. Les indicateurs de croissance, relativement faibles en France depuis 2023, ont aussi freiné l’élan, les business plans apparaissant moins flamboyants pour les deux ou trois prochaines années.
Autre facteur : l’essoufflement post-Covid. Après l’explosion des investissements en 2021-2022, dopée par les technologies collaboratives, de e-commerce et de services à distance, la surabondance de liquidités semble s’être résorbée. Les start-up qui se sont lancées sur cette vague sont aujourd’hui invitées à démontrer leur pertinence économique dans un climat où seuls les modèles robustes parviennent à convaincre. Cela passe par une optimisation interne plus exigeante, et souvent des licenciements, des réorganisations ou des pivots technologiques drastiques.
Réussite allemande : L’économie industrielle, la sensibilité à la cybersécurité et l’accent mis sur les technologies de défense ont permis à l’Allemagne de limiter les pertes.
Leadership britannique : Le Royaume-Uni tire profit d’une place financière établie, d’un écosystème Fintech florissant, et d’une orientation internationale plus prononcée des investisseurs.
La French Tech entre ambitions et défis
Pour ne pas sombrer dans le pessimisme, rappelons que la French Tech s’appuie sur plusieurs piliers solides, même si son rayonnement international a connu un recul sensible en 2025. Premier atout : la qualité des ingénieurs et chercheurs formés dans des écoles et universités mondialement reconnues. Deuxième pilier : des infrastructures de recherche avancées, notamment dans des domaines émergents (quantique, biotech, nouveaux matériaux). Troisième facteur : la présence de grandes entreprises prêtes à nouer des partenariats ou investir dans des solutions disruptives.
L’initiative publique, souvent critiquée pour sa bureaucratie, reste néanmoins un moteur. Les plans d’investissement successifs visent à favoriser la montée en gamme des start-up. Le gouvernement a récemment martelé sa volonté de faire émerger une nouvelle génération de licornes capables de rivaliser avec les grands champions mondiaux. Les tensions politiques internes risquent toutefois de retarder l’exécution de ces politiques de soutien.
L’histoire de la start-up Alice & Bob
La jeune pousse française, consacrée au calcul quantique, est parvenue à lever 100 millions d’euros cette année. Son ambition : concevoir un ordinateur quantique à tolérance de panne, pouvant exécuter des opérations complexes à une rapidité sans commune mesure avec l’informatique classique. Grâce à un écosystème de laboratoires francés de référence, la société mise sur l’excellence hexagonale en physique.
Dans ce contexte, une mobilisation collective – à la fois politique, technologique et entrepreneuriale – demeure indispensable. La French Tech évolue dans un marché désormais globalisé : la concurrence ne se limite plus au périmètre européen, mais inclut les mastodontes américains et les écosystèmes émergents d’Asie. Pour retrouver le chemin d’un financement à grande échelle, il est crucial de stimuler la confiance des financeurs étrangers, tout en préservant l’esprit d’innovation qui a caractérisé les start-up françaises depuis une décennie.
Des pistes pour renouer avec la croissance
Plusieurs leviers peuvent permettre à la France de relancer les dynamiques de levées de fonds sur son territoire. Parmi les solutions évoquées, l’accélération de l’internationalisation des jeunes pousses semble prioritaire. Au-delà de l’Europe, cibler des marchés à fort potentiel tels que l’Amérique du Nord ou l’Asie-Pacifique pourrait déverrouiller de nouvelles sources de financement. Un ancrage local, complété par une présence mondiale, apparaît comme la combinaison idéale pour diffuser le savoir-faire français.
L’autre levier concerne l’émergence de partenariats industriels intersectoriels. Il s’agit, par exemple, de lier l’IA à la santé, la fintech à la cybersécurité, ou encore la greentech à l’agriculture. Les synergies qui en découlent amplifieraient la portée des innovations françaises, tout en justifiant des investissements plus substantiels auprès de financeurs soucieux d’un fort retour sur investissement.
Sur le plan juridique et fiscal, des ajustements sont évoqués. Les acteurs du capital-risque attendent du gouvernement des mesures favorisant la fluidité des montages financiers, une meilleure attractivité pour les talents internationaux et une fiscalité plus compétitive pour les stock-options et les BSPCE. De tels outils sont jugés indispensables pour attirer et retenir les meilleurs profils, qu’ils soient entrepreneurs, ingénieurs ou investisseurs.
Qui est Knave ?
Knave propose un dispositif robuste de gestion des flux financiers pour les entreprises. Grâce à sa technologie, l’expérience d’encaissement et de paiement s’en trouve rationalisée. Avec sa levée de 100 millions d’euros en 2025, la start-up anticipe de nouveaux développements pour conquérir l’international. Son succès témoigne de l’attrait qui subsiste pour les acteurs au modèle d’affaires rapidement valorisable.
Enfin, les grands groupes et investisseurs institutionnels français pourraient rehausser leur rôle de sponsors. Une logique de co-investissements, associant banques, assurances, fonds publics et sociétés privées, dynamiserait la French Tech. Sans cette coordination, l’écosystème continuera d’évoluer en ordre dispersé, réduisant sa capacité à contrebalancer le poids d’autres nations sur la scène européenne.
Choc des réalités : l’impact global de la baisse
Outre les indicateurs habituels, la chute du volume des investissements pèse sur la structure même de l’écosystème. De nombreuses start-up, à court de financements, plafonnent sans parvenir à réaliser leurs ambitions de croissance ou à développer un produit attrayant. Les accélérateurs et incubateurs, jadis moteurs, éprouvent plus de difficultés à accompagner les projets, faute de perspectives concrètes de financement ultérieur.
Face à cet environnement, la situation de la French Tech peut être perçue sous deux angles. Le premier, pessimiste, souligne le caractère « retour à la réalité » après plusieurs années d’exubérance. Le second, plus optimiste, identifie une occasion de se réorganiser et de renforcer la frugalité des modèles économiques. De nombreux CEO de start-up affirment vouloir consolider leurs équipes, miser sur une rentabilité à moyen terme et limiter les dépenses superflues avant de solliciter des fonds supplémentaires.
Avec la baisse des financements, plusieurs projets innovants se retrouvent en stand-by. On observe moins d’initiatives risquées, comme le développement d’applications IA de rupture ou d’infrastructures technologiques encore balbutiantes. Les entrepreneurs préfèrent sécuriser leurs cœurs d’activité et repousser l’exploration d’idées audacieuses à des jours meilleurs.
Vers une diversification des sources d’investissement
Dans cette phase de repli, la diversification des bailleurs de fonds émerge comme une solution partielle. Si les fonds de capital-risque européens montrent certaines limites, d’autres acteurs pointent le bout de leur nez : capitaux d’Asie (Chine, Singapour, Corée du Sud), family offices nord-américains ou encore grands fonds souverains du Moyen-Orient. Pour attirer ces investisseurs, la France devra démontrer une stabilité politique suffisante et mettre en avant des segments innovants.
Certains entrepreneurs misent également sur des approches de financement participatif, quoique cette option s’avère généralement plus adaptée à des levées modestes ou à des initiatives très communautaires. Dans tous les cas, la recherche de solutions alternatives pourrait pousser les start-up françaises à intensifier leur réseau de partenariats et à bâtir des alliances internationales, mettant fin au paradigme d’une French Tech centrée sur son marché domestique.
Des perspectives encourageantes pour l’IA et le quantique
Malgré la morosité générale, les experts demeurent convaincus que l’Hexagone a les atouts nécessaires pour rebondir. L’IA, qui s’impose comme un levier incontournable de modernisation dans de multiples domaines (santé, finance, logistique, éducation), continue de générer de l’enthousiasme. Les start-up françaises spécialisées dans le traitement du langage, la vision par ordinateur ou le machine learning ont déjà su lever des montants appréciables, même si l’effet d’ensemble reste limité par rapport aux standards américains.
Le quantique, encore balbutiant, suscite un fort engouement chez certains investisseurs. Les enjeux sont de taille : calculs complexes, cryptographie à l’épreuve des supercalculateurs, simulations avancées pour la chimie ou la modélisation. Grâce aux filières d’excellence connectées aux laboratoires publics, la France jouit d’une avance scientifique qui pourrait se traduire en opportunités économiques. Cependant, il faudra encore du temps pour que ces technologies se démocratisent et démontrent leur rentabilité.
En parallèle, les fonds spécialisés (Deep Tech, Health Tech, Cybersecurity, etc.) peuvent servir de catalyseurs en appuyant les innovations de rupture. Dans un horizon où la sécurité internationale demeure un enjeu majeur, la capacité à proposer des solutions originales, tout en garantissant la souveraineté des données, pourrait faire la différence.
Un nouvel équilibre à inventer
Le recul de 35 % des investissements au premier semestre 2025, et la perte de la deuxième place européenne au profit de l’Allemagne, témoignent d’une période de scepticisme prolongé pour le capital-risque français. Les géants de la finance mondiale semblent délaisser la France, la jugeant potentiellement moins stable et moins rentable, pour aller miser sur des écosystèmes voisins qui ont mieux maintenu leur attrait.
Pourtant, un certain réalisme pourrait se dégager de cette phase d’austérité imposée. Les entrepreneurs prennent conscience que la course aux financements ne peut être leur seul credo. Au contraire, l’objectif est de construire des bases solides, basées sur une rentabilité explorée plus tôt dans le cycle de vie des sociétés. La résilience, la durabilité et la capacité d’expansion internationale deviennent dès lors les nouveaux marqueurs de réussite.
Si la French Tech parvient à maintenir l’esprit d’innovation et le goût du risque qui l’ont caractérisée depuis une décennie, elle pourrait ressortir renforcée de cette épreuve. Au demeurant, l’État promet déjà des mesures pour fluidifier les parcours de financement. Certaines métropoles régionales (Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse) se hissent progressivement aux côtés de Paris, favorisant la création de « clusters » technologiques plus dispersés mais peut-être mieux ancrés localement.
Selon plusieurs analystes, la reprise pourrait s’amorcer fin 2025 ou début 2026, à condition que la conjoncture macroéconomique se stabilise et que des initiatives stratégiques soient mises en place à temps. Reste à savoir si l’élan viendra avant tout d’une impulsion publique, d’une prise de conscience des fonds français, d’une arrivée en force des capitaux étrangers ou d’un cocktail de tous ces ingrédients.
Des implications pour la compétitivité globale de la France
En cédant du terrain à l’Allemagne et en restant à bonne distance du Royaume-Uni, la France envoie un signal fort sur son climat d’affaires. Pour garder son attractivité, elle devra faire évoluer sa législation, améliorer son offre d’incitations fiscales et raffermir sa politique d’innovation. L’enjeu ne se limite pas seulement à quelques start-up emblématiques, mais concerne l’ensemble de la compétitivité du pays.
Derrière les statistiques se cachent en effet des réalités concrètes : le recrutement de talents internationaux, la capacité à innover dans les secteurs stratégiques, ou encore la force d’exportation de l’expertise numérique française. Si ces chantiers ne sont pas abordés rapidement, la perte de vitesse risque de s’accentuer, laissant la France dans un statut de suiveur ou de second couteau.
À l’inverse, si l’Hexagone parvient à réorganiser son écosystème autour de pôles d’excellence, s’il encourage réellement l’IA et le quantique, et s’il articule mieux la partie réglementaire avec la fluidité recherchée par les investisseurs, alors la French Tech pourrait rebondir plus tôt que prévu. Accroitre la collaboration entre universités, centres de recherche et industriels demeure également indispensable pour amorcer une vague d’innovations innovantes (notamment dans la e-santé, la cybersécurité, la robotique avancée, etc.).
Bref, l’heure est à la remise en question plutôt qu’à l’abandon. Les fondamentaux restent présents, mais ils nécessitent d’être ravivés et alignés sur les nouvelles réalités du marché international. Ce carrefour historique est l’occasion de repenser les modèles de financement, d’acquérir une vision de long terme et d’ancrer la French Tech dans une dynamique vertueuse, à la fois solide et conquérante.
Un horizon en clair-obscur
La Paris Tech Week et le sommet annuel des start-up, prévus à l’automne 2025, pourraient constituer des points d’inflexion si des annonces fortes sont faites. La question est de savoir si l’écosystème français, composé de nombreux acteurs parfois épars, saura se mettre en ordre de marche pour consolider ses positions. Dans cet environnement fluctuant, l’exigence de performance et la nécessité de repenser la stratégie prennent tout leur sens.
D’un point de vue financier, les meilleures opportunités se situent peut-être dans des segments encore sous-estimés en France, tels que la robotique industrielle, l’agriTech, la MedTech de nouvelle génération ou encore la protection des données en milieu hospitalier. La conjoncture n’interdit pas aux start-up visionnaires de passer à la vitesse supérieure si elles parviennent à se distinguer par des avantages compétitifs solides.
Cependant, la remontée ne se fera pas en claquant des doigts. Comme le rappelait un investisseur emblématique : « La French Tech doit prendre un nouveau virage, sans quoi elle continuera de se faire distancer par nos voisins et par les géants américains. » Les chiffres publiés par le baromètre EY ne laissent pas de place à l’euphorie, mais ils se veulent aussi un rappel : il est encore temps d’agir pour inverser la courbe.
En dépit des inquiétudes et des défis, la French Tech ne manque pas de ressources pour réinventer son attractivité et poursuivre son ascension dans un écosystème mondialisé toujours plus exigeant.