Comment la SFDR transforme le paysage du reporting ESG
Découvrez les implications de la SFDR sur la transparence des investissements ESG et comment les gérants français s'adaptent.
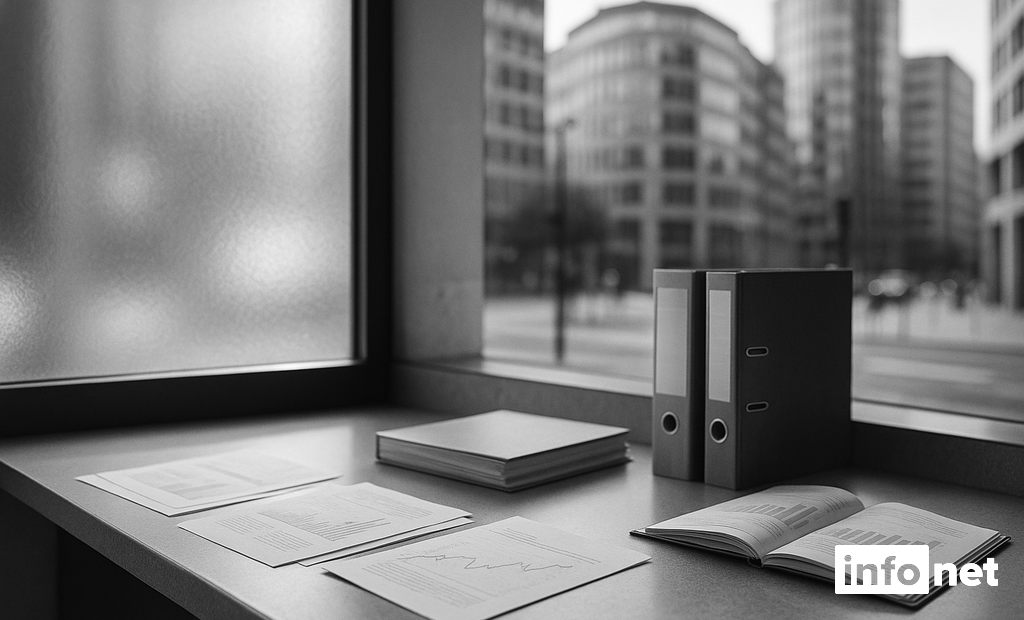
« Mieux adapter le reporting aux stratégies d’investissement », plaide Clara Deniau. En toile de fond, la SFDR, en vigueur depuis mars 2021, a glissé d’un socle de transparence à un quasi-label de marché. À l’heure où Bruxelles révise le texte, l’enjeu est double : crédibiliser l’ESG et aiguiller les capitaux vers des solutions réellement transformatrices.
SFDR : une règle de transparence devenue pseudo-label
La Sustainable Finance Disclosure Regulation impose, depuis 2021, un cadre commun de publication sur la durabilité des produits financiers. Son ambition initiale est claire : harmoniser l’information extra-financière, limiter le greenwashing et permettre la comparaison des fonds sur des bases cohérentes.
Dans la pratique, le marché a converti cette logique de transparence en classification implicite. Les mentions « Article 8 » et « Article 9 » sont devenues des étendards commerciaux, souvent perçus comme des gages de qualité ESG. Cette dérive a produit une ambiguïté entretenue : l’appartenance à une « catégorie d’article » n’est pas censée traduire un niveau de performance extra-financière homogène, encore moins un label au sens strict.
Clara Deniau, Manager Impact chez Citizen Capital, résume le malentendu : la SFDR n’est pas un label, mais un cadre de transparence destiné à éclairer les pratiques d’investissement. Le glissement sémantique installé par les usages de marché a, de fait, brouillé la lecture des stratégies, et réduit la lisibilité pour les investisseurs finaux.
Repères clés de la SFDR pour les gérants français
- Entrée en application : 10 mars 2021.
- Objet : standardiser la transparence sur les caractéristiques ESG et l’impact des produits.
- Architecture : Articles 6, 8 et 9, fondés sur le degré d’intégration ESG et d’objectifs durables.
- Révision : travaux de refonte en cours au niveau européen, avec des orientations attendues en 2025.
- Point sensible : confusion entre transparence réglementaire et labellisation.
Articles 6, 8 et 9 : portée réelle et limites d’usage
La SFDR distribue les produits financiers sur un continuum d’intention ESG :
- Article 6 : aucun objectif spécifique de durabilité, ou prise en compte minimale.
- Article 8 : promotion de caractéristiques environnementales et ou sociales, intégrées dans les décisions d’investissement.
- Article 9 : poursuite d’un objectif d’investissement durable.
Cette classification devait clarifier la nature de l’engagement ESG des fonds. Elle est pourtant fréquemment assimilée à une hiérarchie de qualité, alors qu’elle ne détermine ni l’intensité de l’impact ni l’alignement effectif sur la taxonomie. D’où une lecture biaisée du marché : des fonds aux stratégies très hétérogènes cohabitent au sein des mêmes articles, en particulier dans l’Article 9.
Pour les fonds à impact, cette dilution n’est pas neutre. L’Article 9 a, par endroits, agrégé des logiques de transition carbone, des approches « best-in-class » et des fonds orientés solutions. Même exigence de transparence, mais finalités et preuves très différentes. Résultat : les investisseurs peinent à discerner les véhicules qui visent un impact mesurable de ceux qui s’attachent d’abord à optimiser des profils ESG.
La SFDR cadre la transparence des produits, tandis que la Taxonomie liste des activités économiques considérées durables au regard de six objectifs environnementaux. Un fonds Article 9 n’est pas automatiquement « aligné Taxonomie ». Inversement, la part d’alignement Taxonomie est un indicateur de contribution environnementale, mais ne couvre ni tout l’ESG, ni l’impact social.
Citizen Capital : positionnement et plaidoyer
Acteur du capital-investissement à impact, Citizen Capital souligne, par la voix de Clara Deniau, la nécessité d’un cadre lisible distinguant les fonds de solutions, les fonds de transition et les approches ESG plus généralistes. L’objectif est simple : éviter l’amalgame qui affaiblit la valeur probante des stratégies d’impact. Le fonds s’inscrit dans une mobilisation collective, aux côtés d’Impact Europe et d’autres gérants, pour porter une catégorisation plus explicite.
Mesure d’impact et Taxonomie : angles morts persistants
La Taxonomie verte européenne couvre six objectifs environnementaux : atténuation du changement climatique, adaptation, ressources hydriques et marines, économie circulaire, prévention de la pollution, et protection de la biodiversité. Utile pour identifier des activités bas carbone, elle ne constitue pas une taxonomie sociale. De nombreuses thématiques à impact restent partiellement ou totalement hors champ, comme l’inclusion sociale, certaines dimensions de santé préventive ou des modèles d’agriculture régénératrice.
Les obligations de reporting SFDR mobilisent, elles, des indicateurs standardisés, notamment les PAI (Principal Adverse Impacts). S’ils favorisent la comparabilité, ils ne capturent pas toujours la matérialité spécifique des fonds de solutions, par exemple lorsqu’un véhicule cible des résultats sociaux ou territoriaux précis. De fait, l’alignement entre indicateurs requis et théories du changement reste incomplet.
Ce décalage nourrit une perception biaisée du risque de greenwashing. Les soupçons tiennent parfois moins à une intention trompeuse qu’à un outillage réglementaire qui cadre mal la mesure d’impact, surtout hors-climat. Cette critique est récurrente chez les gérants d’impact, et alimente les propositions d’une catégorisation axée sur les résultats et non seulement sur les processus.
Être classé Article 9 signifie poursuivre un objectif d’investissement durable, pas nécessairement produire un impact additionnel mesurable au niveau de la société. Un fonds peut se focaliser sur des entreprises déjà performantes en ESG ou à fort alignement Taxonomie, sans mécanismes explicites d’additionnalité, d’intentionnalité et de mesure d’effets. L’impact exige un protocole probant : thèse de changement, indicateurs d’output et d’outcome, et gouvernance des effets non intentionnels.
Réforme en cours : segmentation inspirée des SDR britanniques
Les travaux de refonte de la SFDR visent à corriger l’ambiguïté originelle : remettre la transparence au centre et distinguer plus nettement les finalités des produits. Plusieurs acteurs prônent une approche proche des SDR britanniques, où les labels introduisent trois catégories fonctionnelles : fonds de transition, fonds axés durabilité et fonds d’impact. L’intérêt majeur est de faire correspondre, pour l’investisseur final, le type de promesse avec des preuves attendues spécifiques.
Dans un article récent, Forbes France illustre l’enjeu pour les fonds à impact et relaye la demande de clarté formulée par des gérants, dont Citizen Capital. L’objectif n’est pas d’ajouter des contraintes administratives, mais de calibrer le reporting aux stratégies pour éviter les faux-semblants. Sur ce point, la position est constante : plus de lisibilité, moins d’ambiguïté commerciale.
Du côté du marché français, ce réagencement serait susceptible de remodeler la distribution et la fabrication de produits. Les investisseurs institutionnels, qui se repèrent aujourd’hui à l’aune d’articles SFDR, pourraient basculer vers une lecture par objectifs : transition, durabilité, impact. Novethic souligne d’ailleurs la lenteur des travaux de refonte, source d’incertitude pour les acteurs en phase de lancement de fonds et de levées.
- Sustainability-improvers : vise des trajectoires d’amélioration mesurable d’entreprises qui ne sont pas encore leaders ESG mais s’engagent sur une transition crédible.
- Sustainability-focus : cible des actifs ou activités présentant de solides caractéristiques de durabilité, avec preuves à l’appui.
- Impact : recherche un impact positif intentionnel et mesurable, avec théorie du changement, indicateurs d’outcome et gouvernance dédiée.
Cette gradation relie la promesse d’investissement à un format de preuve adapté : KPIs de progrès pour la transition, critères de sélection robustes pour le focus durabilité, dispositifs de mesure d’effets pour l’impact.
Comparatif SFDR vs SDR : ce que change la gradation
La SFDR distingue des niveaux de transparence et d’intentionnalité ESG, mais s’avère peu prescriptive sur la preuve d’impact. Les SDR apportent une segmentation par finalité et introduisent la notion de mécanismes de preuve proportionnés à la promesse. En s’inspirant de cette architecture, l’UE pourrait clarifier les attentes de reporting selon la trajectoire visée par chaque fonds, et réduire le risque de confusion entre amélioration ESG, sélection durable et impact.
Effets attendus en France : gestion, distribution et reporting
Pour les sociétés de gestion françaises, la révision pourrait s’accompagner de relibellages de produits, d’une mise à jour des prospectus et de la documentation commerciale, ainsi que de convergences méthodologiques plus fortes entre communication extra-financière et promesse d’impact. Les équipes conformité et juridiques devront veiller à la cohérence entre la catégorisation retenue et les métriques divulguées.
Les distributeurs verront leur architecture d’offre évoluer, avec des étagères mieux rangées par finalité : transition, durabilité, impact. Côté investisseurs institutionnels, les politiques d’allocation devront affiner la cartographie des objectifs et des preuves associées, notamment pour préparer les comités d’investissement et expliciter la thèse d’allocation aux parties prenantes.
Points de vigilance juridiques et commerciaux
- Substance vs. formulaire : aligner la promesse de produit avec des engagements opérationnels vérifiables.
- Éviter l’ambiguïté marketing : bannir l’appropriation des « articles » comme labels de qualité.
- Traçabilité des données : documenter la chaîne des métriques, du portefeuille jusqu’aux reportings.
- Gouvernance des controverses : prévoir des protocoles de gestion et d’escalade des incidents ESG.
Fonds à impact : exigences de preuve et métriques
Pour les fonds à impact, la légitimité se joue sur la preuve et la gouvernance de l’impact. Les meilleures pratiques convergent vers une documentation claire de la théorie du changement, des indicateurs d’output et d’outcome, des bornes d’additionnalité, ainsi que des procédures de revue externe ou d’audit méthodologique lorsque cela est pertinent.
Les métriques doivent refléter la matérialité propre à la thèse d’investissement. Un fonds de santé préventive ne s’évaluera pas comme un fonds de transition industrielle. Cette spécificité sectorielle plaide pour une catégorisation plus fine au niveau européen, précisément ce que défendent de nombreux acteurs de l’impact.
Startups et PME bénéficiaires : quelles opportunités de financement
La clarification de la SFDR peut jouer un rôle d’entraînement pour les entreprises non cotées qui portent des solutions environnementales et sociales. En améliorant la lisibilité de la demande d’impact côté investisseurs, on facilite la structuration d’offres de capital alignées sur des résultats mesurables : efficacité énergétique, inclusion, économie circulaire, santé, éducation, etc. Les dirigeants gagneront à anticiper les besoins de données de leurs investisseurs pour accélérer les due diligences.
2025, année charnière pour la finance durable européenne
La révision de la SFDR arrive à un moment décisif. D’un côté, la confiance des épargnants et des institutionnels suppose de verrouiller les usages et d’éviter les raccourcis marketing.
De l’autre, le financement de la transition et des solutions sociales exige d’orienter l’épargne vers des fonds capables de prouver une contribution. En s’inspirant d’une segmentation à la façon des SDR, l’Europe peut gagner en clarté sans alourdir indûment le dispositif.
Le signal le plus attendu par le marché français reste un cadre lisible et opérationnel qui distingue la transition, la durabilité et l’impact, et qui autorise des métriques adaptées aux modèles d’affaires financés. Ce chantier, soutenu par des acteurs comme Citizen Capital et Impact Europe, vise la même finalité : réconcilier finance durable et résultats tangibles pour les entreprises et les territoires.
La transparence n’est pas une fin en soi : c’est le moyen d’orienter le capital vers ce qui change réellement les trajectoires.