Le PLFSS 2026 cherche des économies malgré des enjeux sociaux
Découvrez les mesures du PLFSS 2026, leurs impacts sur les dépenses sociales et le calendrier politique clé.
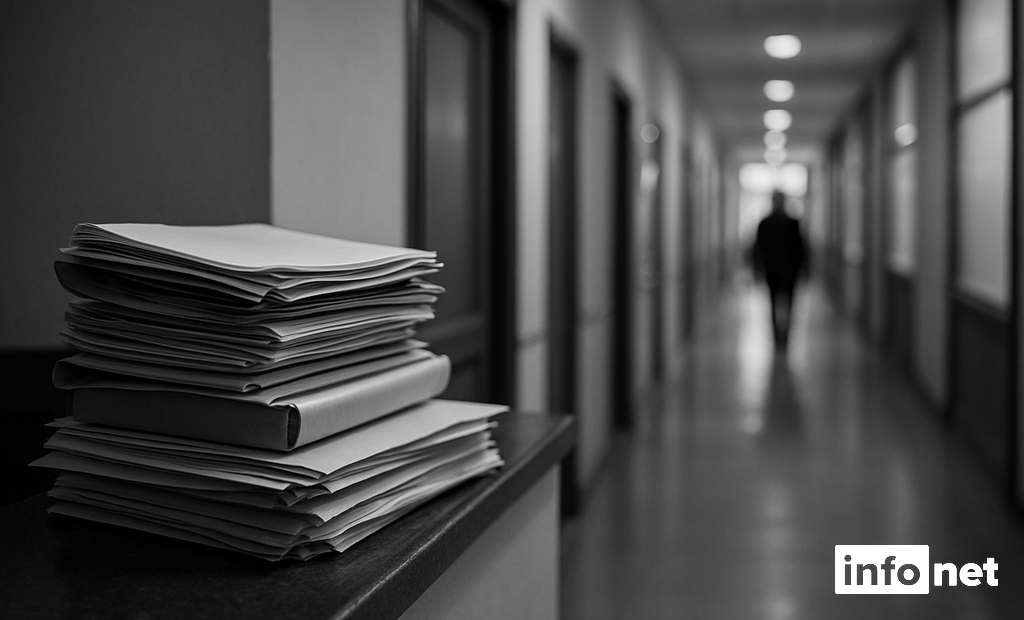
680 milliards d’euros en ligne de mire en 2026 : la Sécurité sociale, plus lourde que le budget de l’État, entre dans une phase de maîtrise accrue. Présenté le 14 octobre 2025 en Conseil des ministres, le PLFSS 2026 vise à ramener le déficit à 17,5 milliards d’euros l’année prochaine, au prix d’économies ciblées et d’une trajectoire jugée exigeante (ministère de l’Économie, 14 octobre 2025).
PLFSS 2026 : cadrage budgétaire et calendrier politique
Le gouvernement présente un PLFSS 2026 taillé pour concilier priorités stratégiques, préservation du modèle social et rétablissement de marges budgétaires. Après plus de 666 milliards d’euros de dépenses attendues en 2025, l’enveloppe frôle 680 milliards en 2026. La séquence est sensible : le texte a été dévoilé en même temps que le projet de loi de finances, en affichant une promesse de discipline budgétaire et de ciblage des prestations.
Sur le terrain parlementaire, l’ampleur des enjeux se lit déjà dans les chiffres. L’Assemblée nationale recense 1 575 amendements déposés sur ce budget social. Les débats ont commencé par une audition groupée des ministres Santé, Comptes publics, Travail et Solidarités, qui présentent ce PLFSS comme une copie de départ vers le déficit de 17,5 milliards d’euros.
La séquence se déploie en trois temps : commission, séance publique, navette. Les débats en commission des affaires sociales ont démarré le 27 octobre avant un examen en hémicycle à partir du 4 novembre. Un vote est annoncé le 12 novembre 2025, puis le texte sera transmis au Sénat. La majorité relative de l’exécutif et les sujets inflammables comme les retraites laissent présager des discussions serrées.
Calendrier parlementaire clé à retenir
Principales étapes de l’examen du PLFSS 2026 :
- 14 octobre 2025 : présentation en Conseil des ministres, avec le PLF.
- 21 octobre : défense du texte par les ministres devant les députés.
- 27 au 31 octobre : commission des affaires sociales.
- À partir du 4 novembre : examen en séance publique.
- 12 novembre : vote à l’Assemblée nationale, puis transmission au Sénat.
Santé et ONDAM : cap sur 2,5 % en 2026
Le cœur de la rigueur porte sur la dépense de santé. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ralentirait à +2,5 % en 2026, contre +3,5 % en 2025.
Ce choix assume une progression inférieure à la dynamique naturelle des coûts de santé. Les autorités plaident l’efficacité et la priorisation. Le secteur hospitalier craint un nouveau tour de vis après des années de tension sur l’emploi et les capacités.
Cette borne à 2,5 % vaut signal macro et micro. Macro, car elle ancre un effort pluriannuel sur des dépenses structurellement dynamiques. Micro, car elle implique des arbitrages sur postes de soins, achats et organisation de l’offre. Dans une période où la démographie médicale, l’attractivité des métiers et les besoins post-pandémiques pèsent, le cadrage suppose des gains opérationnels rapides pour éviter des effets qualité ou file d’attente.
L’ONDAM fixe un taux d’évolution pluriannuel des dépenses d’assurance maladie. Il couvre plusieurs sous-objectifs : soins de ville, établissements de santé, médico-social. Ce n’est pas une enveloppe unique versée une fois pour toutes, mais un cadre d’évolution qui se pilote par levier tarifaire, achats, pertinence des soins et organisation territoriale. Un ONDAM plus bas impose des réallocations, pas seulement des coupes.
Le pari budgétaire reposera donc sur la capacité à faire converger les réformes de pertinence des soins, les achats hospitaliers, la maîtrise des volumes et la gestion des parcours. Sans gains rapides, la contrainte se traduira mécaniquement par des reports d’investissement ou des décalages de recrutement, avec un coût latent sur la qualité de service.
Prestations sociales sous tension : sous-indexation et arrêts de travail
Deux reliers majeurs portent la réduction du déficit du régime général et des organismes rattachés. D’abord, une sous-indexation de certaines prestations par rapport à l’inflation.
Sont explicitement visées les pensions de retraite et les allocations familiales. L’exécutif annonce un rendement budgétaire d’environ 3 milliards d’euros. Le signal politique est fort : dans un pays qui fête les 80 ans de sa Sécurité sociale en 2025, l’effort demande un consentement délicat.
Ensuite, un durcissement des arrêts de travail via les conditions d’indemnisation journalière. Le gouvernement évalue le gain potentiel jusqu’à 1 milliard d’euros. Ce levier vise à contenir la dynamique des IJ tout en renforçant les contrôles, au risque d’un débat récurrent sur la frontière entre prévention des abus et respect des droits des salariés.
À l’échelle microéconomique, une indexation partielle érode le pouvoir d’achat des ménages concernés. En période d’inflation estimée autour de 2,5 %, l’effet cumulé peut peser sur la consommation des retraités et familles modestes. Les entreprises, elles, verront surtout l’impact au travers des négociations salariales et des politiques d’absentéisme.
La sous-indexation consiste à appliquer une revalorisation nominale inférieure à l’inflation constatée ou projetée. Effets :
- À court terme : frein à la dépense publique et baisse du pouvoir d’achat relatif des bénéficiaires.
- À moyen terme : rattrapages éventuels si l’inflation retombe, ou creusement du différentiel si elle se maintient.
- Transmission macro : consommation des ménages potentiellement moindre, surtout pour les postes non compressibles.
Qui est concerné par les mesures d’économies
Mesures affichées et publics directement mentionnés :
- Pensions de retraite : revalorisation sous l’inflation pour générer des économies.
- Allocations familiales : sous-indexation annoncée.
- Arrêts de travail : conditions d’indemnisation journalière durcies.
Effets de second tour possibles sur la consommation et les équilibres sociaux, selon l’évolution des prix.
Fraude sociale et recettes : l’offensive numérique de l’État
Sur le versant des recettes, l’exécutif muscle la lutte contre la fraude sociale, avec davantage de contrôles et d’outils numériques. Le rendement attendu est de 2 milliards d’euros. Ce volet ne se limite pas à une logique de sanction : il vise à sécuriser des bases contributives et à rétablir la confiance dans la protection sociale.
Le pari de performance est toutefois encadré par deux contraintes. D’une part, l’effet d’annonce ne garantit pas le recouvrement effectif, qui dépend des capacités de ciblage, de l’interopérabilité des systèmes d’information et de la qualité des croisements de données.
D’autre part, le taux de transformation des contrôles en recettes substantielles varie selon les contentieux et les voies de recours. L’affichage budgétaire requiert donc un suivi trimestriel étroit pour mesurer l’écart entre escompté et réalisé.
Plusieurs leviers sont mobilisables pour améliorer le ciblage :
- Analyse de risque basée sur les comportements déclaratifs.
- Automatisation des croisements inter-régimes pour détecter les anomalies.
- Suivi ex post des sanctions pour calibrer la dissuasion.
Le rendement dépend de la qualité des algorithmes, du respect du cadre légal et de la fluidité des échanges entre caisses et administrations.
Retraites : suspension temporaire et ligne de crête politique
Autre pierre angulaire du moment social : la suspension temporaire de la réforme des retraites. Objectif affiché : apaiser les tensions et différer l’augmentation de l’âge de départ. Cette mise en pause évite, selon l’exécutif, une hausse immédiate des dépenses liée à la transition. Le sujet demeure, de fait, hautement politique et symbolique, comme l’ont montré les échanges en commission à la fin d’octobre.
Cette suspension place la majorité sur une ligne de crête. Elle atténue la conflictualité sociale à court terme, mais nourrit une incertitude stratégique : sans horizon précis, l’équilibre de long terme des régimes reste une équation à rouvrir. Les oppositions y voient une inflection contrainte plus qu’un choix assumé, tandis que les syndicats maintiennent la pression sur la préservation des droits et la qualité de vie au travail.
Le débat s’imbrique désormais au rythme du calendrier parlementaire du PLFSS avec, en arrière-plan, le souci de préserver le socle de confiance autour d’un système qui fête son 80e anniversaire. La densité d’amendements témoigne d’une volonté des groupes de peser sur chaque paramètre, qu’il s’agisse de prestations, de recettes ou de trajectoires pluriannuelles.
Déficit, macro et discipline : l’équation 2025-2026
Le déficit de la Sécurité sociale est estimé à 23 milliards d’euros en 2025. Pour 2026, l’objectif de 17,5 milliards s’inscrit dans une trajectoire budgétaire plus large : le solde public global atteindrait -4,7 % du PIB en 2026, soit une amélioration de 0,6 point par rapport à 2025, selon les documents budgétaires. Cette visée repose sur des hypothèses macroéconomiques prudentes mais exigeantes.
L’INSEE anticipe un ralentissement de la croissance à 1,1 % en 2025, ce qui rend l’exercice encore plus serré. L’inflation restant aux alentours de 2,5 %, le pouvoir d’achat et les recettes assises sur la masse salariale pourraient ne pas offrir de surprises positives. Dans ce contexte, la discipline d’exécution comptera autant que le cadrage initial : les écarts infra-annuels, s’ils apparaissent, devront être corrigés rapidement pour tenir la cible.
Plus largement, se dessine une refonte implicite du modèle social : recentrage sur les missions essentielles, aides plus sélectives, pilotage serré des dépenses. Les partisans y voient une adaptation nécessaire dans le monde post-pandémie et la montée des déficits.
Les opposants alertent sur une possible érosion des droits sociaux, aggravée par les économies en santé et sur prestations. Le point d’équilibre dépendra de l’arbitrage politique et de la conjoncture.
Repères macro à 12 mois
- Croissance 2025 attendue à 1,1 % selon l’INSEE.
- Inflation autour de 2,5 %.
- Solde public 2026 projeté à -4,7 % du PIB avec une amélioration de 0,6 point sur un an.
Une tonne d’incertitudes conjoncturelles planent sur ces paramètres. Tout écart de trajectoire pèsera mécaniquement sur la consolidation de la Sécurité sociale.
Le solde public agrège État, Sécurité sociale, collectivités et organismes divers. Le -4,7 % indique l’écart entre dépenses et recettes sur l’ensemble. Pour la Sécurité sociale, tenir la cible demande que l’ensemble des leviers fonctionne simultanément : ONDAM, sous-indexation, IJ, anti-fraude, et gestion des aléas conjoncturels. Un choc de recettes négatif appelle des mesures correctrices en cours d’exercice ou une reprogrammation.
Ce que les directions financières doivent surveiller d’ici au 12 novembre
La période qui s’ouvre est décisive pour les entreprises, particulièrement pour les directions financières, paie et affaires sociales. Trois lignes d’attention émergent.
Premièrement, la dynamique d’absentéisme : un durcissement des conditions d’IJ peut redistribuer les équilibres entre régimes et assurances complémentaires, avec des conséquences sur la couverture et les policy rules internes. Deuxièmement, la négociation salariale : la sous-indexation des prestations aux ménages peut réactiver des revendications et peser sur la politique salariale des branches et entreprises. Troisièmement, la planification budgétaire : des trajectoires ONDAM contraintes tendent à comprimer l’offre, avec des effets d’accessibilité qui peuvent se refléter en coûts indirects pour les employeurs.
Au plan opérationnel, il est utile d’anticiper le calendrier de mise en œuvre pour ajuster les hypothèses de masse salariale, de frais de santé collective et de politiques d’absentéisme. Les directions Juridique et RH suivront de près les ajustements réglementaires qui découleront des arbitrages parlementaires, en intégrant un scénario d’aléas si certaines économies n’étaient pas au rendez-vous dès 2026.
PLFSS : projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Cible les recettes, dépenses et l’équilibre du système de protection sociale.
PLF : projet de loi de finances. Couvre le budget de l’État et ses opérateurs.
ONDAM : objectif national de dépenses d’assurance maladie. Taux d’évolution annuel de la dépense d’Assurance maladie, par sous-objectifs.
Le cap budgétaire est posé et les lignes de clivage sont identifiées. D’ici au vote à l’Assemblée, les entreprises gagneront à cartographier les impacts possibles sur leur masse salariale, leurs couvertures sociales facultatives et leurs engagements de politique sociale, tout en gardant un œil sur les compromis qui pourront émerger en séance.
Prochaine étape : mesurer, au fil des débats, ce qui relève des intentions et ce qui s’inscrira effectivement dans la loi.