Quels sont les avantages du CDI de valorisation de l'expérience ?
Découvrez comment la loi de 2025 valorise les seniors au travail avec de nouveaux contrats et aménagements.
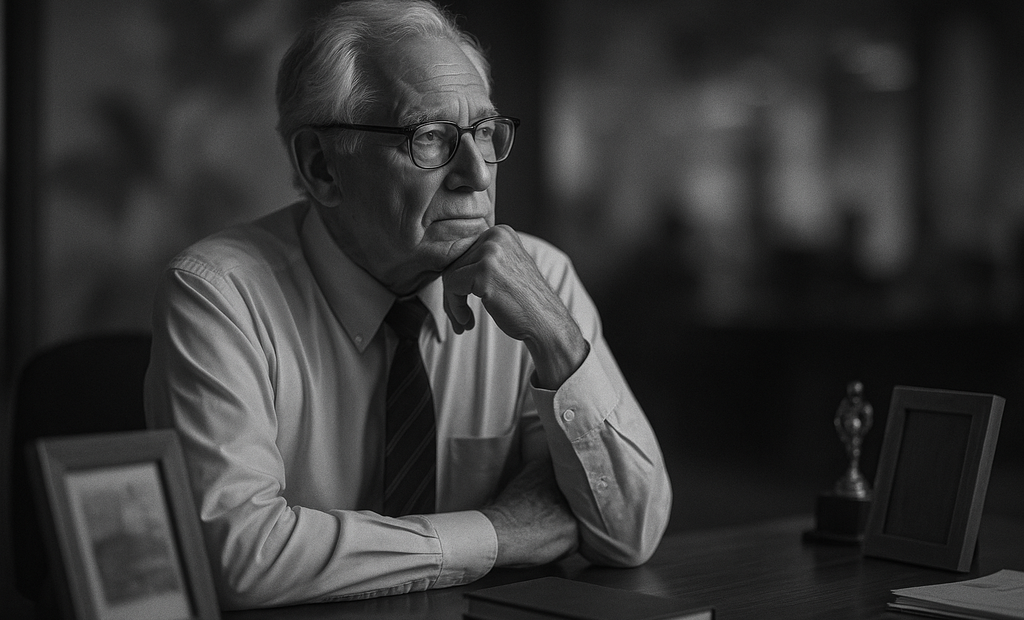
Changer la fin de carrière en avantage concurrentiel plutôt qu’en point de friction sociale. C’est l’ambition du projet de loi présenté en Conseil des ministres le 7 mai 2025, qui transpose les ANI conclus en novembre 2024 et se concentre sur l’emploi des salariés expérimentés. Le Sénat l’a adopté à l’unanimité le 4 juin 2025, une rareté politique qui dit beaucoup des attentes des entreprises et des partenaires sociaux.
Au cœur du texte, trois leviers s’articulent pour créer de la fluidité : un CDI de valorisation de l’expérience avec sortie sécurisée, un temps partiel de fin de carrière finançable sans surcoût immédiat, et un encadrement renforcé du refus de retraite progressive. Derrière ces instruments, un même horizon : accroître le taux d’emploi des 60-64 ans en misant sur la transmission des compétences et une gestion fine des âges.
Du compromis social au vote unanime : un parcours maîtrisé et structurant
Le texte prend sa source dans les accords nationaux interprofessionnels conclus en novembre 2024 par les partenaires sociaux. Le gouvernement en propose une transposition fidèle et ciblée sur l’emploi des seniors, officiellement présentée le 7 mai 2025, puis examinée au Sénat le 4 juin 2025 où le vote favorable a été unanime. Cette fluidité institutionnelle laisse entrevoir une mise en œuvre dès 2025, sous réserve du parcours parlementaire final.
Le socle de la réforme s’appuie sur un constat connu des DRH : la France reste en retrait sur l’emploi des 60-64 ans, alors même que la réforme des retraites a relevé l’âge légal. Les entreprises se trouvent face à un double impératif : retenir des profils à haute valeur ajoutée tout en organisant des transitions maîtrisées, évitant les ruptures d’activité et les pertes de savoir-faire.
Les instruments choisis privilégient l’incitation contractuelle et l’outillage des collectifs de travail plutôt que des obligations unilatérales. Ils sont combinables et laissent une marge de négociation au plus près du terrain, notamment via les accords d’entreprise ou de branche.
Calendrier et périmètre du texte
7 mai 2025 : présentation en Conseil des ministres. 4 juin 2025 : adoption à l’unanimité au Sénat.
Portée : transposition des ANI de novembre 2024, avec trois axes opérationnels clés : CDI expérimental de valorisation de l’expérience, temps partiel de fin de carrière, encadrement du refus de retraite progressive. Mise en œuvre attendue en 2025, après finalisation du parcours législatif.
Les partenaires sociaux ont privilégié des outils d’employabilité plutôt que des quotas d’âge. Ils ont balisé une trajectoire : maintenir en emploi plus longtemps les salariés expérimentés via des leviers contractuels et de dialogue social, sécuriser la sortie pour éviter les ruptures brutales, et accroître la flexibilité organisationnelle là où les enjeux métiers l’exigent. La transposition législative conserve ce triptyque sans le dénaturer.
Cdi de valorisation de l’expérience : un contrat à atterrissage programmé
L’article 4 instaure un CDI expérimental de cinq ans, dit contrat de valorisation de l’expérience. Il vise les demandeurs d’emploi de 60 ans et plus inscrits à France Travail. Une clause d’abaissement à 57 ans est possible si un accord de branche étendu le prévoit, ce qui laisse aux secteurs en tension un levier adapté aux réalités de recrutement.
Conditions d’entrée : le salarié ne doit pas pouvoir prétendre à une pension de base à taux plein au moment de l’embauche, hors régimes spéciaux et pensions militaires, et ne doit pas avoir travaillé dans l’entreprise dans les 6 mois précédents. La logique est claire : réactiver des profils expérimentés tout en évitant un effet d’aubaine sur des retours immédiats.
Surtout, ce CDI se distingue par sa sortie sécurisée. Dès que le salarié atteint l’âge légal de départ applicable à sa génération et remplit les conditions de durée d’assurance pour un taux plein, l’employeur peut prononcer la mise à la retraite d’office, sans accord du salarié.
Un préavis équivalent à celui d’un licenciement s’applique et une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement doit être versée. Particularité financière : exonération de la contribution patronale de 30 % habituellement due sur les indemnités de mise à la retraite.
L’équilibre recherché est transparent : d’un côté, un CDI qui ouvre la porte à des profils que les entreprises n’auraient peut-être pas sollicités en l’absence de visibilité de sortie ; de l’autre, une capacité de pilotage de la durée du contrat lorsque la retraite à taux plein devient accessible.
Effets de trésorerie et charges pour l’employeur
L’exonération de la contribution patronale de 30 % sur l’indemnité de mise à la retraite, propre au CVE, allège le coût de sortie. Le préavis aligné sur le licenciement offre un temps d’organisation à l’entreprise pour anticiper la transmission. Côté risques, sécuriser la traçabilité de l’éligibilité au taux plein et des échanges avec l’assuré reste essentiel pour éviter les contentieux.
Hors CVE, la mise à la retraite d’office par l’employeur est encadrée et ne peut intervenir librement qu’à partir de 70 ans, âge auquel le consentement du salarié n’est plus requis. Avant ce seuil, une mise à la retraite suppose l’accord du salarié, sauf cas prévus par la loi. Le CVE constitue une exception ciblée, limitée aux recrutements réalisés sous ce dispositif et sous conditions strictes.
Sur le plan managérial, le dispositif répond à une préoccupation opérationnelle : assurer un retour rapide à l’emploi de seniors qualifiés, souvent immédiatement productifs, tout en évitant un blocage du poste au-delà de l’obtention du taux plein. Le contrat devient ainsi un outil de transition plutôt qu’un terminus.
Côté conformité, la vigilance porte sur la motivation de la rupture, la preuve de la date d’atteinte du taux plein et la proportionnalité face au droit européen de non-discrimination. Le caractère expérimental, la transparence des conditions et l’indemnité alignée sur le licenciement renforcent la robustesse juridique du mécanisme, sans exclure la nécessité d’un accompagnement RH précis.
Temps partiel de fin de carrière : rémunérer la réduction du temps sans asphyxier la trésorerie
L’article 6 ouvre un dispositif attendu des directions financières : permettre à un salarié en fin de parcours de réduire son temps de travail tout en percevant une rémunération supérieure au prorata de la durée effectuée. La clé de voûte est le financement par étalement de l’indemnité de départ à la retraite. Le complément de salaire provient ainsi de l’étalement, sur la période de travail à temps réduit, de l’indemnité qui aurait été versée en cas de départ immédiat.
Ce mécanisme n’est pas un chèque en blanc. Il s’applique uniquement via un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche, qui précise notamment les taux de réduction, les modalités de calcul et de versement du complément.
Tous les salariés sont éligibles, y compris ceux au forfait annuel en jours, sous réserve de l’accord collectif applicable. À la fin, tout reliquat d’indemnité est versé lors du départ effectif à la retraite.
Le bénéfice est double : le salarié anticipe sa transition avec des revenus plus stables qu’un simple temps partiel, et l’employeur lisse sa charge d’indemnité, remplaçant un pic de trésorerie par un flux mensuel pilotable. C’est aussi un levier pour organiser la transmission sur une temporalité maîtrisée, en créant des duos seniors-juniors sur des périodes plus longues.
Points à verrouiller : périmètre des bénéficiaires, seuils de réduction de temps (ex. 60 à 80 %), modalités de calcul du complément, gestion des absences et de la formation, traçabilité de l’imputation de l’indemnité étalée, coexistence avec d’autres dispositifs (retraite progressive, CET, monétisation des jours). La sécurisation passe par une base de calcul claire et des clauses de révision périodique.
Sur le plan comptable, l’étalement de l’indemnité change la physionomie du passif social en transformant une charge ponctuelle en charge répartie. Il convient d’anticiper la documentation financière et les écritures d’étalement selon les pratiques de l’entreprise. La pédagogie interne est déterminante pour expliciter la différence entre complément de salaire et indemnité provisionnée.
Au-delà de la technique, ce temps partiel soutenu par une indemnité étalée constitue un signal de reconnaissance pour des salariés expérimentés, souvent pivots de la qualité opérationnelle. Il manifeste une intention claire : protéger les fins de carrière sans altérer la compétitivité coût de l’organisation.
Retraite progressive : un refus désormais encadré par l’activité et le marché du travail
L’article 5 renforce la cohérence entre la retraite progressive et les impératifs opérationnels. La retraite progressive permet à un salarié de liquider une pension provisoire tout en réduisant son activité. Jusqu’ici, l’employeur pouvait refuser la demande pour des motifs tirés de l’incompatibilité avec l’activité économique de l’entreprise.
Désormais, la justification doit intégrer la continuité de l’activité ou du service et, le cas échéant, les difficultés de recrutement sur le poste concerné. Autrement dit, le refus ne pourra plus s’appuyer sur de simples considérations générales. Il devra être concret, documenté et proportionné, en lien avec les réalités d’organisation et de marché auxquelles l’entreprise est confrontée.
Pour les DRH, la marche à suivre s’éclaire : instruire la demande avec une analyse d’impact opérationnel, objectiver les contraintes de continuité et, si nécessaire, qualifier les tensions de recrutement. La granularité des justifications devient un critère de sécurité juridique du refus. C’est une incitation forte à négocier des cadres collectifs de gestion des temps réduits en fin de carrière, afin de baliser les arbitrages individuels.
Check-list DRH pour sécuriser un refus de retraite progressive
1. Cartographier les tâches critiques et les jalons de continuité. 2. Documenter la durée et l’intensité des tensions de recrutement sur le poste. 3. Justifier l’impossibilité d’un aménagement alternatif.
4. Tracer l’examen des scénarios de remplacement. 5. Étayer l’analyse par des éléments objectifs et datés. Cette traçabilité réduit très fortement le risque contentieux.
Sur le terrain, cette évolution devrait augmenter les accords de retraite progressive là où l’organisation le permet, et rendre plus robustes les refus là où le poste est indispensable en temps plein ou difficile à pourvoir. Les entreprises y gagnent une prévisibilité et un cadre de dialogue avec les représentants du personnel.
Chaîne de valeur des compétences : que gagnent les entreprises avec ces trois leviers
Pris ensemble, le CVE, le temps partiel de fin de carrière et l’encadrement du refus de retraite progressive réécrivent la feuille de route RH des dernières années de carrière. Ils favorisent un continuum emploi-formation-transmission en laissant à l’entreprise la possibilité de découper les trajectoires plutôt que de les subir.
Sur les métiers en tension, le CVE permet d’accélérer des recrutements seniors qui auraient été écartés faute de visibilité sur la sortie. Dans des organisations matures, le temps partiel de fin de carrière offre de mettre en place des binômes pour capter et formaliser le savoir tacite. Enfin, la retraite progressive, mieux encadrée, devient un outil équilibré pour réduire progressivement un temps de présence là où l’activité l’autorise.
La combinaison des trois invite à une planification pluriannuelle des effectifs, avec des jalons clairs : temps plein, temps partiel de fin de carrière, retraite progressive, sortie CVE. Les entreprises qui réussiront seront celles qui mettent l’analytique RH au service des exploitations de site ou d’agence, et qui ancrent ces dispositifs dans les accords collectifs.
Un autre bénéfice tient à la réputation employeur. Ouvrir des voies de fin de carrière lisibles et valorisantes renforce l’attractivité auprès des 45-55 ans, qui se projettent dans l’entreprise lorsqu’ils perçoivent un parcours rendu prévisible et respectueux des contraintes personnelles.
Gouvernance sociale et conformité : sécuriser l’usage des nouveaux outils
La performance du dispositif reposera sur la qualité des accords collectifs et la discipline probatoire dans la gestion des dossiers individuels. Les directions d’entreprise ont intérêt à structurer une feuille de route articulant stratégie d’âges, trajectoires métier, et processus d’instruction des demandes de réduction d’activité.
Pour le CVE, il est essentiel d’ancrer le processus d’embauche sur une vérification rigoureuse : inscription à France Travail, absence de lien de travail dans les 6 derniers mois, contrôle de non-atteinte du taux plein au moment de l’embauche. À la sortie, la preuve de l’atteinte des conditions pour le taux plein et la notification respectant le préavis équivalent au licenciement doivent être irréprochables.
Pour le temps partiel de fin de carrière, l’accord collectif devient le texte pivot. Il doit cadrer les modalités de calcul du complément, la gestion des variations de temps de travail, l’articulation avec la formation et la planification des transmissions. Un calendrier de revue annuelle des bénéficiaires et du dispositif permet d’ajuster la trajectoire.
Pour la retraite progressive, la clé est la traçabilité de l’analyse : motif concret, impossibilité d’aménagement, difficultés de recrutement objectivées. Une charte interne peut fluidifier les décisions, en encadrant les délais de réponse et en favorisant le dialogue avec les représentants du personnel.
Si le CVE cible principalement les 60 ans et plus, beaucoup d’entreprises déploient leur politique seniors dès 45 ou 50 ans. L’enjeu est d’anticiper : seconde partie de carrière, bilans de compétences, mobilité interne, prévention de l’usure professionnelle. La cohérence entre cette politique « amont » et les nouveaux leviers « aval » (temps partiel de fin de carrière, retraite progressive) fait la différence sur l’emploi durable des âges.
Un comité de pilotage réunissant Direction générale, RH, finance et métiers peut suivre l’implantation, arbitrer les priorités et évaluer les effets. Objectif : mesurer à intervalles réguliers si les dispositifs soutiennent la continuité opérationnelle et réduisent le risque de rupture sur des postes à forte criticité.
Lecture économique : arbitrer flexibilité, coûts et valeur des savoir-faire
Le projet de loi internalise une partie des coûts d’adaptation liés au vieillissement de la population active en offrant des options moins brutales qu’une cessation d’activité immédiate et plus fiables qu’un empilement de dérogations individuelles. Il donne aux entreprises la latitude de recruter des seniors qualifiés en sécurisant la sortie, et de réaménager la fin de carrière sans choc de trésorerie.
Sur le plan macro, la combinaison de ces trois outils peut contribuer à remonter le taux d’emploi des 60-64 ans en agissant sur les décisions microéconomiques des employeurs. Les métiers en pénurie de main-d’œuvre devraient tirer le meilleur parti du CVE. Les secteurs à forte intensité de savoir-faire tacite bénéficieront plutôt du temps partiel de fin de carrière comme instrument de transmission prolongée.
Les entreprises devront toutefois veiller à calibrer finement les usages. Multiplier les CVE sans politique de formation complémentaire serait contre-productif.
Inversement, généraliser le temps partiel de fin de carrière sans succession planifiée peut accroître les goulots d’étranglement. La vertu du texte tient autant dans l’outillage que dans l’appel à une gouvernance des âges mieux outillée.
Enfin, l’encadrement du refus de retraite progressive place la barre de la justification à un niveau plus élevé, ce qui, bien piloté, réduit l’aléa contentieux et incite à une gestion proactive des trajectoires individuelles.
Points de vigilance pour conseils d’administration
1. Superviser l’alignement entre besoins de compétences et volumes d’entrées en CVE. 2. S’assurer que l’étalement des indemnités de fin de carrière est documenté et provisionné.
3. Veiller à la conformité des refus de retraite progressive avec les nouvelles exigences. 4. Suivre des indicateurs d’âge moyen par métier critique et d’avancement des transmissions.
Cap d’exécution 2025 : trajectoire et premiers gestes pour les entreprises
L’entrée en vigueur attendue en 2025 invite à passer dès maintenant en mode préparation. Les DRH et directions opérationnelles peuvent cartographier les métiers à fort enjeu de séniorité, repérer les postes en tension et simuler différents scénarios : recrutements cibles en CVE, passages en temps partiel de fin de carrière, cas de retraite progressive compatibles avec l’organisation.
La clé sera de faire vivre le dialogue social par des accords calibrés, de former les managers à l’instruction des demandes individuelles et de sécuriser la preuve dans chaque dossier. À ce prix, les trois leviers du texte peuvent devenir des accélérateurs de performance et de transmission des savoirs, plutôt que des sujets de friction.
En mettant à disposition des entreprises un CDI de transition, un temps partiel finançable et un refus de retraite progressive mieux balisé, le projet de loi offre une panoplie cohérente pour augmenter l’emploi des seniors tout en protégeant la continuité économique et la transmission des compétences.