Comment les entreprises françaises vont adapter leurs états financiers au climat ?
Découvrez les nouvelles illustrations IFRS pour intégrer les risques climatiques dans les états financiers des entreprises françaises dès 2025.
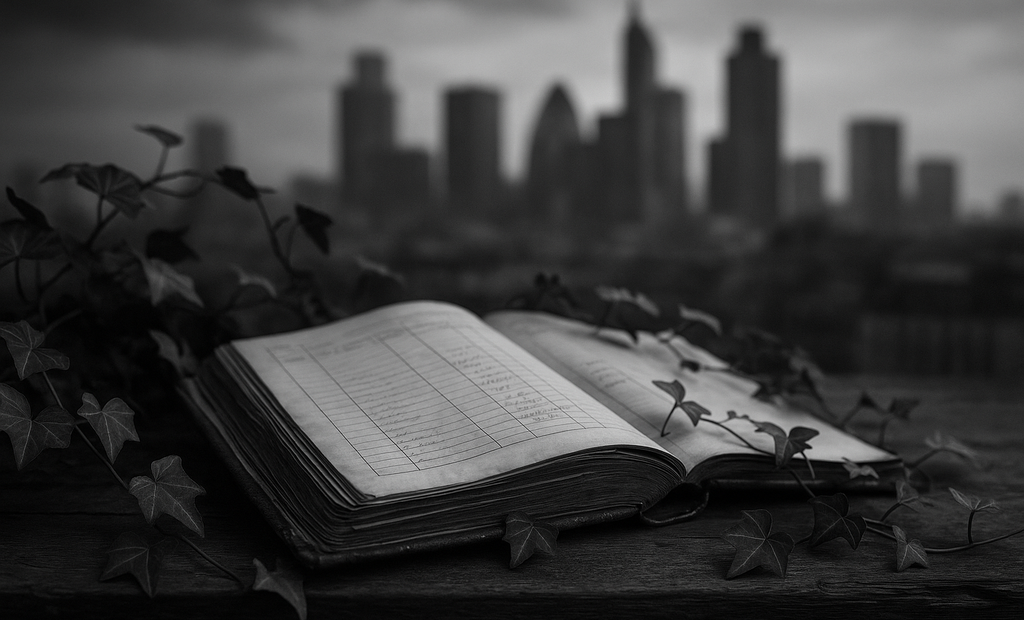
Les groupes français tiennent un nouveau fil conducteur pour traduire le climat dans leurs chiffres. La Fondation IFRS a mis en ligne, le 24 juillet 2025, des exemples quasi finalisés qui éclairent la manière d’intégrer les incertitudes climatiques dans les états financiers. Objectif : plus de transparence, moins d’incohérences entre narratifs de durabilité et données comptables, avec une mise en œuvre facilitée dès les clôtures en cours.
Publication du 24 juillet 2025 : un jalon opérationnel pour les émetteurs français
La Fondation IFRS a publié un « near-final staff draft » qui détaille six exemples illustratifs destinés à guider l’application des normes IFRS aux risques climatiques. L’IASB a piloté le contenu en coordination avec l’ISSB afin que les principes de comptabilisation et d’information financière puissent dialoguer de manière cohérente avec les exigences de durabilité.
Ces exemples, non obligatoires en tant que tels, précisent l’usage de normes existantes : IAS 1 et IFRS 18 pour la présentation et les jugements, IAS 36 pour les tests de dépréciation, IFRS 7 pour le risque de crédit, IAS 37 pour les provisions, et IFRS 18 pour la désagrégation des informations. La version finale est annoncée pour octobre 2025. Le Monde du Chiffre a signalé cette publication le 12 août 2025, complétée par la presse spécialisée anglophone (25 juillet 2025).
Pour les entreprises françaises, la portée est immédiate : les états financiers IFRS consolidés des sociétés cotées et des groupes volontaires disposent d’un référentiel pratique pour documenter matérialité, hypothèses, sensibilités et impacts sectoriels liés au climat. Les commissaires aux comptes y trouveront une base commune d’échanges sur les jugements clés et les analyses de sensibilité.
Dates clés à retenir
- 24 juillet 2025 : publication des exemples quasi finalisés par la Fondation IFRS.
- Octobre 2025 : finalisation attendue du document.
- 2025-2026 : montée en puissance dans les closes comptables, avec encouragement à l’application anticipée, tout en respectant la hiérarchie des normes IFRS. Ces jalons visent à préparer une information plus robuste dès les prochains arrêts de comptes.
Pourquoi cette publication maintenant : pression des investisseurs et cohérence ifrs-issb
Les retours de place en 2023 et 2024 ont convergé : abondance de données de durabilité, mais peu de transposition explicite dans les estimations comptables, et parfois des messages divergents entre extra-financier et états financiers. D’où l’initiative de l’IASB, avec le soutien de l’ISSB, pour afficher une ligne claire sur la traduction financière des scénarios climatiques.
Andreas Barckow, président de l’IASB, a insisté sur l’intérêt d’une publication « précoce » : donner de la visibilité sur la doctrine en cours pour accélérer la mise en pratique et limiter les écarts d’application d’un pays à l’autre. Pour les émetteurs français, cela tombe au bon moment : montée en charge des ESRS au titre de la CSRD, dialogues investisseurs plus exigeants et stratégies de transition qui doivent désormais se lire aussi dans les comptes.
Le signal est également adressé aux banques, assureurs et entreprises industrielles : les modèles de risques, la valorisation des actifs non courants et les attentes en matière de sensibilités chiffrées doivent refléter les chocs physiques et de transition. Ce matériau illustratif n’ajoute pas de nouvelles obligations, mais éclaire la façon d’appliquer les textes existants aux réalités climatiques.
Matérialité : une information est significative si son omission ou inexactitude pourrait influencer les décisions des investisseurs. Incertitude de mesure : lorsque des estimations impliquent des hypothèses sensibles, l’entreprise doit exposer l’étendue de l’incertitude et ses effets potentiels. Les exemples IFRS rappellent que les risques climatiques peuvent déclencher l’une et l’autre : la matérialité oriente « quoi » divulguer, l’incertitude « comment » le quantifier et le qualifier.
Les six illustrations ifrs : ce qui change pour les jugements, les tests et les divulgations
Le document proche de sa version finale regroupe six thèmes qui seront familiers aux directions financières. Leur ambition : transposer des scénarios climatiques concrets dans les paragraphes IFRS pertinents, sans créer de normes nouvelles. Voici l’essentiel, avec une focale sur l’application pratique en France.
- Jugements de matérialité sur les plans de transition : en s’appuyant sur IAS 1 paragraphe 31, ou IFRS 18 paragraphe 20, une entité explique pourquoi un plan climat supposé ambitieux n’affecte pas ses tests de dépréciation, ses durées d’utilité ou ses flux futurs. Si l’absence d’effet est significative, il faut la justifier par des hypothèses soutenables et des horizons temporels cohérents.
- Hypothèses spécifiques pour les dépréciations : sous IAS 36, les coûts d’émissions ou les prix du carbone prospectifs peuvent peser sur les flux futurs et les valeurs recouvrables. L’exemple illustre la communication sur les hypothèses clés et les analyses de sensibilité lorsque la valeur recouvrable frôle la valeur comptable.
- Hypothèses générales et sources d’incertitude : au titre des paragraphes 125 et 129 d’IAS 1 (ou 31A et 31E d’IAS 8), l’entité décrit les hypothèses qui sous-tendent ses décisions comptables à fort jugement, même lorsqu’aucune perte de valeur n’est comptabilisée. Des éléments comme l’évolution réglementaire, la trajectoire de demande et la vitesse d’adoption technologique sont explicites.
- Risque de crédit et IFRS 7 : les chocs climatiques physiques ou de transition impactent les probabilités de défaut, les garanties, et les concentrations sectorielles ou géographiques. L’exemple insiste sur la transparence des hypothèses qui alimentent les modèles de pertes attendues, et sur la granularité par portefeuilles exposés.
- Provisions de démantèlement et IAS 37 : quand les obligations de remise en état demeurent immatérielles au bilan, une information utile peut néanmoins s’imposer si la transition accélère la fermeture de sites ou modifie les coûts. Le message : expliciter la nature de l’obligation et la raison de l’absence d’impact chiffré.
- Désagrégation sous IFRS 18 : la séparation d’informations entre actifs très émissifs et moins émissifs peut éclairer des profils de risque différents. Cette désagrégation s’articule avec les agrégats principaux sans noyer le lecteur sous un excès de détails.
Un point commun ressort : la nécessité d’une trajectoire d’hypothèses articulée avec les scénarios climatiques retenus par l’entreprise et cohérente dans le temps. La crédibilité du discours tient à la stabilité du cadre et à l’explication des changements d’hypothèses, le cas échéant.
IFRS 18 réorganise et met à jour les exigences de présentation et de divulgation des états financiers. La désagrégation y prend plus de place : l’entreprise doit distinguer les informations si cela améliore la compréhension des marges, des risques et des flux. Dans un contexte climatique, segmenter par intensité carbone ou par exposition réglementaire peut devenir pertinent, selon la matérialité.
IFRS 18 : calendrier et articulation avec IAS 1
IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements a été publié en 2024 avec une application à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2027, adoption anticipée permise. Dans l’intervalle, IAS 1 continue de s’appliquer. Les exemples IFRS précisent les références d’articles pour l’un et l’autre, afin d’éviter les ambiguïtés entre journaux de transition et états IFRS.
Effets attendus sur les clôtures 2025-2026 : un surcroît d’explications et de données chiffrées
L’IASB encourage une application anticipée de ces illustrations. Les entreprises peuvent donc réviser leurs notes annexes dès les états semestriels 2025 et les comptes annuels 2025, sans attendre le texte final d’octobre, à condition de rester strictement dans le champ des normes existantes.
Clôtures 2025 : la marche praticable
Trois priorités ressortent. D’abord, documenter la matérialité : dire pourquoi des effets climatiques sont significatifs, ou au contraire, pourquoi ils ne modifient pas encore les tests et évaluations.
Ensuite, renforcer la sensibilité : fournir des fourchettes et scénarios alternatifs lorsque les incertitudes dominent la mesure. Enfin, aligner les récits : veiller à la cohérence entre objectifs de transition, plans d’investissement et hypothèses de valorisation.
Audit et gouvernance : un terrain d’entente plus solide
Les commissaires aux comptes vont s’appuyer sur ces exemples pour évaluer la qualité des jugements climatiques : choix des hypothèses, robustesse des sources, traçabilité des calculs. Les comités d’audit devraient prévoir un point dédié sur la « connectivité » des informations entre ESG et états financiers, surtout dans les secteurs à forte intensité carbone ou crédit à risque.
Déclarer qu’un plan de transition n’a pas d’impact sur les tests d’impairment peut être significatif si l’entreprise est fortement exposée aux risques climatiques. L’exemple IFRS montre comment expliquer cette « absence d’effet » : hypothèses prudentes, horizon d’investissement, délais réglementaires et marges de manœuvre opérationnelles. Le lecteur doit comprendre pourquoi l’absence d’impact est raisonnable.
Secteurs sous la loupe : où les états financiers vont bouger en premier
Les illustrations IFRS orientent la focale vers les domaines où les hypothèses climatiques irriguent déjà les modèles financiers. Les secteurs ci-dessous devraient renforcer rapidement leurs notes annexes et, pour certains, leurs estimations.
Banques et sociétés de financement : modèles de pertes attendues et concentrations
Le risque de crédit se nourrit de la matérialité sectorielle et géographique. Les établissements prêteurs doivent veiller à l’intégration des scénarios physiques (inondations, sécheresses) et de transition (taxe carbone, interdictions, substitution technologique) dans les paramètres des pertes de crédit attendues. Les concentrations sur des zones sensibles ou des portefeuilles à forte intensité carbone appellent une information désagrégée sous IFRS 7, avec des explications sur la calibration des modèles.
Énergie, chimie, matériaux : dépréciations et coûts de démantèlement
Dans ces secteurs, la visibilité réglementaire et les coûts du carbone pèsent sur la valeur recouvrable des actifs longue durée. Les hypothèses retenues pour IAS 36 devront être documentées : prix, capex de décarbonation, efficience technologique, taux d’actualisation. Les obligations de démantèlement et de remise en état, même immatérielles, justifient des explications qualitatives au titre d’IAS 37 lorsque les risques de transition s’accroissent.
Immobilier et infrastructures : résilience physique et durabilité des revenus
L’exposition aux aléas physiques exige des hypothèses de capex d’adaptation, d’assurance, de vacance et de valeurs locatives. Les tests de dépréciation doivent tenir compte des coûts de mise aux normes et des risques d’obsolescence. La désagrégation des actifs par zone, altitude, proximité du littoral ou classification énergétique peut devenir utile selon IFRS 18.
Distribution et biens de consommation : marges et chaînes d’approvisionnement
Les hausses de coûts matières, de transport ou d’énergie, et les changements de préférences clients, peuvent peser sur les marges et la rotation des stocks. Une information sur les hypothèses de prix, d’élasticité et d’efficacité énergétique pourra s’avérer significative, même si aucun test d’impairment n’est déclenché à court terme.
Un scénario utilisé pour le pilotage ESG devient utile à la finance s’il précise : l’horizon temporel par classe d’actifs, les variables prix-clé (carbone, énergie, demande), les points de bascule réglementaires, et la traduction en flux financiers. Plus le lien causal entre variable climatique et agrégat IFRS est explicite, plus l’analyse de sensibilité gagne en crédibilité.
Connecter comptes ifrs et rapports de durabilité : éviter le grand écart
Le cœur du message tient en une phrase : les hypothèses climatiques qui structurent la stratégie doivent irriguer les estimations IFRS. Ce n’est pas une transposition mécanique, mais une cohérence d’ensemble : mêmes horizons, mêmes chocs clés, même ordre de grandeur des impacts attendus.
Alignement méthodologique et documentation
Les équipes financières gagneront à documenter la « piste d’audit » des hypothèses climatiques : sources, versions, arbitragess, justification de l’horizon et articulation avec le plan d’investissement. Une note méthodologique partagée entre finance, risques, stratégie et durabilité évite les incohérences involontaires et facilite les revues d’audit.
Qualité des données et systèmes
La qualité de l’information climatique dépend souvent de données externes hétérogènes. Mieux vaut prioriser les variables déterminantes pour les flux financiers, puis affiner au fil des campagnes de clôture. À terme, la digitalisation des reportings financiers et de durabilité plaidera pour des référentiels communs et des taxonomies de données compatibles.
Checklist direction financière avant clôture
- Valider les scénarios climatiques utilisés et leur cohérence avec la stratégie de transition.
- Mettre à jour les tests IAS 36 pour les actifs sensibles aux prix du carbone et aux capex de décarbonation.- Documenter les hypothèses significatives et les incertitudes de mesure au titre d’IAS 1 ou IFRS 18.
- Revoir les divulgations IFRS 7 sur le risque de crédit et les concentrations liées au climat.
- Examiner les obligations potentielles au regard d’IAS 37, même si l’impact au bilan reste limité.
Les ESRS européens et les normes ISSB poursuivent des objectifs complémentaires. Les exemples IFRS traitent des états financiers : ils n’ajoutent pas de métriques de durabilité, mais précisent comment les risques et hypothèses issus des rapports ESG doivent s’inviter dans les jugements et estimations comptables. L’alignement méthodologique réduit la charge et renforce la crédibilité des deux volets.
Lecture juridique et pratique en france : ce qui relève de l’obligation et de l’illustration
Juridiquement, les exemples publiés par la Fondation IFRS sont des outils pédagogiques. Ils n’ont pas la force d’une norme adoptée par l’Union européenne. Pour autant, ils éclairent l’application de normes déjà en vigueur et servent de référence de place : ne pas s’y conformer n’est pas une infraction, mais l’incohérence avec ces bonnes pratiques devra être justifiée.
Dans les groupes cotés de la place de Paris, l’enjeu est d’autant plus important que les régulateurs et les investisseurs scrutent la cohérence entre messages stratégiques et effets comptables. Les comités d’audit ont ici un rôle pivot : cartographier les zones de jugement, interroger la robustesse des hypothèses climatiques et arbitrer le niveau de désagrégation pertinent pour l’utilisateur.
Ordre des priorités et gouvernance
- Etablir un tronc commun d’hypothèses climatiques validé par la direction générale et tracé pour les états financiers.
- Calibrer les sensibilités pour les postes clé, en privilégiant des fourchettes plutôt que des points uniques.
- Programmer la désagrégation utile sous IFRS 18, sans multiplier les sous-totaux au détriment de la lisibilité.
Le dialogue avec les commissaires aux comptes doit être anticipé : quels scénarios, quelles sources, quels impacts, quels contrôles ? Un échange précoce évite des révisions tardives et facilite la publication d’informations claires, utiles et proportionnées.
Il arrive que l’équipe durabilité utilise trois scénarios ambitieux, quand la finance n’en retient qu’un seul, prudent. La solution : choisir une base commune pour les états IFRS, expliciter les différences d’objectifs et reconcilier les hypothèses clés. Sinon, la divergence sera lue comme une incohérence qui fragilise la crédibilité globale.
Sur le plan de la communication, les entreprises doivent veiller à ne pas transformer les annexes en catalogues d’informations difficilement exploitables. Les exemples IFRS encouragent une information ciblée : focalisée sur les postes où le climat influe vraiment sur la mesure et l’incertitude, étayée de justifications.
Ce que les investisseurs attendent de lire dans les annexes 2025
Les attentes exprimées par les investisseurs sont claires : voir apparaître les zones de vulnérabilité et la manière dont la direction les gère, sans sous-estimer les risques ni exagérer les effets. Trois livrables sont particulièrement scrutés.
Sensibilités chiffrées et fourchettes plausibles
Lorsque la valeur recouvrable est proche de la valeur comptable, toute hypothèse climatique clé mérite une analyse de sensibilité. Il s’agit moins de produire des modèles complexes que d’indiquer des ordres de grandeur et des seuils qui feraient basculer la conclusion de dépréciation.
Trajectoires de coûts carbone et régulation
Les trajectoires retenues pour le prix du carbone, les délais d’application de normes d’émissions ou les clauses sectorielles doivent être explicites. Un récit de durabilité ambitieux sans traduction dans ces hypothèses financières créerait un écart de crédibilité.
Granularité pertinente, pas la déferlante
La désagrégation doit améliorer la compréhension : par secteurs, géographies ou technologies significatives pour l’entreprise. IFRS 18 légitime cette granularité dès lors qu’elle éclaire le risque et la performance, avec une présentation soignée pour ne pas diluer l’information dans la complexité.
Deux repères de place
Le signal de la Fondation IFRS (24 juillet 2025) et sa reprise par la presse spécialisée confirment l’usage attendu de ces exemples dans les clôtures à venir (sources presse 12 août 2025 et 25 juillet 2025). À défaut d’obligation nouvelle, l’effet de référentiel s’installera : les entreprises françaises qui s’y alignent offriront une lisibilité accrue.
Des effets concrets sur les processus : contrôles internes, données et rôle du comité d’audit
Traduire le climat dans les comptes implique des processus et contrôles structurés. Le comité d’audit devra vérifier que la documentation des hypothèses climatiques et des sensibilités IFRS suit un cycle robuste : choix des hypothèses, validation, calcul, revues, archivage des sources.
Données, modèles et hiérarchie documentaire
Un référentiel d’hypothèses climatiques peut être géré comme une bibliothèque centrale : variables clés, versions datées, sources. Les modèles de tests IAS 36 et les matrices de risque IFRS 7 en tirent les paramètres de manière contrôlée. La hiérarchie des documents doit s’assurer que l’on sait qui décide, qui valide et qui met à jour.
Réalignage budgétaire et impacts sur kpi
La planification budgétaire et le suivi des KPI devraient être réconciliés avec les hypothèses de transition. Les indicateurs internes de performance carbone aident à prioriser les capex et à hiérarchiser les sensibilités annuelles pertinentes pour les états financiers.
1. L’information aide-t-elle à comprendre un jugement clé ou une incertitude majeure ?
2. Est-elle cohérente avec les scénarios de durabilité publiés ?
3. Le lecteur peut-il identifier un seuil qui changerait la conclusion comptable ? Si les trois réponses sont positives, la divulgation est probablement utile et proportionnée.
Un coup d’accélérateur utile avant la finalisation d’octobre 2025
La publication de la Fondation IFRS clarifie le « comment faire » pour intégrer le climat dans les comptes : matérialité assumée, hypothèses explicites, sensibilités chiffrées et désagrégation ciblée. Les directions financières françaises disposent désormais d’un appui crédible pour resserrer le lien entre stratégie climat, risques et mesures IFRS.
À défaut d’imposer une règle nouvelle, ces exemples installent une discipline de preuve : si le climat compte dans la stratégie, il doit se lire dans les hypothèses des états financiers et dans la clarté des annexes.