Le Sénat assure la stabilité fiscale pour les microentreprises en 2025
Découvrez les conséquences de l'abrogation de la réforme de TVA sur les microentreprises et TPE pour 2025, avec des seuils maintenus.
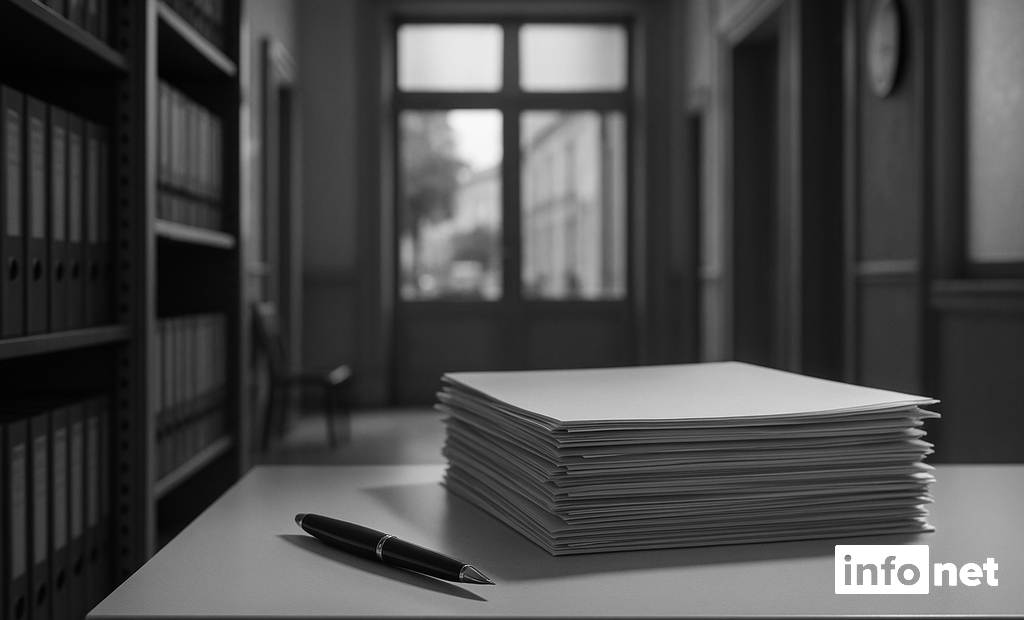
23 octobre 2025, au Palais du Luxembourg, les sénateurs ont tranché. À l’unanimité, le Sénat a confirmé l’abrogation de la réforme de TVA inscrite dans la loi de finances 2025, rétablissant un cap de stabilité pour les microentreprises et TPE. L’enjeu est immédiat pour des centaines de milliers d’indépendants qui conservent la franchise en base aux seuils connus, sans bascule administrative brutale.
Vote du Sénat : cap sur la stabilité fiscale des microentreprises
La proposition de loi adoptée à l’unanimité le 23 octobre 2025 met un coup d’arrêt à un projet de refonte jugé trop abrupt par l’écosystème entrepreneurial. Le texte, rapporté par plusieurs médias économiques, confirme la volonté de sécuriser un cadre lisible pour 2025 et au-delà, en maintenant des seuils d’exonération de TVA connus des professionnels.
Concrètement, la franchise en base de TVA est préservée. Elle permet aux structures dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un plafond de ne pas facturer la taxe à leurs clients, et corrélativement de ne pas la déclarer. La simplification qui en découle reste un pilier du régime micro-entrepreneur, particulièrement scruté pour sa contribution à la création d’activité et à l’emploi local.
Ce qu’il faut retenir pour 2025
Le Sénat a validé le maintien des seuils de franchise en base de TVA. Les plafonds confirmés sont les suivants : 37 500 euros pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités de commerce de biens. La bascule envisagée à 25 000 euros est annulée.
Seuils de franchise en base de TVA : ce qui s’applique après l’abrogation
La proposition de loi stabilise les plafonds à des niveaux jugés praticables par les professionnels. Deux seuils s’imposent désormais dans la lecture opérationnelle des entrepreneurs :
- Prestations de services : 37 500 euros de chiffre d’affaires annuel.
- Commerce de biens : 85 000 euros de chiffre d’affaires annuel.
Ces montants évitent une révision jugée trop pénalisante par rapport aux repères précédents, souvent cités à 36 800 euros pour les services et 85 800 euros pour les ventes de biens. Pour les dirigeants, l’enjeu est double : prévisibilité des seuils et maîtrise de l’effort administratif. Un cadre balisé encourage une planification plus fine des contrats et évite des bascules inopinées vers la collecte de la TVA en cours d’exercice.
La franchise en base s’applique si le chiffre d’affaires encaissé sur 12 mois glissants reste sous les seuils applicables. L’entreprise ne facture pas la TVA à ses clients et n’a pas à déposer de déclaration de TVA. En contrepartie, elle ne peut pas récupérer la TVA sur ses achats. Un suivi mensuel du chiffre d’affaires encaissé est recommandé pour détecter tout risque de dépassement et anticiper les conséquences contractuelles.
Prestations de services : ligne de flottaison à 37 500 euros
Pour les professions de services — conseil, IT, communication, formation, métiers de la création — la barre à 37 500 euros sécurise une montée en puissance progressive sans complexifier immédiatement la facturation. L’effet prix demeure clé : la facturation hors TVA peut constituer un argument commercial dans les segments B2C sensibles au tarif facial.
Commerce de biens : 85 000 euros, un seuil structurant pour la trésorerie
Pour le négoce et la fourniture de logement, le plafond à 85 000 euros contribue à préserver un modèle de marge souvent contraint par l’inflation d’achat et les tensions logistiques. Dans ces activités, une entrée précoce dans la TVA peut s’avérer neutre si l’amont comporte beaucoup de TVA déductible, mais elle impose un pilotage de trésorerie plus fin pour le reversement périodique.
Pourquoi la réforme initiale a été retirée : enjeux économiques et juridiques
La réforme annulée portait une ambition d’harmonisation autour d’un seuil unique de 25 000 euros. L’objectif affiché était de réduire les écarts de traitement entre petites structures exonérées et entreprises soumises à la TVA, afin de limiter des distorsions concurrentielles.
Cette approche a rencontré une opposition nourrie des réseaux d’indépendants. Plusieurs arguments ont été documentés par la presse économique et les publications spécialisées :
- Un seuil unique jugé trop bas au regard des réalités sectorielles.
- Des coûts d’adaptation jugés disproportionnés en cours d’année, notamment pour les outils de facturation et la formation aux obligations déclaratives.
- Un risque de frein à l’entrée dans l’entrepreneuriat, au détriment de la dynamique des territoires.
Un seuil à 25 000 euros : portée pratique et critiques récurrentes
La bascule envisagée aurait imposé la TVA à des profils aujourd’hui protégés par la franchise en base. Des représentants de TPE ont évoqué publiquement l’impact prix, pointant une réduction de compétitivité face à une clientèle grand public peu sensible à la TVA déductible. Selon des estimations relayées par la presse économique, environ 200 000 entrepreneurs auraient été concernés par un passage anticipé à la TVA si le seuil de 25 000 euros avait été retenu.
Effets économiques anticipés d’un abaissement
Trois mécanismes d’impact étaient redoutés par les organisations d’indépendants :
- Transmission de la TVA au client sur les prestations B2C, avec baisse potentielle de volume.
- Complexification administrative immédiate pour des structures sans service comptable.
- Réduction de l’attractivité du régime micro, susceptible de ralentir les immatriculations.
Calendrier législatif et modalités de promulgation
L’adoption au Sénat ouvre la voie à une promulgation rapide, en l’absence d’annonce de saisine du Conseil constitutionnel. La règle de délai maximum de 15 jours est rappelée par les praticiens du droit public. Les entrepreneurs peuvent donc se projeter sur 2025 avec ces seuils sans revoir à la hâte leur organisation de facturation.
Reste l’exécution concrète. Les obligations demeurent claires en cas de dépassement des seuils :
- Perte de la franchise et bascule dans le régime de TVA.
- Déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles.
- Application du taux normal de 20 % en France métropolitaine, sauf cas spécifiques.
Pour les micro-entrepreneurs, il est recommandé de suivre le chiffre d’affaires encaissé sur 12 mois glissants et d’arbitrer le moment opportun entre maintien en franchise et option pour le réel afin de récupérer la TVA sur des investissements significatifs, lorsque c’est pertinent (impots.gouv.fr).
Pour sécuriser l’exercice :
- Vérifier mensuellement le cumul de chiffre d’affaires encaissé.
- Paramétrer les logiciels de facturation pour bascule rapide, si nécessaire.
- Documenter le choix de rester en franchise ou d’opter pour le réel.
- Informer les clients en amont en cas de changement de régime pour éviter les litiges sur les prix TTC.
Effets microéconomiques et sectoriels : respiration pour les TPE et indépendants
La décision parlementaire est saluée comme un signal de stabilité. Les activités les plus intensives en main-d’œuvre, comme les prestations intellectuelles et une partie du bâtiment, bénéficient directement de l’évitement d’une bascule anticipée dans la TVA. Les marges souvent étroites se trouvent préservées d’un choc administratif et commercial.
Sur le plan macro-sectoriel, plusieurs repères structurent l’analyse :
- Les microentreprises représentent environ 95 % du tissu entrepreneurial en France.
- Elles génèrent plus de 150 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé annuel.
Ces ordres de grandeur rappellent le rôle systémique du segment micro-TPE dans l’activité et l’emploi local, et l’intérêt d’un cadre prévisible pour éviter les à-coups sur l’investissement et l’embauche (INSEE).
Services et bâtiment : souffle court, bénéfice immédiat
Dans les services, l’avantage est direct pour les indépendants opérant en B2C : prix affichés sans TVA, lisibilité commerciale préservée, pas d’alourdissement des processus de facturation. Dans le bâtiment, la maîtrise des seuils stabilise la relation avec les particuliers, sensible aux devis TTC, et évite une cascade de révisions contractuelles.
Arbitrage économique : franchise versus option pour le réel
Le maintien de la franchise n’est pas toujours optimal. D’un point de vue strictement économique, une structure avec des achats significatifs et une montée en charge d’investissements peut trouver un intérêt à opter pour le réel pour récupérer la TVA. L’analyse doit intégrer le niveau de dépenses taxées, la sensibilité prix de la clientèle et la capacité à absorber les obligations déclaratives.
Points de vigilance comptable pour rester en franchise
À surveiller de près :
- Cumul d’encaissements sur 12 mois, pas sur l’année civile uniquement.
- Facturation sans mention de TVA, avec la formule requise indiquant l’exonération.
- Attention aux acquisitions intracommunautaires et ventes à distance, qui obéissent à des règles spécifiques.
2026 en débat : un seuil unique à 37 500 euros à l’étude, avec une exception bâtiment
Le sujet n’est pas clos au plan législatif. Le projet de loi de finances pour 2026, en cours de discussion, remet la question de l’harmonisation à l’agenda. L’article 25 propose d’instaurer un seuil unique à 37 500 euros pour l’ensemble des activités dès le 1er janvier 2026, avec une exception à 25 000 euros pour les indépendants du secteur du bâtiment.
L’exécutif met en avant des arguments de lisibilité des contrôles et de réduction de la complexité liée à la coexistence de plusieurs seuils. Plusieurs parlementaires ont toutefois exprimé des réserves sur l’effet prix et l’emploi dans les TPE, alors que l’équilibre des très petites structures reste fragile.
Secteur du bâtiment : pourquoi une exception à 25 000 euros
L’exception proposée pour le bâtiment vise à répondre à des enjeux de lutte contre la fraude et à mieux encadrer la chaîne de sous-traitance. Pour les artisans concernés, un seuil distinct aurait un impact direct sur la facturation des chantiers, en particulier auprès des particuliers. La mesure, si elle était retenue, impliquerait un accompagnement rapide sur les logiciels, les devis et les provisions de trésorerie.
Harmonisation et contrôles : le point de vue des pouvoirs publics
Du côté gouvernemental, l’harmonisation est présentée comme un levier de pilotage fiscal et de réduction des frictions administratives. Le débat parlementaire a fait émerger l’idée que cette consolidation pourrait contribuer à des recettes supplémentaires notables pour l’État si elle élargissait mécaniquement la base taxable. Les élus ont toutefois posé des garde-fous sur l’impact compétitif des TPE, pointant le risque d’un choc tarifaire pour une clientèle de particuliers.
Pour les ventes à distance intracommunautaires, un seuil harmonisé de 10 000 euros s’applique au sein de l’UE. Au-delà, la TVA devient due dans l’État membre de consommation, avec la possibilité d’utiliser le guichet OSS. Cette règle coexiste avec la franchise en base française. Les entreprises réalisant des ventes cross-border doivent donc articuler ces deux dimensions pour éviter non-conformités et redressements.
Cadre pratique : obligations si les seuils sont dépassés
Si le seuil applicable est franchi, l’entreprise devient redevable de la TVA. Les principaux réflexes opérationnels à mettre en œuvre sont connus :
- Basculer la facturation au TTC avec mention du taux et du montant de TVA collectée.
- Choisir la périodicité déclarative adaptée à la saisonnalité des encaissements.
- Mettre à jour les conditions générales de vente pour intégrer le régime TVA et les ajustements de prix.
- Anticiper la trésorerie liée aux échéances déclaratives et au reversement de la taxe.
L’administration fiscale rappelle que l’entrée dans le champ de la TVA ouvre simultanément le droit à déduction sur les dépenses éligibles. Cet équilibre collecte-déduction doit être suivi mensuellement pour éviter des écarts entre la TVA déclarée et la TVA effectivement due.
Approche en trois étapes :
- Identifier la catégorie dominante d’activité : services ou commerce de biens.
- Mesurer le chiffre d’affaires encaissé sur les 12 derniers mois glissants, pas seulement sur l’année civile.
- Comparer au seuil correspondant. En cas de dépassement, basculer immédiatement la facturation et initier les démarches déclaratives.
En cas de doute, l’arbitrage entre maintien en franchise et option pour le réel s’effectue en confrontant le profil de dépenses taxées à la sensibilité prix des clients.
Que change la stabilité des seuils pour la négociation commerciale
La prévisibilité retrouvée réduit les risques de révision tarifaire en cours d’exercice. Les dirigeants peuvent sécuriser des contrats pluriannuels en maîtrisant l’exposition au franchissement des seuils. Dans les secteurs B2C, l’absence de TVA à facturer demeure un avantage compétitif tant que les seuils ne sont pas dépassés.
Tissu entrepreneurial : signaux macro et ancrage terrain
La décision du Sénat s’inscrit dans une configuration où le nombre de microentreprises a progressé, avec un filet de sécurité attendu par les réseaux d’accompagnement. La lecture des tendances met en perspective le poids structurel du régime micro, son rôle de tremplin et son effet de diversification économique dans les territoires.
Des données publiques signalent une montée des dynamiques entrepreneuriales. Un chiffre souvent cité illustre cette tendance : une progression de l’ordre de 10 % du nombre de microentreprises entre 2023 et 2024. Le maintien de seuils élevés agit donc comme un incitatif à l’initiative, au moment où l’inflation et la hausse des coûts énergétiques ont déjà rogné les marges de manœuvre de nombreuses TPE.
Communication des entrepreneurs : soulagement prudent
Sur les réseaux sociaux, de nombreux professionnels expriment un sentiment de relâchement, tout en s’interrogeant sur la trajectoire 2026. La ligne de crête est claire : préserver la simplicité opérationnelle, sans affaiblir la base fiscale. Ce débat ciblé sur la franchise en base de TVA devient un marqueur de l’équilibre entre compétitivité des TPE et capacité de contrôle des finances publiques.
Chiffres clés macro à garder en tête
Le segment micro-TPE pèse lourd :
- Près de 95 % des entreprises en France sont des microentreprises.
- Plus de 150 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé annuel.
- Un régime micro qui a concentré une part élevée des nouvelles immatriculations en 2024.
Cap 2026 : arbitrages à surveiller pour les dirigeants
À court terme, la trajectoire est clarifiée pour 2025. À moyen terme, la discussion budgétaire 2026 porte des inflexions possibles : seuil unique pour toutes les activités et exception bâtiment, avec des conséquences directes sur la facturation, la trésorerie et l’organisation administrative des plus petites structures.
Les dirigeants ont intérêt à anticiper plusieurs scénarios en modélisant leur flux d’encaissements, leur structure de coûts et la sensibilité TVA de leur portefeuille clients. En parallèle, la consultation des ressources officielles demeure essentielle pour ajuster finement le régime fiscal choisi et sécuriser la conformité, notamment en cas de ventes intracommunautaires et de croissance rapide des volumes.
La stabilité l’emporte pour 2025, mais l’équation de 2026 reste à résoudre avec méthode et sang-froid.