81e bulletin de conjoncture Bpifrance Le Lab pour les TPE-PME
Les résultats du 81e bulletin Bpifrance Le Lab sur 4 700 TPE-PME : analyse des perspectives 2025, secteurs clés, trésorerie et investissements.
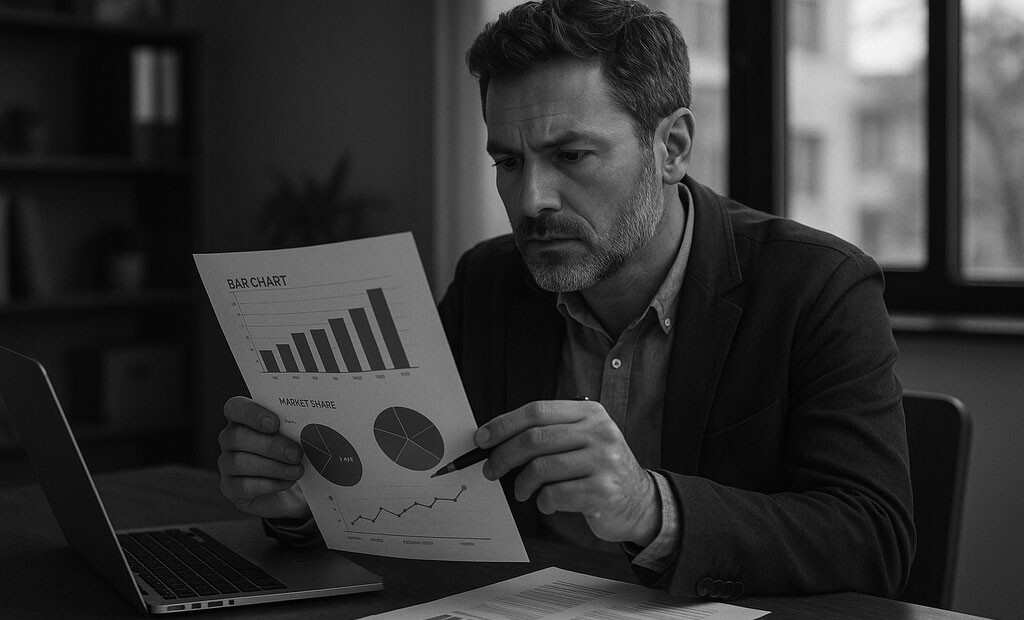
Bpifrance Le Lab vient de dévoiler son 81e bulletin de conjoncture portant sur plus de 4 700 TPE et PME françaises. Les conclusions révèlent un champ d’espoirs timides pour 2025, malgré une défiance persistante dans de nombreux pans de l’économie. Entre opportunités, incertitudes et retours chiffrés, voici un panorama détaillé.
Des attentes économiques en demi-teinte
Le rapport montre que l’embellie n’est que partielle. Le solde d’opinion lié au chiffre d’affaires, quoique légèrement redressé par rapport à l’automne précédent, pointe encore un niveau négatif à -4. C’est une progression de deux points en l’espace de six mois, mais on reste significativement en dessous de la moyenne historique, évaluée à environ +14 pour ces catégories d’entreprise.
Selon certains dirigeants, la hausse ne pourrait provenir que d’une demande intérieure légèrement plus solide en fin d’année, couplée à l’assouplissement de certaines contraintes d’approvisionnement. Sur le plan de l’emploi, le solde d’opinion remonte de trois points (toujours en territoire modeste), témoignant d’une création de postes mesurée dans les prochains mois. Ici encore, le retard accumulé en 2024 semble difficile à rattraper.
Le secteur des TPE-PME demeure hétérogène : les TPE affichent des pronostics d’activité plus faibles, tandis que les PME supérieures à 100 salariés anticipent une croissance plus dynamique. Les entreprises tournées vers l’international et celles valorisant l’innovation se dégagent également du lot, avec un solde d’opinion un peu plus optimiste quant à leur chiffre d’affaires.
Dans les enquêtes économiques, le solde d’opinion se définit comme la différence entre le pourcentage de répondants exprimant une hausse et celui exprimant une baisse. Un solde positif indique une majorité d’avis favorables, tandis qu’un solde négatif reflète une majorité d’opinions défavorables.
En résumé, ces premiers éléments laissent entrevoir plusieurs facettes : une reprise est bien là, mais son ampleur et sa durabilité sont contestables. Au cœur de la prudence figurent surtout la demande française et la poursuite de soutiens financiers, lesquels conditionnent la confiance des entreprises pour l’avenir. Les dirigeants avertissent que l’année 2025 n’apportera sans doute pas un rebond spectaculaire, même si certains signaux colorent le paysage d’espoir.
La dimension sectorielle : où se trouvent les fragilités ?
D’après les chiffres recueillis, l’Industrie et le Commerce se stabilisent quelque peu, sans pour autant effacer leurs difficultés passées. Le Tourisme, la Construction et les Transports paraissent plus affectés : la baisse de la fréquentation touristique dans certaines régions, la difficulté de trouver de nouveaux chantiers et les problématiques logistiques persistent. Il s’agit donc de secteurs très touchés par une demande fluctuante, avec d’authentiques incertitudes quant aux financements.
Dans le Tourisme, le mouvement de reprise affiché en 2024 s’essouffle : on enregistre un solde d’opinion en baisse plus marquée qu’ailleurs. La Construction, en décalage depuis déjà quelques semestres, voit ses carnets de commandes manquer de consistance. La fragilité du secteur pavillonnaire et la hausse des coûts de matériaux sont souvent mises en avant par les professionnels pour justifier leurs réticences à investir davantage.
Les Services, en revanche, conservent un niveau d’optimisme relatif. Bien que n’étant pas au plus haut, certains sous-segments (services aux personnes, bureaux d’études, conseils) trouvent leur rythme. On note même quelques niches en pleine expansion numérique. Par ailleurs, l’économie verte et la transition énergétique apparaissent comme des segments porteurs dans les services.
Repère historique sur Bpifrance Le Lab
Bpifrance Le Lab est un lieu d’analyse et de prospective géré par Bpifrance. Il s’est imposé comme une plateforme d’études et d’échanges à destination des entrepreneurs. Ses enquêtes de conjoncture, dont on parle ici pour la 81e édition, fournissent des données indispensables pour éclairer les choix stratégiques des acteurs de la TPE-PME en France.
Au plan régional, les TPE-PME de Normandie se montrent un peu plus enclines à parier sur un regain d’activité, alors que celles des Hauts-de-France manifestent un très grand attentisme. On évoque parfois la proximité de grands bassins d’emplois et la dynamique industrielle de certains pôles pour expliquer les nuances observées.
État de la trésorerie : entre stabilité et nuances
Autre point crucial pour ces entreprises : la trésorerie. Selon l’enquête, la situation financière globale s’est figée à un niveau proche de la moyenne historique. Un solde d’opinion de -15 rappelle cependant que de nombreuses sociétés subissent des tensions de liquidités et scrutent la moindre fluctuation de leur encaisse. Mais comparé à la série longue, ce niveau reste dans la norme, signe de résilience dans le secteur.
D’un côté, certaines TPE-PME, notamment celles de l’Industrie, font état de tensions persistantes. Entre la baisse de leurs marges et l’augmentation des coûts variables, peu de marges de manœuvre subsistent sans apports de capitaux externes. Chez les TPE, en particulier, l’inquiétude demeure plus forte concernant le renouvellement de leurs crédits de fonctionnement.
D’un autre côté, la perspective d’évolution pour fin 2025 se situe à un niveau modéré, avec un solde d’opinion qui s’améliore de six points par rapport au semestre précédent. Néanmoins, ce score demeure sous la moyenne historique d’environ six points. Les experts notent donc que la stabilisation est loin de préfigurer une accélération.
Dans la trésorerie d’une entreprise, il est essentiel de distinguer :
- Le besoin en fonds de roulement (BFR) ;
- L’excédent de trésorerie dégagé ;
- Les crédits de court terme pour l’exploitation.
Un bon pilotage financier nécessite de surveiller ces paramètres afin de pallier les risques de rupture de liquidités.
La hausse des taux d’intérêt, amorcée depuis 2022, n’a pas anéanti – pour l’instant – la possibilité de se financer, même si certains chefs d’entreprise jugent l’accès au crédit plus difficile. Les différences peuvent s’expliquer par la taille de la structure : les plus grandes PME disposent généralement d’un réseau bancaire plus étoffé, facilitant l’obtention de conditions moins coûteuses.
L’ombre d’une rentabilité en retrait
L’étude pointe une poursuite de la dégradation de la rentabilité, après un tassement notable en 2024. Le solde d’opinion ressort à -7, soit neuf points en dessous de la moyenne historique de long terme. Les TPE-PME du Tourisme tirent la sonnette d’alarme avec une performance fortement écornée : la baisse de fréquentation et la hausse des charges d’exploitation finissent par ronger la profitabilité. Les Transports affichent un léger mieux, plus par rapport à la situation de l’an dernier, particulièrement fragile, que par un véritable redressement.
D’une manière globale, les entreprises subissent plusieurs facteurs négatifs :
- La montée des coûts énergétiques pesant sur les marges ;
- Une pression concurrentielle pour les TPE en particulier et une moindre capacité à répercuter les surcoûts sur les prix finaux ;
- L’environnement incertain des marchés mondiaux, qui indulge une attente préventive ;
- Des tensions salariales plus prononcées, sans revalorisation de tarifs corrélative.
Pour 2025, la poursuite d’un équilibre positif dépendra de la capacité des entreprises à innover, à investir, voire à externaliser des charges. Les experts signalent que la digitalisation et l’adoption de processus automatisés demeurent un levier pour préserver la rentabilité. Dans la pratique, beaucoup de TPE doivent encore s’équiper pour franchir ce cap en termes d’organisation interne.
Cap sur l’investissement : résistance ou recul ?
Malgré un accès conservé aux financements, on note un repli dans les intentions d’investissement. Le rapport indique que 38 % des entreprises sondées investiront cette année, contre 43 % en 2024. Par rapport à l’avant-crise, on s’éloigne de taux habituels avoisinant la moitié des répondants. Ce fléchissement se ressent dans presque tous les secteurs, y compris l’Industrie où 52 % des TPE-PME entendent investir (contre 58 % en moyenne de longue période).
La demande affaiblie reste un obstacle majeur, cité par 60 % des TPE-PME. Les dirigeants hésitent à se lancer dans des projets de développement tant qu’ils ne sont pas certains de pouvoir rentabiliser leurs nouvelles capacités de production. D’un autre point de vue, l’incertitude commerciale et budgétaire pèse également. Aucun plan de relance majeur n’est venu booster la confiance depuis le second semestre 2024, renforçant la prudence ambiante.
Le coût du crédit demeure un frein fréquemment mentionné (41 %), même si depuis quelques mois on observe un léger mieux du fait d’un ralentissement dans l’augmentation des taux. La demande accrue de fonds propres pour accéder aux prêts complique aussi la donne pour les plus petites structures non adossées à un groupe.
Déployer de nouveaux équipements sobres en énergie, moderniser ses process ou entamer une transition écologique : on parle d’investissement vert. Cette dimension devient de plus en plus stratégique, car les normes environnementales et sociales gagnent en importance, et peuvent favoriser l’accès à certains financements ciblés.
Concernant les investissements verts en particulier, l’enquête souligne une évolution contrastée. Après un rebond notable en 2024, le taux de TPE-PME prévoyant d’allouer des budgets à la transition écologique se stabilise. Les entreprises semblant déjà engagées dans la TEE (transition énergétique et écologique) confirment qu’elles maintiendront leurs dépenses. D’autres, en revanche, reportent leurs projets, faute de marges financières suffisantes.
PGE : où en est le remboursement ?
Le Prêt Garanti par l’État (PGE) a joué un rôle primordial au cours des dernières années, permettant de maintenir la trésorerie des entreprises fragilisées. Cette étude révèle que 47 % des TPE-PME concernées auront entièrement remboursé leur PGE d’ici la fin de 2025. On note donc une augmentation notable depuis les estimations précédentes, liée à l’arrivée à échéance d’une partie de ces financements.
La proportion de TPE-PME encore en difficulté à ce sujet reste stable, à hauteur de 4 %. On observe un enjeu pour les entreprises du Tourisme qui, ayant souvent davantage recouru à ces prêts, voient la consommation des PGE grimper à 79 % (sur la base de l’enquête), preuve de leur intense utilisation. Néanmoins, beaucoup de ces acteurs touristiques signalent une crainte quant à la soutenabilité de leur remboursement si la (relative) baisse de fréquentation se prolonge au-delà de 2025.
D’une manière globale, le climat autour du PGE reste moins tendu que l’an dernier, puisque la majorité des entreprises qui l’avaient sollicité sont parvenues à se structurer ou à adapter leurs plans de financement. Par ailleurs, l’arrivée d’échéances massives en 2026 incite un nombre accru de sociétés à solder leur dû dès cette année, lorsque leur trésorerie le permet.
Bon à savoir sur le PGE
Le PGE a été instauré en mars 2020 pour préserver la trésorerie des entreprises face aux effets de la crise sanitaire. Il bénéficie d’une garantie de l’État pouvant aller jusqu’à 90 % du montant prêté. Bien que très efficace pour soutenir l’activité, sa gestion et son remboursement constituent un véritable défi pour les structures les plus vulnérables.
Sur le plan des dispositifs de refinancement, plusieurs banques cherchent à négocier des atermoiements ou des recalibrages auprès des TPE-PME en signant des avenants à ces prêts. Cependant, la charge administrative peut dissuader certaines structures de se lancer dans ces démarches, entre craintes de refus et complexité de la paperasse.
Emplois créés, emplois à créer : quelles dynamiques ?
En ce qui concerne l’embauche, on retrouve un discret regain. Le solde d’opinion, qui avait sérieusement reculé l’an dernier, progresse de trois points sur six mois. Les TPE-PME demeurent toutefois prudentes puisque le niveau global demeure à six points au-dessous de sa moyenne de longue période. Pour certains employeurs, l’enjeu se situe davantage dans le renouvellement de postes vacants que dans la création nette d’emplois.
L’enquête révèle que « des carnets de commandes peu fournis » et des perspectives de croissance modestes constituent les deux plus grands obstacles à l’embauche. Même si la tension sur le marché du travail persiste dans plusieurs secteurs, la prudence prévaut. La raréfaction de talents dans certains métiers techniques (maintenance industrielle, informatique, logistique) représente toujours une problématique, mais le recul des difficultés de recrutement (27 % indiquent être freinées fortement, contre encore 31 % un an avant) s’explique par un léger repli de la demande globale de main-d’œuvre.
Par ailleurs, les PME d’au moins 100 salariés se démarquent nettement avec une dynamique de recrutement plus affirmée. Elles disposent de moyens pour formaliser des parcours d’accompagnement, et bénéficient fréquemment d’une image plus attractive sur le marché de l’emploi. Les TPE, plus vulnérables aux aléas, conservent certaines incertitudes liées à leur chiffre d’affaires, ce qui se reflète dans des politiques de ressources humaines plus frileuses.
Regards vers 2026 : prudence maintenue
Les chefs d’entreprise interrogés restent généralement sur la réserve lorsqu’on parle de leurs perspectives pour 2026. L’indicateur prévisionnel d’activité, mentionné à +16, recule de trois points en un an, se positionnant 12 points en deçà de la tendance de long terme. Dans le Tourisme, la chute de 14 points (amenant l’indicateur à -1) porte un sentiment d’alerte sur la facilité de reprise, tandis que dans la Construction, la conjoncture demeure mal orientée.
En revanche, certains secteurs conservent une meilleure posture : l’Industrie et les Services alimentent encore des espoirs de croissance plus marqués, même si ces espoirs diminuent par rapport à l’an dernier. Les industriels restent volontiers sur des stratégies de reconquête, misant sur une éventuelle amélioration de la conjoncture internationale.
Côté embauche, la projection pour 2026 reflète un ralentissement probable, avec un solde d’opinion à +11, soit une baisse de cinq points en un an. Certains observateurs y voient le reflet d’un modèle de développement majoritairement fondé sur la stabilisation plutôt que l’expansion. Il existe donc un possible scénario d’intégration progressive de nouvelles technologies pour optimiser les équipes existantes, plutôt que d’augmenter massivement leurs effectifs.
Points clés à retenir : opportunités et défis
Au-delà des chiffres, plusieurs enjeux majeurs s’imposent. Les TPE-PME recherchent l’équilibre entre la prudence et le besoin de s’adapter à un environnement en pleine transformation (réglementation, concurrence, évolution des goûts et modes de consommation). L’innovation, l’export et la « transition verte » apparaissent comme des options de différenciation stratégique.
Une PME innovante sur le plan technologique ou organisationnel dispose habituellement de plus fortes capacités d’adaptation. Ce concept peut concerner :
- La création de nouveaux produits ou services ;
- L’amélioration de processus internes ;
- L’investissement dans la recherche et développement ;
- L’implémentation de solutions numériques avancées.
Ce levier se révèle souvent déterminant dans l’essor d’une entreprise confrontée à un marché volatil.
La question de la modernisation numérique est un autre aspect que beaucoup d’intervenants soulignent : elle permet de rationaliser les coûts, d’améliorer la productivité et de toucher un public élargi via le e-commerce ou la promotion en ligne. Pour les TPE-PME exportatrices, l’accès à des marchés étrangers permet de diversifier les risques, mais reste sensible aux stratégies de change, aux barrières douanières et aux aléas géopolitiques.
En clair, le pilotage et l’anticipation deviennent incontournables pour limiter l’effet négatif des aléas : planifier ses investissements, s’assurer de la solidité de sa trésorerie, ajuster ses équipes. Les entrepreneurs avisés y voient même l’occasion de se réinventer en s’appuyant sur les atouts de la transition numérique, énergétique et écologique.
Un éclairage juridique pour les TPE-PME
Du point de vue légal, différents dispositifs d’aide peuvent encourager ou freiner la dynamique de croissance. Le Créditherme (orientation de financements vers l’efficacité énergétique des bâtiments), le déploiement de solutions d’aménagement du temps de travail ou encore l’amplification de certains crédits d’impôt R&D figurent parmi les paramètres à surveiller.
En parallèle, la gestion des litiges et la sécurisation des contrats d’approvisionnement émergent comme de nouveaux enjeux centraux. Les TPE-PME françaises sont souvent plus vulnérables aux retards de paiement ou aux ruptures de contrats. Dès lors, une attention soutenue au cadre légal et à la rédaction solide de conventions peut éviter des défaillances coûteuses. Par ailleurs, la fin de certains avantages tarifaires sur l’énergie appelle souvent à rediscuter les clauses contractuelles avec leurs fournisseurs.
Le "qui est qui ?" de Bpifrance
Bpifrance (Banque Publique d’Investissement) est une entité créée pour soutenir le financement et le développement des entreprises françaises. Quant au Lab, il s’agit d’un échelon de recherche et d’analyse qui propose aux chefs d’entreprise des études, des livres blancs et des réflexions prospectives partout en France.
Les cabinets juridiques spécialisés dans l’accompagnement des PME remarquent d’ailleurs une hausse significative de missions orientées sur la rédaction de pactes d’actionnaires ou de pactes d’associés, signe d’un besoin accru de sécuriser la gouvernance interne. Cette évolution trouve racine dans la volonté des dirigeants d’anticiper d’éventuels conflits et de clarifier la répartition du capital lorsque les perspectives de financement se concrétisent.
Au final, le volet légal se révèle de plus en plus stratégique : un contrat bien ficelé, une politique managériale conforme aux règles en vigueur et le respect des obligations sociales peuvent offrir de véritables boucliers face aux épreuves économiques. Les levées de fonds, les fusions-acquisitions, ou encore la mise en place de garanties sur des actifs sont devenues des leviers usuels pour consolider la structure financière et juridique de l’entreprise.
Stratégies pour aller de l’avant : pistes de réflexion
Face à un climat d’attentisme, plusieurs lignes de conduite peuvent être envisagées par les TPE-PME :
- Renforcer la digitalisation de l’exploitation et de la relation client, afin d’amortir plus facilement d’éventuels chocs conjoncturels ;
- Mettre en place des plans d’action à moyen terme pour inciter les salariés à développer leurs compétences, notamment dans le secteur industriel et l’innovation ;
- Envisager des partenariats ou même des mutualisations de moyens (partage d’unité logistique, de matériel de production, etc.) pour réduire les coûts ;
- Maintenir une vigilance juridique sur la qualité des contrats, en particulier dans la chaîne d’approvisionnement et au plan social ;
- Anticiper le prochain remboursement du PGE en discutant tôt avec les partenaires bancaires pour éviter toute impasse de trésorerie.
Parmi ces axes, la plupart dépendent de la confiance des entrepreneurs. Celle-ci est encore loin d’être pleinement rétablie, mais l’enquête souligne que les grandes PME ou les TPE-PME exportatrices et innovantes font office de locomotive pour relancer la confiance globale. Si la situation économique française et européenne reste favorable, ces configurations pionnières pourraient entraîner à leur suite nombre de TPE-PME actuellement en retrait.
On note enfin l’importance de la coopération interprofessionnelle. Bon nombre d’entreprises s’engagent dans des groupements ou clubs d’affaires pour échanger sur les bonnes pratiques, partager des retours d’expérience et élargir leur réseau de prospection. Cette dynamique collaborative est largement encouragée par les chambres de commerce et d’industrie.
Un horizon à scruter de près
Dans ce vaste panorama, le 81e rapport de conjoncture de Bpifrance Le Lab dessine les grandes orientations d’une reprise encore timide, mais que certains considèrent comme réaliste et ancrée dans la prudence. Les TPE-PME françaises se redressent peu à peu sans retrouver l’ensemble de leur vitalité passée, tandis que la rentabilité reste placée sous pression et que les programmes d’investissement piétinent.
Les prochains semestres seront cruciaux. D’un côté, la consolidation du marché intérieur français et la préservation de l’accès au crédit pourraient stimuler la croissance du chiffre d’affaires. De l’autre, la montée des coûts, la volatilité internationale, la prudence des consommateurs et les interrogations sur la rentabilité forment un ensemble de contraintes qui étouffent une partie de l’élan.
À l’aune de ces éléments, ce panorama de la conjoncture invite les acteurs économiques, financeurs et pouvoirs publics à maintenir un climat de confiance, tout en diversifiant les leviers d’action pour soutenir durablement les TPE-PME dans leur quête de stabilité.