La modernisation de l’ILL renforce la recherche à Grenoble
Découvrez comment l’Institut Laue-Langevin modernise ses instruments avec 3 millions d'euros pour un impact sur la biologie et l'énergie.
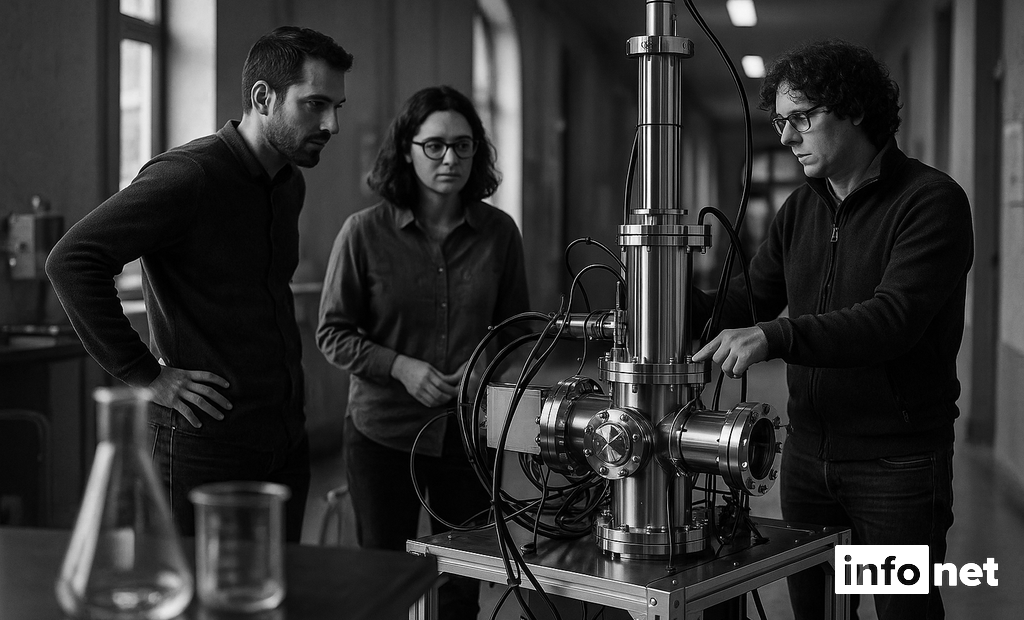
À Grenoble, l’Institut Laue-Langevin accélère: activités prolongées jusqu’en 2033 et enveloppe de 3 millions d’euros pour moderniser deux instruments clés, D11 et NeXT-MoTo. Ce double signal consolide la place de l’ILL comme infrastructure scientifique de référence, au service de la biologie, de la transition énergétique et de la médecine nucléaire, avec des retombées directes pour les acteurs économiques et industriels.
Prolongation jusqu’en 2033 : gouvernance et financement confirmés
Le renouvellement des activités de l’ILL jusqu’en 2033 valide un équilibre financier et politique éprouvé entre les pays fondateurs, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, et les autres membres partenaires. Cette décision garantit la visibilité budgétaire et opérationnelle de l’infrastructure, avec un budget annuel d’environ 100 millions d’euros, financé à près de 75 % par les trois nations fondatrices et à 20 % par dix autres pays membres. Les 5 % restants proviennent d’aides complémentaires, notamment l’investissement de 3 millions d’euros consacré à D11 et NeXT-MoTo (Le Dauphiné Libéré, juin 2025).
Ce cadrage long terme sécurise les programmations scientifiques, la maintenance lourde et la montée en gamme instrumentale. Il soutient aussi l’accueil de plusieurs centaines de chercheurs par an et l’exécution d’environ 1 200 expériences annuelles. Pour les partenaires industriels, la stabilité du financement et la continuité d’accès aux instruments de pointe sont des facteurs déterminants dans la planification des campagnes d’essais.
L’investissement récent, co-soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union européenne via le Contrat Plan État-Région, cible des priorités précises: renforcement de la biologie structurale et des solutions de caractérisation avancées pour l’énergie. Il s’inscrit dans une stratégie de modernisation progressive de l’ILL, mise en œuvre depuis plus de deux décennies.
Budget 2033 : clés de répartition
Pour mémoire, la structure de financement communiquée est la suivante :
- Environ 100 millions d’euros de budget annuel.
- 75 % financés par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
- 20 % apportés par dix autres pays membres.
- 5 % issus d’aides complémentaires, dont l’investissement de 3 millions d’euros pour D11 et NeXT-MoTo.
Le Contrat Plan État-Région est un dispositif de cofinancement qui permet d’agréger des ressources publiques et européennes autour de projets structurants. Dans le cas de l’ILL, il contribue à la modernisation instrumentale en lien avec des objectifs d’intérêt général: recherche, innovation, santé et transition énergétique.
L’histoire de l’ILL : des premiers neutrons à 2021
Fondé en 1967 par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, l’ILL est situé au cœur de la presqu’île scientifique de Grenoble. L’institut a célébré en 2021 les 50 ans de ses premiers neutrons, un jalon qui a rappelé son rôle central dans la caractérisation de la matière et la validation de modèles scientifiques. Cette longévité s’appuie sur un réacteur à haut flux et une cinquantaine d’instruments, faisant de l’ILL un haut lieu de la recherche neutronique en Europe.
D11 modernisé : cap sur la biologie structurale
Instrument emblématique de diffusion neutronique à petit angle (SANS), D11 mesure environ 80 mètres et opère depuis plus d’un demi-siècle. La modernisation récemment financée renforce sa résolution et son efficacité expérimentale pour décrypter des architectures à l’échelle nanométrique.
La méthode consiste à guider les neutrons produits par le réacteur vers l’échantillon puis à reconstituer la structure en mesurant les déviations induites. Cette approche est particulièrement adaptée à la biologie, aux membranes et aux systèmes complexes.
Selon l’équipe scientifique, ces améliorations ciblent la compréhension des interactions moléculaires dans des conditions simulant le milieu physiologique. Il devient possible de mieux caractériser des membranes cellulaires ou des nanoparticules de transport de médicaments, avec l’espoir de raccourcir certaines boucles d’itération en pharmacologie et d’éclairer des approches thérapeutiques contre des maladies neurodégénératives telles qu’Alzheimer ou Parkinson.
Cas d’usage en biologie : membranes et vecteurs thérapeutiques
L’apport de D11 tient à sa capacité à sonder des structures souples et multi-échelles, souvent inaccessibles à d’autres techniques. En biologie, cela favorise la compréhension des mécanismes d’assemblage, des canaux membranaires et de l’encapsulation de principes actifs au sein de particules. Pour des industriels ou biotechs, le bénéfice réside dans des cycles d’optimisation plus rapides pour les formulations, tout en limitant l’échantillonage destructif grâce au caractère non invasif de la neutronique.
La SANS permet de mesurer des variations d’intensité à très petit angle, révélant la distribution spatiale de la matière à l’échelle nanométrique. Cette signature structurelle est essentielle pour décrire des objets comme les micelles, les liposomes, les protéines ou les agrégats polymériques, qui présentent des contrastes de densité et des architectures complexes.
Point biologie : un instrument pour des environnements réalistes
Le renforcement de D11 cible des expériences en conditions proches du corps humain. L’objectif est d’augmenter la pertinence des données pour des applications biomédicales, de la caractérisation des membranes à l’étude de vecteurs de médicaments. Les neutrons, sensibles à l’hydrogène et à ses isotopes, offrent des contrastes uniques par rapport à d’autres rayonnements.
NeXT-MoTo : imagerie couplée neutrons-rayons X pour l’énergie
Le second volet de la modernisation concerne NeXT-MoTo, un instrument d’imagerie neutronique. Sa mise à niveau introduit des modes d’imagerie avancés pour suivre en temps réel le comportement de dispositifs énergétiques, comme des batteries ou des systèmes de stockage. L’ajout de capacités en imagerie par rayons X permet un couplage inédit: obtenir simultanément des informations complémentaires sur la structure interne d’un même échantillon.
Ce couplage est précieux pour traquer des éléments légers, notamment l’hydrogène et le lithium, au cœur des enjeux de l’électrochimie et de l’hydrogène énergie. Les neutrons, grâce à leur sensibilité au lithium, offrent une lecture fine de la distribution et de la migration de ce dernier, utile pour l’optimisation des matériaux d’électrodes et la compréhension du vieillissement des cellules. Pour le tissu industriel, l’accès à ces données amène des leviers de productivité par l’amélioration des processus et la réduction des défauts.
Batteries : attentes des industriels et bénéfices attendus
Les collaborations industrielles autour de NeXT-MoTo visent principalement à accélérer l’industrialisation de nouvelles générations de cellules. Les objectifs typiques incluent la détection de mécanismes de dégradation, l’identification d’hétérogénéités de remplissage, ou encore la mesure d’effets d’interface entre électrolytes et électrodes. À la clé: des gains de rendement et une fiabilité accrue sur la durée de vie des produits.
Les rayons X renseignent efficacement sur les éléments lourds et sur la densité électronique. Les neutrons sont, eux, sensibles à des éléments légers et peuvent traverser des matériaux métalliques robustes. L’imagerie multimodale croise ces contrastes, offrant une cartographie conjointe de phénomènes mécaniques, chimiques et morphologiques au sein d’un même dispositif.
Hydrogène et lithium : pourquoi les neutrons font la différence
- Hydrogène : signature neutronique élevée, utile pour analyser l’absorption ou la diffusion dans des matériaux.
- Lithium : suivi possible de la répartition et de l’accumulation, critique pour prévenir les dendrites dans les batteries.
- Couplage X : corrélation entre structures denses et éléments légers, avec un même montage expérimental.
Modèle d’accès aux instruments : innovation ouverte et retombées économiques
Chaque année, l’ILL met ses instruments à disposition pour environ 1 200 expériences, gratuitement pour les projets dont les résultats sont publiés. Seule une fraction comprise entre 1 % et 2 % des utilisateurs, des industriels souhaitant conserver la confidentialité de leurs données, finance l’accès. Ce modèle, décrit par la direction scientifique, favorise l’innovation ouverte et le partage des connaissances tout en offrant un cadre pour des projets privés lorsque la discrétion est requise.
Sur le plan économique, cette articulation entre accès libre et accès payant crée un double canal de transfert pour les entreprises: des publications accessibles qui irriguent des filières entières, et des sessions dédiées pour résoudre des verrous techniques propres à un produit ou à une ligne de production. En retour, l’infrastructure valorise ses compétences, consolide sa base utilisateurs et attire des projets structurants.
Publication ouverte et exemptions payantes : un équilibre pragmatique
Le principe général est clair: la gratuité s’applique avec publication, le paiement avec confidentialité. Pour l’entreprise, le choix dépend de l’objectif. Recherche exploratoire et visibilité académique pour la première voie, résolution ciblée d’un problème technique pour la seconde. Ce schéma est lisible et aligné avec la vocation publique de l’ILL tout en préservant un espace de coopération industrielle.
Préparer une campagne à l’ILL suppose d’aligner en amont les objectifs mesurables, la nature des échantillons et l’acceptabilité des conditions de publication. Les modalités pratiques, du dépôt de projet jusqu’au calendrier expérimental, sont structurées pour optimiser l’occupation des lignes et l’appariement entre besoins et instruments.
Sécurité du nucléaire civil : distribution d’iode et information du public
En septembre 2024, une campagne nationale de distribution d’iode stable a été lancée par le Ministère de l’Intérieur pour les zones situées jusqu’à 10 km des sites nucléaires. Elle est financée par les exploitants et concerne des périmètres de sécurité prédéfinis. Grenoble n’est pas explicitement mentionnée dans ce dispositif, point confirmé dans les informations disponibles sur cette campagne.
France 2030 : un effet d’entraînement plutôt qu’un financement direct
Des lauréats régionaux ont été annoncés en 2023 dans le cadre de France 2030, en Nouvelle-Aquitaine et outre-mer. L’ILL n’est pas directement financé par cet appel, mais la dynamique d’innovation nationale peut bénéficier indirectement aux projets qui mobilisent la neutronique, via des coopérations avec des acteurs soutenus par ces dispositifs.
Radio-isotopes médicaux : une nouvelle corde stratégique à l’arc de l’ILL
Depuis deux ans, la production de radio-isotopes au sein du réacteur de l’ILL a pris de l’ampleur, avec la signature de contrats avec des laboratoires pharmaceutiques. L’institut annonce un objectif de doublement des capacités de production d’ici deux ans. Ces isotopes alimentent des thérapies ciblées en oncologie et des examens de médecine nucléaire, avec un intérêt clinique croissant pour des approches plus efficaces et mieux tolérées.
Pour l’écosystème industriel, cette montée en charge représente un levier de sécurisation des approvisionnements et un atout pour la chaîne de valeur pharmaceutique en Europe. La neutronique offre des voies de production spécifiques pour certains isotopes thérapeutiques, utiles au diagnostic comme à la thérapie, en réponse à une demande hospitalière et clinique soutenue. Les collaborations engagées s’inscrivent dans la continuité des missions de service public de l’ILL, avec un impact direct sur la santé.
Applications en oncologie : vers des traitements mieux ciblés
Les radio-isotopes utilisés en médecine nucléaire permettent d’acheminer une dose thérapeutique au plus près des cellules tumorales. Les bénéfices observés tiennent à la meilleure précision et à la réduction potentielle des effets secondaires par rapport à des traitements plus diffus. Pour la filière, la disponibilité d’isotopes fiables et traçables est un facteur clé de déploiement clinique.
La production d’isotopes au réacteur alimente des molécules radiopharmaceutiques. Ces composés, une fois associés à un vecteur biologique, peuvent cibler des récepteurs spécifiques exprimés par les cellules tumorales. L’ILL, via ses capacités de production, renforce la chaîne d’approvisionnement pour répondre à la demande médicale.
Grenoble, presqu’île scientifique et modernisation au long cours
L’ILL occupe une place de premier plan au sein de la presqu’île scientifique de Grenoble. L’institut conduit un programme de modernisation de ses instruments lancé au début des années 2000, achevé en 2014. Cette stratégie a été accompagnée d’initiatives d’ouverture, notamment des journées portes ouvertes en 2009 afin de mieux faire connaître les techniques neutroniques et leur apport dans l’industrie et la recherche.
Le positionnement géographique et la densité de l’écosystème local, conjugués au maintien d’un réacteur à haut flux, offrent aux entreprises une plateforme d’essais unique en Europe. Les investissements récents sur D11 et NeXT-MoTo prolongent cet effort, avec un accent renforcé sur la biologie et la transition énergétique. Le résultat attendu: une attractivité renforcée pour des équipes R&D et des centres de décision industriels qui cherchent des capacités de caractérisation spécialisées.
Programme 2000-2014 : cap fixé, visibilité consolidée
Le plan de modernisation initié au tournant des années 2000 s’est attaché à rehausser les performances des lignes expérimentales, à améliorer les capacités d’accueil et à élargir le spectre thématique des expériences. La dimension pédagogique et la visibilité auprès du grand public ont également été travaillées, en cohérence avec le rôle de service public de l’infrastructure.
Un flux neutronique intense réduit les temps de mesure et permet d’explorer des phénomènes faibles ou rapides. À l’usage, cela ouvre des protocoles jusqu’ici inaccessibles, ou augmente le rendement des campagnes expérimentales. Pour l’utilisateur final, c’est un gain en qualité de données et en efficience globale de la recherche.
Rôle international de l’ILL
L’ILL associe des équipes et des financements de plusieurs pays européens. Sa communauté d’utilisateurs rassemble des chercheurs issus de la physique, de la chimie et des sciences des matériaux, et accueille plus de 500 scientifiques par an. Cette variété de disciplines alimente des projets transverses, de l’énergie à la santé.
Cap 2033 : priorités affichées et effets attendus
La consolidation de l’horizon 2033 et l’investissement de 3 millions d’euros sur D11 et NeXT-MoTo confirment la trajectoire de l’ILL: biologie structurale de précision, imagerie couplée pour l’énergie, montée en puissance des radio-isotopes médicaux. Avec environ 1 200 expériences par an et un financement public solide, l’infrastructure se positionne comme un appui direct aux filières industrielles européennes.
Les étapes à venir restent claires: poursuivre la modernisation, multiplier les collaborations de R&D, et sécuriser une production de radio-isotopes au service de l’oncologie. Par son impact scientifique et ses retombées économiques, l’ILL demeure un pivot de la souveraineté technologique européenne.
Au-delà de 2033, la neutronique made in Grenoble a déjà un cap: performance instrumentale, ouverture maîtrisée et utilité industrielle.