Bilan d'Ellisphere : ce qui reste après 5 ans de crise
Découvrez le bilan de la cohorte 2019 avec 80 % des entreprises liquidées en 2024 et les enseignements clés pour les dirigeants.
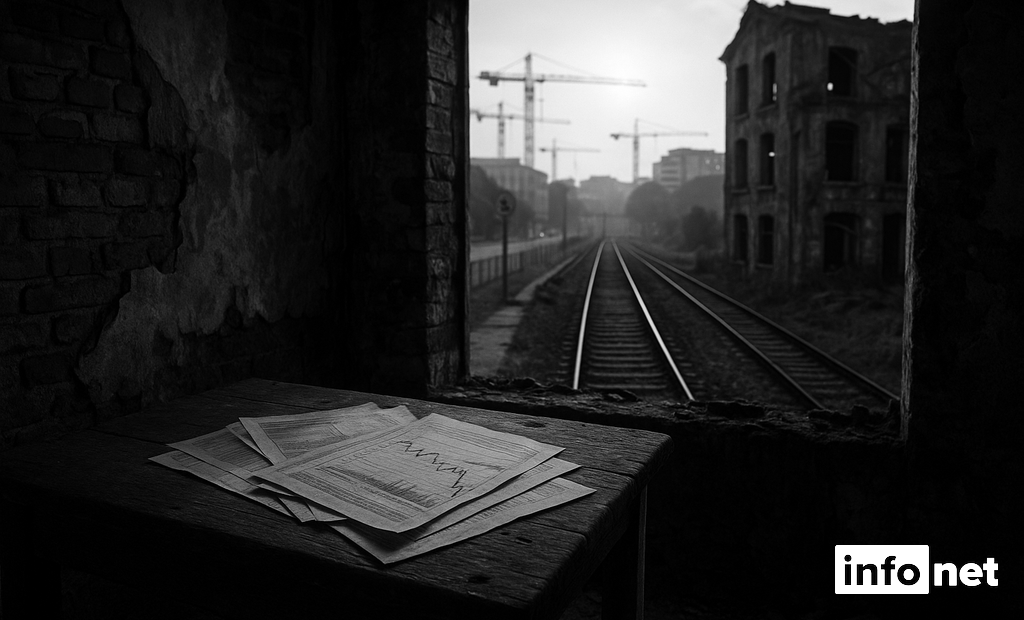
80 % en cinq ans : l’écrasante majorité des entreprises françaises placées en redressement judiciaire en 2019 n’existent plus en 2024, selon Ellisphere. Derrière ce pourcentage, des écarts nets par taille et par région. Entre TPE plus agiles et zones touristiques très exposées, l’après-COVID-19 a reconfiguré les trajectoires. Décryptage économique, financier et légal à l’attention des décideurs.
2019 au crible d’Ellisphere : cinq ans plus tard, 80 % de liquidations
Ellisphere dresse un bilan sévère de la cohorte 2019. Sur plus de 15 500 entreprises entrées en redressement judiciaire cette année-là, environ 80 % ont été liquidées à l’horizon 2024.
Les sociétés restantes se décomposent en 17 % encore en activité et 3 % en sortie progressive de marché. Cette photographie éclaire une réalité souvent occultée : la procédure de redressement ne garantit pas le rebond, même lorsque le diagnostic est posé tôt (Ellisphere, 2024).
Avant même la pandémie, l’économie française enregistrait un niveau soutenu de procédures collectives, avec environ 52 000 cas en 2019 toutes catégories confondues. Les années 2020 et 2021 ont amplifié les liquidations, avant une phase de normalisation relative en 2023-2024. La série statistique s’est donc dégradée, puis rééquilibrée, mais sans effacer les traces laissées par le choc sanitaire sur les entreprises déjà fragilisées.
Chiffres clés 2019-2024 à retenir
Les trois indicateurs qui structurent le paysage des redressements judiciaires :
- 80 % de liquidations à cinq ans pour la cohorte 2019.
- 17 % d’entreprises encore en activité en 2024.
- 3 % en phase de fermeture progressive, signe d’une sortie sans retour.
Une procédure de redressement judiciaire débouche en pratique sur l’une des trajectoires suivantes :
- Plan de redressement avec poursuite d’activité, sur fond de restructuration opérationnelle et financière.
- Plan de cession lorsque l’activité est reprise par un tiers, afin de préserver des emplois et des actifs.
- Liquidation judiciaire en cas d’absence de perspectives crédibles de continuation, avec cession des actifs.
Les statistiques 2019-2024 montrent une prévalence élevée des liquidations sur les populations déjà fragilisées avant la crise sanitaire.
Qui est Ellisphere ?
Ellisphere est un spécialiste de l’information économique sur les entreprises. Ses analyses croisent données légales, financières et sectorielles pour éclairer les trajectoires de solvabilité, la sinistralité et la dynamique de défaillances. Le travail sur la cohorte 2019 offre une lecture à cinq ans utile aux dirigeants, aux créanciers et aux investisseurs.
Sorties de crise : états de santé des survivantes
La survie ne signifie pas la consolidation. Parmi les entreprises encore présentes, Ellisphere distingue deux réalités.
Une minorité, environ 3 % de l’ensemble initial, affiche des signaux robustes : comptes assainis, croissance du chiffre d’affaires, trajectoire crédible de désendettement. À l’inverse, 14 % demeurent en zone de fragilité. Leur équilibre tient souvent à des marges étroites et à des dispositifs d’appui public ou de refinancement.
Ce partage illustre la nature cumulative des chocs. Les sociétés déjà sous contrainte en 2019 ont encaissé la crise sanitaire, puis un cycle de tensions sur les coûts et les approvisionnements.
Les aides publiques ont permis des stabilisations, sans résoudre des fragilités structurelles. Les analyses relayées par le Ministère de l’Économie rappellent par ailleurs que la réussite d’un plan de redressement suppose une réorganisation interne alignée à un environnement macroéconomique porteur. Le plan de relance de 100 milliards d’euros, décidé en 2020, a compté parmi les soutiens décisifs pour certaines de ces trajectoires.
Les indicateurs clés consultés par les financeurs et les juridictions pour apprécier la sortie de crise :
- Capacité d’autofinancement positive et récurrente.
- Evolution du chiffre d’affaires sur 4 à 8 trimestres, plutôt que sur une seule année.
- Qualité du besoin en fonds de roulement : délais clients, rotation des stocks, lignes court terme.
- Charge de la dette rééchelonnée soutenable au regard des cash-flows opérationnels.
Un signal de reprise isolé ne suffit pas : c’est la cohérence d’ensemble qui fonde le retour à la solvabilité.
Taille et chiffre d’affaires : avantage compétitif des micro-entreprises
Ellisphere place la taille au cœur du différentiel de survie. Les micro-entreprises, ici entendues comme réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, dominent le maintien en activité parmi les survivantes : 82 % des entreprises encore en vie en 2024 appartiennent à cette catégorie. En clair, l’agilité organisationnelle et des coûts fixes limités ont favorisé les structures les plus légères.
Du côté des entreprises plus importantes, l’équation s’est révélée plus complexe : dettes accumulées, chaînes d’approvisionnement perturbées, ralentissement sectoriel. Le poids des engagements et la rigidité des structures ont fortement réduit l’option redressement. Dans l’appareil productif français, les TPE représentent environ 95 % des entités, et leur taux de survie post-défaillance sur cinq ans ressort au-dessus de celui des PME, à environ 25 % pour les cas comparables selon des données d’ensemble mentionnées pour 2023.
Lecture des pourcentages : base et périmètre
Pour éviter les confusions de périmètre :
- Les 80 %, 17 % et 3 % s’appliquent à la population des entreprises entrées en redressement en 2019 suivies jusqu’en 2024.
- Les 82 % se rapportent à la part de micro-entreprises parmi les survivantes, et non à l’ensemble de la cohorte 2019.
- Les ordres de grandeur TPE et survie à cinq ans décrivent des tendances moyennes issues de données d’ensemble 2023.
Géographie des restructurations : écarts régionaux tranchés
Au prisme régional, l’étude signale des trajectoires hétérogènes. Les variations s’alignent sur la diversification économique locale, l’exposition aux chocs sectoriels et la structure des tissus productifs. Après 2020, le nombre de redressements judiciaires a augmenté de 15 % en moyenne nationale, avec des surcharges plus marquées dans les territoires à forte dépendance touristique.
Nouvelle-Aquitaine : ressort local et vigilance conjoncturelle
La Nouvelle-Aquitaine affiche un taux de survie de 21 % pour la cohorte 2019, au-dessus de la moyenne nationale de 17 %. La région ne pesait pourtant que 10 % des redressements en 2019.
Ce différentiel s’explique par un ancrage d’économie de proximité et par des filières solides, notamment l’agroalimentaire et la fabrication de matériels de transport. Les jalons économiques récents confirment le socle de la région : un PIB d’environ 177 milliards d’euros en 2018 puis autour de 190 milliards en 2022, avec une croissance de 2,5 % cette année-là.
Un bémol toutefois : une étude parue en septembre 2025 signale un repli d’activité, un moral des chefs d’entreprise en retrait et l’absence de signes de relance immédiate. Les sociétés encore fragiles pourraient voir leur risque de défaut s’accentuer à moyen terme si la conjoncture ne se raffermit pas.
Nouvelle-Aquitaine en bref
- 21 % de survivantes à cinq ans pour la cohorte 2019.
- Poids des filières agroalimentaires et de la fabrication de matériels de transport.
- PIB ~190 milliards d’euros en 2022, après 177 milliards en 2018.
- Signal conjoncturel défavorable à l’automne 2025, vigilance requise.
Provence-Alpes-Côte d’Azur : la dépendance au tourisme pèse sur les plans
À l’inverse, PACA présente le taux de survie le plus bas observé dans l’étude, à 14 %. La région est très exposée au tourisme, qui représente 13 % du PIB régional.
En 2020, les restrictions sanitaires ont fait chuter l’activité : le PIB régional estimé à 170 milliards d’euros en 2019 a reculé de 8 % en 2020. Le secteur touristique aurait perdu plus de 50 % de son activité sur 2020-2021. En 2024, un rebond partiel apparaît avec un PIB estimé autour de 180 milliards d’euros, mais une frange d’entreprises demeure vulnérable.
Auvergne-Rhône-Alpes : diversification sectorielle et moyenne nationale
La région Auvergne-Rhône-Alpes se cale sur la moyenne nationale avec 17 % de survie à cinq ans. L’INSEE mentionne un PIB de 270 milliards d’euros en 2022, au premier rang des régions, reflet d’une diversification industrielle qui amortit les chocs. Les chaînes de valeur en santé, chimie, machines et mobilité créent des amortisseurs, réduisant la probabilité de liquidation lorsque des relais de marché existent encore.
Tourisme et COVID-19 : chaîne de chocs sur les entreprises
La crise sanitaire a été un multiplicateur de risques. L’INSEE a rappelé en 2020 combien la statistique publique devait suivre en temps réel l’onde de choc.
En PACA, plus de 140 000 emplois dépendent du tourisme ; le chiffre d’affaires a plongé de 60 % en 2020 selon des estimations gouvernementales. À l’échelle nationale, les défaillances ont augmenté d’environ 30 % dans les secteurs sensibles entre 2019 et 2022. Le fonds de solidarité a déployé plus de 35 milliards d’euros, permettant des sauvetages, mais pas dans tous les cas.
Les entreprises déjà en redressement avant 2020 ont encaissé un surcroît de risque, avec un taux de liquidation accru d’environ 10 % dans les régions touristiques. L’empilement des chocs a comprimé les marges de manœuvre : baisse de fréquentation, volatilité des coûts et contraintes financières. Les plans de cession ont parfois préservé des savoir-faire, mais la demande n’a pas toujours été au rendez-vous pour soutenir des reprises crédibles.
Les dispositifs ont visé la trésorerie et la solvabilité :
- Fonds de solidarité pour compenser des pertes de chiffre d’affaires ciblées.
- Reports et étalements de charges fiscales et sociales.
- Financements garantis et solutions de refinancement pour lisser le mur de dettes.
Leur efficacité dépend du point de départ. Les entreprises déjà sous plan de redressement ont bénéficié d’un répit, mais l’épaisseur de la demande et la recomposition sectorielle ont conditionné la réussite à moyen terme.
Procédures et outils publics : quelles marges de manœuvre
La boîte à outils s’est enrichie, mais sans effacer l’effet taille et l’exposition sectorielle. La loi PACTE de 2019 a cherché à favoriser les transformations et à fluidifier certains parcours de restructuration.
Son incidence demeure néanmoins limitée face aux crises exceptionnelles, comme l’a illustré la pandémie. Sur le terrain, les résultats dépendent d’abord d’un business model recalibré, d’une gouvernance resserrée et d’une exécution rapide des plans.
Pour les entreprises encore fragiles en 2024, trois leviers se détachent :
- Arbitrages de portefeuille pour concentrer les ressources sur les métiers cœur, avec un pilotage serré des coûts fixes.
- Renégociation de la dette synchronisée avec un plan d’actions commercial et industriel crédible.
- Sécurisation de la trésorerie via des circuits court terme, des clauses d’ajustement et des relais publics lorsque disponibles.
La loi PACTE : un levier, pas un bouclier
Les mesures facilitant les restructurations n’ont pas vocation à se substituer aux ressorts de marché. Elles constituent un cadre plus lisible pour passer d’un traitement juridique à une relance opérationnelle. L’issue dépend in fine de la capacité à restaurer la profitabilité et à réaligner les flux de trésorerie, dans un environnement dont l’orientation macroéconomique reste un facteur déterminant (INSEE).
Les partenaires financiers concentrent leur analyse sur :
- La visibilité du carnet de commandes et la qualité de la clientèle.
- La soutenabilité des projections de marge et de cash-flow après restructuration.
- Les engagements de gouvernance et de discipline financière du dirigeant.
- Les sûretés et covenants capables d’encadrer le risque de rechute.
Un plan crédible marie trajectoire commerciale, productivité et stabilité financière, sans promesses non documentées.
Décideurs et dirigeants : cap sur la résilience mesurée
Le constat d’Ellisphere est clair : la sortie de redressement reste un chemin étroit, particulièrement pour les structures très exposées aux cycles sectoriels. La Nouvelle-Aquitaine montre qu’un tissu diversifié améliore les chances, quand PACA rappelle la vulnérabilité d’une économie dépendante du tourisme. Les chiffres de l’INSEE corroborent des impacts durables et des rythmes de normalisation lents.
La période 2024-2025 exigera des arbitrages lucides : consolider les activités résilientes, calibrer la dette au plus près des flux réels, et mobiliser les soutiens publics à bon escient. Plus que jamais, l’exécution fait la différence entre maintien d’activité et liquidation.
L’épreuve du réel s’inscrit désormais dans la durée : seules les trajectoires solidement documentées résisteront aux prochains chocs.