Les créations d'entreprises subissent une inflexion en septembre 2025
En septembre 2025, les immatriculations d'entreprises chutent de 2,7%, impactant particulièrement les micro-entrepreneurs.
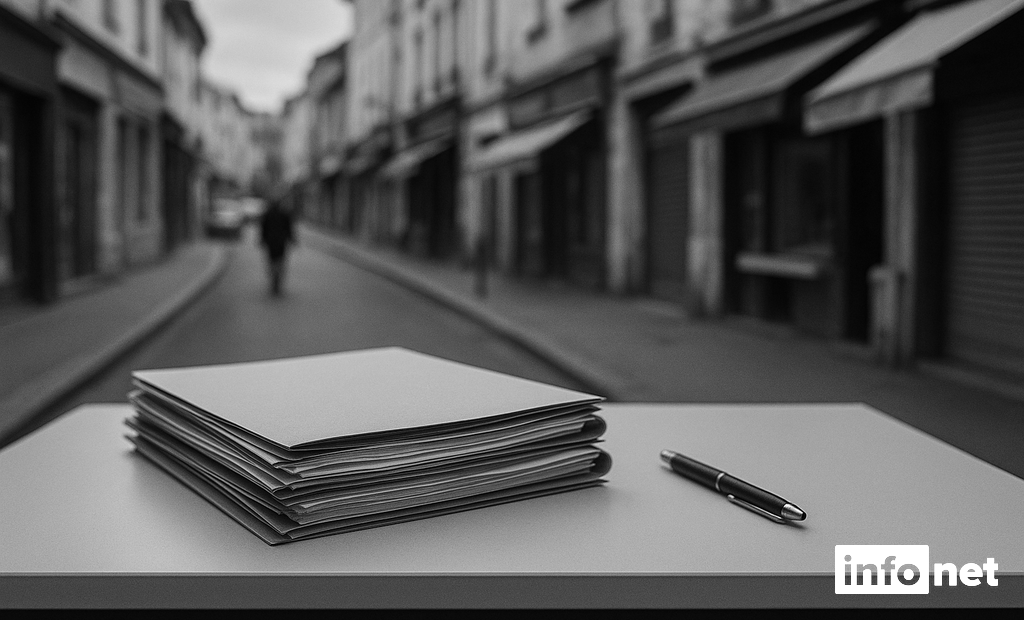
+2,7 % en août, puis −2,7 % en septembre 2025 : le rythme des immatriculations d’entreprises se retourne à la fin de l’été. Publiées le 17 octobre, les données de l’Insee confirment une inflexion mensuelle, sans remettre en cause la progression annuelle. D’un type d’entreprise à l’autre, la photographie est contrastée, tout comme la contribution des secteurs.
Performance opérationnelle en léger recul
Corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables, le volume total de créations recule de 2,7 % en septembre 2025, après un mois d’août en hausse de 2,7 %. Cette alternance, fréquente sur les séries mensuelles, rappelle l’importance d’une lecture conjoncturelle et non événementielle des immatriculations.
La séquence s’inscrit dans un environnement économique moins porteur. Les coûts se normalisent lentement, l’accès à certains intrants reste tendu, et l’inflation rogne les marges de lancement. Les créations demeurent toutefois dynamiques sur douze mois, ce qui dilue l’onde de choc d’un mois de septembre plus faible que prévu (Insee, 17 octobre 2025).
Lecture rapide des chiffres clés
En rythme CVS-CJO, septembre 2025 recule de 2,7 % après +2,7 % en août. À un an, la tendance reste positive : +2,7 % par rapport à septembre 2024. Sur janvier-septembre 2025, le cumul atteint environ 750 000 créations contre environ 730 000 sur la même période en 2024 (Insee, 17 octobre 2025).
Micro-entrepreneurs, sociétés et entreprises individuelles : trajectoires divergentes
Le mois de septembre ne touche pas les statuts avec la même intensité. Les écarts de sensibilité à l’environnement de coûts et à la demande finale ressortent nettement.
Micro-entrepreneurs : coup de frein marqué
Après une progression de +3,8 % en août, les immatriculations des micro-entrepreneurs se contractent de −3,9 % en septembre. Ce segment, qui pèse une part majeure des créations, absorbe de plein fouet le ralentissement. La hausse des charges incompressibles au démarrage, l’augmentation des dépenses de transport ou d’énergie et la prudence des ménages pèsent sur les activités de services et de commerce opérées sous ce régime.
Sociétés : baisse contenue
Les créations de sociétés s’effritent de 1,3 %. Cette correction limitée reflète des arbitrages d’investissement plus sélectifs. La mise en société, souvent mobilisée pour des projets capitalistiques ou structurés, semble bénéficier d’un filtrage stratégique en amont et de dispositifs d’accompagnement à l’innovation dans l’industrie, qui amortissent le choc conjoncturel.
Entreprises individuelles classiques : hausse résistante
À contre-courant, les entreprises individuelles hors micro-entreprise progressent de 2,5 %. Cette résilience suggère des repositionnements vers des métiers plus établis, avec des modèles économiques éprouvés, et une clientèle moins dépendante de la consommation discrétionnaire.
Le régime du micro-entrepreneur simplifie les démarches fiscales et sociales. Il convient aux activités à chiffre d’affaires limité et réduit les coûts initiaux de conformité. En contrepartie, il plafonne la déductibilité des charges. En période inflationniste, l’impossibilité d’amortir certains investissements peut réduire l’attractivité du statut pour des projets à fortes dépenses de départ.
Secteurs en repli et poches de résistance
Le mois de septembre accentue les écarts sectoriels. Plusieurs activités sensibles au pouvoir d’achat et aux coûts logistiques s’essoufflent, tandis que des besoins structurels soutiennent d’autres domaines.
Commerce et services aux ménages : demande sous pression
Les créations reculent dans le commerce et les services aux ménages. L’érosion du budget des foyers sur les dépenses non essentielles et la concurrence accrue en ligne imposent des modèles de plus en plus différenciés. Les nouveaux entrants arbitrent davantage les localisations, les loyers commerciaux et la profondeur de l’offre de services.
Transports et entreposage : renchérissement opérationnel
Les activités de transport et d’entreposage pâtissent des coûts énergétiques et de l’optimisation tendue des chaînes logistiques. Les marges de démarrage sont plus étroites et la densité concurrentielle renforce les exigences en capital, flotte et technologie, ce qui réduit le flux d’immatriculations.
Enseignement, santé et action sociale : besoins structurels
À l’inverse, l’enseignement, la santé et l’action sociale continuent d’attirer des créateurs. L’accroissement des besoins en services, la demande locale et la capillarité de ces métiers soutiennent l’appétit entrepreneurial. Ces activités apparaissent moins cycliques, avec des débouchés stables, souvent indexés sur des besoins essentiels.
Industrie : impulsion innovation et soutien public
L’industrie progresse encore. Les créations s’appuient sur des investissements en innovation et des dispositifs d’appui public. Les niches à forte valeur ajoutée, la relocalisation de certaines chaînes et l’adoption d’outils numériques améliorent la viabilité des projets. Les porteurs anticipent des gains de productivité et un positionnement différenciant sur des marchés B2B.
Une variation mensuelle CVS-CJO mesure le changement net après correction des effets saisonniers et calendaires. Elle permet d’isoler une tendance sous-jacente dans chaque secteur, sans confondre le signal conjoncturel et des pics récurrents comme la rentrée, les fêtes ou les jours ouvrés supplémentaires.
Lecture annuelle et cumul 2025 : dynamique encore positive
Sur douze mois glissants, la France enregistre +2,7 % de créations par rapport à septembre 2024. Le flux reste donc ascendant, malgré l’inflexion récente. Le cumul janvier-septembre 2025 avoisine 750 000 immatriculations, contre environ 730 000 sur la même période en 2024, ce qui confirme une hausse modérée mais réelle.
Ce contraste est classique en phase de normalisation : un léger tassement mensuel peut cohabiter avec une pente annuelle positive si les trimestres précédents ont été dynamiques. La reprise post-pandémie s’est diffusée de manière hétérogène selon les filières, et la lecture sectorielle reste déterminante pour anticiper la fin d’année.
Commerce de gros et dynamique 2025 : retombées différées
Les rapports publics indiquent un ralentissement du commerce de gros en 2024. Les créations 2025 reflètent en partie ce décalage macro-sectoriel, notamment pour les activités dont la rentabilité dépend de volumes et d’effets d’échelle. Les nouveaux entrants privilégient des segments spécialisés, avec un besoin de fonds de roulement mieux calibré.
Bon à savoir sur l’effet de base annuel
Une hausse annuelle peut coexister avec un recul mensuel si les mois antérieurs ont été solides. Le cumul 2025 intègre des périodes plus porteuses que septembre, ce qui explique la progression d’ensemble en glissement annuel malgré la baisse de fin d’été.
Coûts, inflation et énergie : les paramètres qui pèsent sur la décision d’entreprendre
La baisse de septembre s’explique par un contexte économique légèrement ralenti qui complique les arbitrages au démarrage. Les coûts énergétiques affectent directement le fret, l’entreposage et les activités à forte intensité d’usage du carburant ou de l’électricité. Dans les services aux ménages, la demande compressée par l’inflation limite la capacité à répercuter les hausses de coûts.
Les analyses publiées le 17 octobre soulignent un repli touchant la plupart des secteurs, à l’exception de la santé ou de l’enseignement, qui bénéficient d’une demande structurelle. Cette configuration explique les trajectoires divergentes entre micro-entrepreneurs et sociétés, mais aussi la résistance des entreprises individuelles classiques.
Durabilité des modèles économiques
Pour les créateurs, la discipline de coût d’acquisition client, les conditions d’approvisionnement et la stabilité des marges deviennent critiques. Dans le transport ou le commerce de détail, quelques points de coût supplémentaires à l’entrée peuvent décourager ou décaler l’immatriculation. À l’inverse, l’éducation, la santé et l’action sociale profitent d’un socle de besoins moins élastique au cycle.
Un recul d’un mois n’épuise pas la tendance. Le diagnostic robuste repose sur la répétition de signaux concordants sur plusieurs périodes, le croisement avec les indicateurs de prix, d’investissement et de confiance, et l’analyse microéconomique par filière. À ce stade, le cumul 2025 reste en hausse, ce qui argue pour un bruit conjoncturel plutôt qu’une rupture.
Impacts chiffrés sur l’emploi et la chaîne de valeur
L’évolution des créations conditionne l’emploi non salarié et la profondeur de certaines chaînes de sous-traitance. Dans la logistique, par exemple, un ralentissement des immatriculations fragilise l’écosystème des micro-fournisseurs de services, du dernier kilomètre aux prestataires spécialisés. À l’opposé, la dynamique de l’industrie nourrit des besoins en compétences techniques et en fonctions support.
Les sociétés nouvellement créées, bien qu’en baisse modérée, participent aux projets d’investissement de moyen terme. Elles mobilisent des leviers de financement et des dispositifs d’innovation qui irriguent la chaîne de valeur en amont et en aval. L’orientation sectorielle des créations en 2025 pourrait donc infléchir la géographie des emplois émergents à court terme.
Capacité d’absorption des hausses de coûts
Les segments en recul sont souvent ceux où le pricing power est limité. À l’inverse, les activités qui capturent une valeur technique ou sanitaire disposent d’une meilleure capacité à absorber l’augmentation des charges. Cet écart de pouvoir de fixation des prix explique en partie le différentiel d’appétit entrepreneurial observé entre secteurs.
Indicateurs à surveiller d’ici fin 2025
- Évolution mensuelle CVS-CJO des créations : confirmer ou infirmer le creux de septembre.
- Inflation et énergie : trajectoire des coûts d’exploitation, surtout transport et entreposage.
- Flux sectoriels : persistance des gains dans l’enseignement, la santé et l’industrie.
Cap d’investissement pour les porteurs de projet : où se positionner en 2025
Sans prétendre à une recette unique, plusieurs lignes de force se dégagent. D’abord, la stabilité relative de l’enseignement, la santé et l’action sociale ouvre des perspectives à l’abri des soubresauts cycliques. Ensuite, l’industrie, soutenue par l’innovation et des appuis publics ciblés, demeure un terrain propice aux projets différenciants à contenu technologique.
Pour les projets exposés aux hausses de coûts logistiques, des arbitrages s’imposent : volume minimal viable, localisation optimisée, partenariats d’achats, et digitalisation des processus. Les sociétés qui structurent plus tôt leurs investissements amortissent mieux les chocs de prix, à condition d’une gestion serrée du besoin en fonds de roulement.
Priorités d’exécution pour lancer au bon moment
- Timing : éviter les pics de coûts et privilégier un calendrier de lancement mieux aligné sur les ventes.
- Design de l’offre : cibler les segments avec demande récurrente et valeur perçue élevée.
- Structure juridique : choisir un cadre aligné sur l’intensité capitalistique et la fiscalité envisagée.
- Partenariats : sécuriser la chaîne d’approvisionnement et mutualiser les coûts critiques.
Les projets industriels, souvent adossés à l’innovation et à des marchés B2B, subissent moins la pression de la consommation courante. L’accès à des dispositifs d’appui et la possibilité de différenciation technique renforcent la viabilité. Le ticket d’entrée est plus élevé, mais la barrière à l’entrée protège davantage la rentabilité.
Cadre public et signaux de marché : ce que disent les chiffres
Les données mensuelles confirment un ajustement, tandis que les agrégats annuels restent orientés à la hausse. Les commentaires d’organismes publics précisent l’impact des coûts énergétiques sur les filières transport et logistique, quand les relais de croissance se trouvent du côté de la santé, de l’enseignement et de l’industrie. La conjugaison de ces facteurs explique la composition de la vague entrepreneuriale 2025.
À ce stade, l’Insee anticipe la poursuite de la dynamique annuelle positive, sous réserve d’un environnement de prix moins contraint et de l’efficacité des aides à l’innovation. Les prochains mois permettront d’objectiver si l’accalmie de septembre relève d’une respiration après l’été ou d’une inflexion appelée à durer.
Septembre en baisse, mais cap annuel maintenu
Le repli de −2,7 % en septembre n’efface pas la hausse sur un an et le cumul robuste observé depuis janvier. Les créations d’entreprises s’ajustent à la conjoncture, sans rupture avec la trajectoire de fond. La clé, dans les mois qui viennent, sera la capacité des porteurs de projets à se tourner vers les secteurs les plus porteurs et à sécuriser leurs postes de coûts.
Avec des signaux toujours favorables dans la santé, l’enseignement et l’industrie, la dynamique entrepreneuriale conserve un potentiel d’expansion. La photographie de septembre rappelle toutefois une réalité : dans un cycle de prix encore élevé, la discipline opérationnelle fait la différence.
Un mois moins vif n’est pas une panne, c’est un test de solidité des modèles que les entrepreneurs s’apprêtent à déployer.