Quels impacts des états de durabilité pour les entreprises françaises ?
Découvrez les implications des états de durabilité ESRS 2025 pour les entreprises françaises et leur gouvernance.
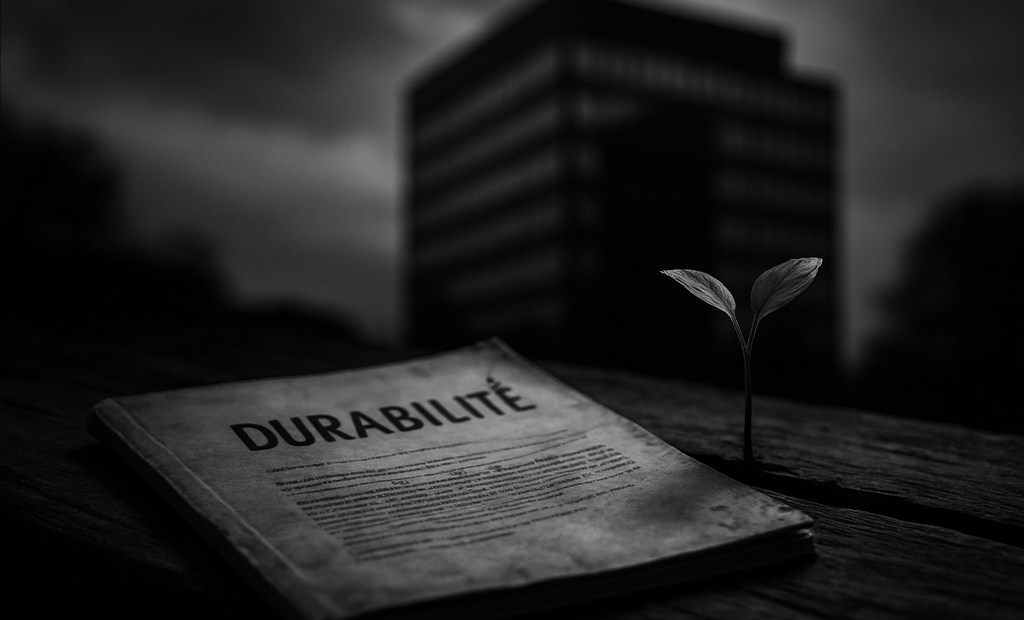
Le chantier ESRS passe à l’échelle. Les premiers états de durabilité publiés au titre de l’exercice 2024 tracent une ligne de partage nette entre pionniers et suiveurs, avec des conséquences directes pour la gouvernance, la finance et le juridique des entreprises françaises. Climat, chaîne de valeur, droits humains s’installent au cœur de la matérialité double, alors que les pratiques restent hétérogènes.
Csrd 2025 : premiers enseignements utiles aux groupes français
Les premiers états de durabilité conformes aux ESRS, collectés jusqu’au 20 avril 2025, forment un corpus de 656 rapports, majoritairement européens, dont 16 % émanent d’entreprises ayant leur siège en France (EFRAG, juillet 2025). Cette première vague mélange émetteurs cotés, banques et assureurs, ainsi qu’une majorité d’industriels.
Deux réalités se superposent. D’un côté, une montée en qualité des informations structurées par les révélations générales et les standards thématiques E, S et G. De l’autre, des écarts substantiels de granularité, de méthode et de traçabilité des données, qui conditionnent l’assurance limitée obligatoire en 2025 et préparent l’assurance raisonnable à horizon ultérieur.
Pour les groupes français, l’intérêt est double. Primo, la France étant un gisement important de rapports, les entreprises disposent d’un référentiel de place pour se comparer. Secundo, l’empilement réglementaire local, notamment loi Sapin II et devoir de vigilance, renforce la cohérence avec ESRS G1 et les volets S2 et S3, facilitant l’intégration juridique et la défense devant les investisseurs.
Ce que change l’« Omnibus » pour la préparation 2025
L’initiative de simplification adoptée par la Commission européenne a engagé un allègement ciblé des exigences, sans remettre en cause l’architecture ESRS. Pour les directions financières françaises, stabiliser les jeux de données, sécuriser la piste d’audit et documenter les jugements de matérialité demeurent les trois priorités opérationnelles.
Rapports de durabilité : volumes, formats et motifs de divergence
La longueur des rapports varie fortement. La moyenne atteint 115 pages avec une médiane à 100 pages.
Des extrêmes subsistent, entre environ 25 pages pour les plus concis et près de 440 pages pour les plus exhaustifs. Les institutions financières publient en moyenne des documents plus longs, autour de 140 pages, tirés notamment par l’exercice Taxonomie, contre environ 110 pages pour les secteurs non financiers.
Un signal géographique est net. Les préparateurs d’Europe du Sud, dont la France, tendent à livrer des rapports plus volumineux.
La culture de place et la comparaison entre pairs expliquent une partie de l’écart. Au contraire, les pays nordiques privilégient davantage la concision. Fait important pour les décideurs : la longueur n’est ni corrélée à la taille de l’émetteur ni au nombre de sujets matérialisés, ce qui déplace l’attention vers la qualité du balisage des données, la clarté des tableaux et la cohérence des renvois.
Sur la structure, la convergence se renforce. L’immense majorité aligne le sommaire sur les révélations générales ESRS, puis les chapitres environnement, social et gouvernance. Les meilleures pratiques introduisent un référencement explicite par paragraphe ESRS, utile à l’assureur et aux analystes.
La double matérialité croise matérialité d’impact et matérialité financière. Côté méthode, la plupart des préparateurs s’appuient sur la liste de sujets d’AR 16 pour structurer la cartographie. Les bonnes pratiques incluent : i) liste exhaustive des IRO par segment de chaîne de valeur, ii) traçabilité des sources et hypothèses, iii) implication d’au moins un acteur de la société civile pour nourrir la matérialité d’impact.
Matérialité : un tronc commun solide, des sujets encore délaissés
Trois standards thématiques dominent et sont jugés matériels par l’immense majorité des préparateurs : climat E1 à 98 %, effectifs propres S1 à 99 %, conduite des affaires G1 à 93 %. Viennent ensuite consommateurs S4 à 68 %, économie circulaire E5 à 65 % et travailleurs de la chaîne de valeur S2 à 63 %.
La dispersion reste marquée. Environ la moitié des entreprises matérialisent entre 4 et 6 standards. Seules 10 % couvrent les 10 standards. À l’inverse, 25 % n’en retiennent que 4 ou moins. Côté secteur, les banques et assureurs matérialisent moins souvent la circularité ou S2 que l’industrie, alors que les industriels étendent la matérialité sur des pans opérationnels et amont.
Certains sous-thèmes restent rarement retenus : microplastiques, pollution des organismes vivants et droit des peuples autochtones, ou encore des volets S3 spécifiques. Cet angle mort crée un risque de révision de matérialité à court terme, au gré des attentes ONG et des contentieux.
Les parties prenantes consultées confirment un biais business centric. 97 % impliquent leurs équipes internes, environ 70 % des clients, 65 % des fournisseurs et 60 % des investisseurs. Les ONG, syndicats et communautés locales sont moins sollicités, alors qu’ils sont clés pour l’impact-matérialité. Ce point sera regardé de près par les certificateurs.
Articulation avec l’audit et l’assurance limitée en 2025
Pour passer l’assurance, documenter le raisonnement de matérialité devient crucial. Les auditeurs testeront : i) l’exhaustivité du périmètre ESRS par rapport au modèle d’affaires, ii) la cohérence entre IRO et indicateurs publiés, iii) la traçabilité des jeux de données et le rôle de la gouvernance.
Climat : plans de transition, prix du carbone et chiffrage des risques
Un peu plus d’une entreprise sur deux annonce un plan de transition climat, mais l’alignement sur les composantes attendues n’est pas encore homogène. Environ 70 % des préparateurs déclarent des cibles court terme 1,5 °C sur les scopes 1 et 2.
60 % de ces trajectoires sont validées SBTi, les autres suivent des référentiels sectoriels. La couverture du scope 3 reste plus rare.
Sur les instruments économiques, le prix interne du carbone n’est appliqué que par environ 20 % des déclarants. Les secteurs à fortes émissions, comme mines, électricité et transport, sont les plus avancés.
L’introduction d’un signal prix interne, même prudent, accélère la réallocation de capex et la sélection fournisseurs. Les groupes français exposés à l’EU ETS tirent un avantage à harmoniser leurs prix internes avec la fourchette de marché et leurs scénarios interne de CO2.
Autre fait notable, la quantification des effets financiers des risques climatiques progresse. Les meilleures publications cartographient actifs par actifs l’exposition aux aléas physiques, estiment les pertes potentielles à horizon 2050 et priorisent des mesures d’adaptation assorties de budgets. Cette approche est directement exploitable par la direction financière et par l’assureur.
Le projet d’Implementation Guidance 4, discuté fin février 2025, détaille les composantes d’un plan de transition crédible : cibles chiffrées, leviers de décarbonation quantifiés, alignement capex/opex, gouvernance et trajectoires par scope. Sans attendre l’adoption définitive, les émetteurs gagnent à structurer leur plan selon ces éléments pour améliorer la comparabilité et la lisibilité.
- Implication pour la France : les secteurs électricité, construction, matériaux et transport peuvent capitaliser sur leurs dispositifs bas carbone existants pour renforcer le lien entre objectifs climatiques et allocation de capital.
- SBTi et investisseurs : la validation externe demeure un signal fort dans la relation avec investisseurs et prêteurs, notamment dans les négociations liées aux KPIs de durabilité des financements.
- Stress tests : les banques françaises devront articuler leurs analyses NGFS avec les divulgations ESRS, ce qui plaide pour une taxonomie des risques commune entre conformité et finance.
Biodiversité et chaîne de valeur : des métriques encore fragmentées, mais stratégiques
Environ 30 % des entreprises publient des indicateurs biodiversité, avec une intensité supérieure dans l’énergie, la construction et l’immobilier. Les métriques demeurent souvent spécifiques à l’entité : surfaces restaurées, sites dotés de plans de gestion, espèces sensibles recensées, ou, côté financier, exclusions, engagements actionnarials et expositions à des zones sensibles.
Le lien entre indicateurs et cibles s’affermit. Quelques émetteurs publient des trajectoires quantifiées, avec définitions et méthodes de calcul explicites. Cette transparence renforce la crédibilité des objectifs et facilite l’assurance.
Sur le social, deux enseignements dominent. D’abord, 93 % des émetteurs déclarent verser des salaires adéquats dans l’EEE, sans toujours distinguer Europe et hors Europe.
Ensuite, les signalements d’incidents graves en droits humains restent faibles dans les divulgations S1 et S2, la plupart indiquant l’absence d’incident. Les cas de discrimination sont rapportés plus fréquemment, avec une forte hétérogénéité des volumes.
La chaîne de valeur est mieux couverte, via des politiques de devoir de diligence, des codes fournisseurs et des canaux de grief. Les dispositifs les plus robustes articulent cartographie des pays à risque, intégration contractuelle et audits ciblés. Pour les groupes français déjà soumis au devoir de vigilance, les ESRS offrent un cadre pour démontrer l’effectivité des actions.
La loi française sur le devoir de vigilance impose une cartographie des risques, des mesures d’atténuation et un mécanisme d’alerte. ESRS S2 et S3 fournissent un langage commun pour objectiver la chaîne de valeur. Les entreprises gagnent à aligner indicateurs et processus, afin de répondre simultanément aux exigences nationales et aux attentes européennes.
Points d’attention juridiques pour les directions françaises
Sapin II renforce G1 via la lutte anticorruption et le contrôle interne, devoir de vigilance irrigue S2 et S3, et les lignes de force ESRS imposent une cohérence transversale documentation, preuves, alertes. La consolidation de la gouvernance ESG au niveau du conseil s’impose pour fiabiliser l’assurance et limiter les risques contentieux.
Gouvernance et conduite des affaires : colonne vertébrale de la confiance investisseurs
La conduite des affaires G1 est matérialisée par 93 % des entreprises. Au-delà des codes de conduite, les rapports les plus solides relient les politiques à des procédures opérationnelles, des formations obligatoires et des indicateurs d’efficacité sur l’éthique des affaires. Pour la France, cette section est un lieu naturel d’intégration de Sapin II, des canaux d’alerte et des sanctions disciplinaires.
Les investisseurs figurent dans 60 % des consultations de matérialité. Cette interaction se traduit par une demande d’indicateurs comparables, de trajectoires chiffrées et d’attestations externes. Elle pèse sur le coût du capital, en particulier pour les secteurs exposés au climat et à la biodiversité.
- Conseil d’administration : clarifier les mandats des comités sur la durabilité, intégrer les KPIs extra-financiers dans la rémunération variable et formaliser la revue annuelle des risques E et S majeurs.
- Direction financière : relier les capex, opex et R&D aux objectifs ESG, articuler les hypothèses des plans stratégiques avec les scénarios climat et documenter l’interopérabilité avec Taxonomie et SFDR.
- Fonctions juridiques et conformité : renforcer la preuve d’effectivité des politiques, l’archivage des diligences raisonnables et l’efficacité des mécanismes d’alerte.
Éviter les divergences suppose de synchroniser les périmètres, découpages sectoriels et méthodes. Bon réflexe opérationnel : bâtir un glossaire interne et un registre de correspondances entre Taxonomie, SFDR et ESRS, pour sécuriser la cohérence des chiffres d’un support à l’autre.
Ce que doivent prioriser les directions financières en 2025 et 2026
À l’issue de cette première saison, trois chantiers sont décisifs. D’abord, fiabiliser la matérialité avec une documentation robuste, des parties prenantes plus diversifiées et une articulation claire des IRO avec les indicateurs.
Ensuite, muscler le climat avec un plan de transition explicite, des cibles 1,5 °C opérationnelles et une quantification des effets financiers des risques. Enfin, industrialiser la donnée par des contrôles internes, un balisage ESRS propre et des processus d’assurance en continu.
Les groupes français disposent d’atouts juridiques et organisationnels pour accélérer, au croisement de Sapin II, du devoir de vigilance et des ESRS. L’enjeu n’est plus seulement de se conformer, mais de piloter la création de valeur à travers des décisions d’investissement, de tarification et de chaîne d’approvisionnement ancrées dans la durabilité mesurée et auditée. À ce niveau d’exigence, la qualité des hypothèses et la cohérence des chiffres feront la différence auprès des investisseurs et des autorités.