Les défaillances d'entreprises atteignent un niveau alarmant au T3 2025
Découvrez les chiffres clés des défaillances d'entreprises en France au T3 2025. Un panorama préoccupant pour TPE et PME.
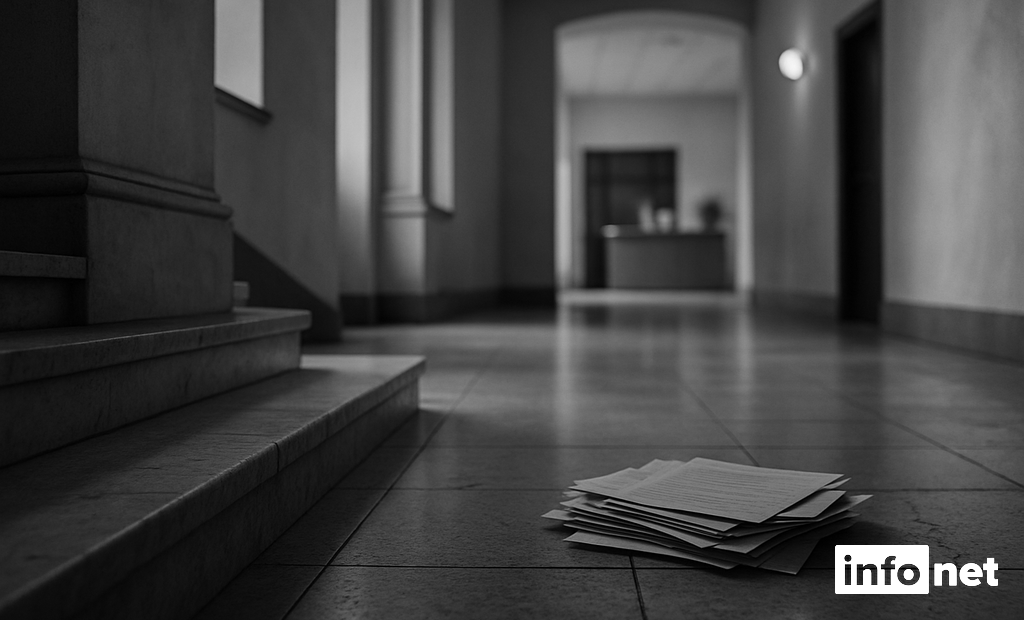
« Le mois de septembre a refroidi les espoirs d’un retournement », avertit Thierry Millon, directeur des études chez Altares. Derrière cette alerte, un constat durci au troisième trimestre 2025 : la dynamique des défaillances reste élevée, malgré un léger freinage. Les directions financières et juridiques scrutent un paysage contrasté, où l’industrie manufacturière se fragilise et où le redressement judiciaire regagne du terrain.
Défaillances au T3 2025 : record estival depuis 2009
Les juridictions commerciales ont prononcé 14 371 procédures entre juillet et septembre 2025, soit +5,2 % sur un an. Ce palier correspond au plus haut niveau estival depuis la crise de 2009, et au plus haut troisième trimestre depuis 14 ans (Altares, 13 octobre 2025). Le signal est clair : la France n’a pas refermé le cycle des tensions post-crise, même si l’ampleur de la hausse ralentit par rapport aux premiers trimestres de l’année.
La séquence est d’autant plus marquante que près de la moitié des défaillances du trimestre, soit 6 800, ont été concentrées sur le seul mois de septembre. Depuis le début de l’année 2025, 50 700 entreprises ont fait défaut, 1 600 de plus qu’à la même période en 2024. Ce cumul dépasse la moyenne annuelle d’avant-Covid et se cale sur les niveaux observés en période de récession.
Les statistiques de l’INSEE confirment la poussée sur un an glissant, avec un cumul de défaillances tous secteurs en progression, au-dessus de la moyenne pré-pandémie. En 2024, 66 000 défaillances ont été recensées par l’INSEE et la DGE, dont 32 000 pour des entreprises employant au moins un salarié, un ordre de grandeur qui a installé une nouvelle ligne de crête dans les bilans (INSEE).
Repères chiffrés à retenir pour le T3 2025
Ce qu’il faut avoir en tête pour orienter vos comités risques et vos plans de trésorerie :
- 14 371 procédures collectives de juillet à septembre 2025.
- +5,2 % de hausse annuelle au T3.
- 6 800 défauts en septembre seul.
- 50 700 défaillances depuis janvier 2025, +1 600 vs 2024 à période comparable.
- 66 000 défaillances recensées en 2024, dont 32 000 avec au moins un salarié.
À lire aussi : Budget 2026, le HCFP alerte sur la crédibilité de l’effort budgétaire.
TPE et PME sous tension : gradients par taille d’entreprise
Le choc est particulièrement net chez les structures de petite taille. Les TPE de plus de 5 salariés enregistrent une hausse de 9 % des défaillances cet été par rapport à 2024.
Les PME de 10 à 19 salariés subissent une aggravation encore plus marquée, avec +13 %. La mécanique est connue : marges compressées par les coûts fixes, tension sur le BFR, clients retardataires et coûts d’énergie encore élevés.
Ce gradient de vulnérabilité s’observe dans les contentieux fournisseurs et les incidents de paiement, puis se cristallise devant le tribunal quand les restructurations amiables échouent ou quand la dégradation est trop rapide. Le reflux du chiffre d’affaires dans certaines niches B2B, couplé à un service de la dette alourdi, accélère l’entrée en procédure.
Grandes entreprises : 46 défaillances et 10 000 emplois menacés
Le haut du marché n’est pas immunisé. Quarante-six entreprises de plus de 100 salariés ont fait défaut au troisième trimestre, menaçant 10 000 emplois selon Altares.
C’est un plus haut depuis 2014. Le choc social potentiel et le risque d’effets de second tour sur les sous-traitants imposent une vigilance accrue des préfets de région et des cellules de prévention. L’onde de choc, en particulier dans l’industrie, peut déstabiliser des chaînes d’approvisionnement locales déjà fragiles.
TPE et PME : un angle mort de la prévention quand le cycle se durcit
La remontée des coûts de l’énergie et l’érosion de la demande pèsent davantage sur les TPE et PME à faible trésorerie. La hausse des défaillances sur ces tailles témoigne d’un effet de ciseau entre coûts et volumes. Dans l’hôtellerie-restauration, la construction ou certains services aux entreprises, la capacité à répercuter les hausses tarifaires demeure partielle, ce qui grève les marges et accélère les tensions de liquidité.
Dans les publications de la DGE et de l’INSEE, une « défaillance » d’entreprise désigne l’ouverture d’une procédure collective par le tribunal : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Ce périmètre exclut les cessations d’activité sans passage en procédure collective.
Cartographie sectorielle : industrie manufacturière en tête
Le troisième trimestre consacre un net décrochage des secteurs industriels. L’industrie manufacturière enregistre la plus forte progression de défaillances avec +17 %.
Les services aux entreprises suivent avec +9 %. La construction et le commerce restent orientés à la hausse, respectivement +6 % et +7 %. Cette géographie sectorielle reflète la double peine coûts d’approvisionnement et affaiblissement de la demande, alors que l’investissement reste sélectif.
Les données sectorielles sur 2025 éclairent également l’agroalimentaire et les transports, avec des hausses de défaillances respectives de 8 % et 10 % au premier semestre. Dans le transport routier, l’indexation imparfaite des tarifs, combinée aux délais de paiement clients, expose les trésoreries. Côté agroalimentaire, l’absorption du choc matières premières n’est pas homogène, laissant émerger des fragilités sur des segments très énergivores.
Au-delà des chiffres, les transmissions de choc par les chaînes de valeur se remarquent dans les bassins industriels où un acteur pivot en difficulté entraîne ses cotraitants. Ce phénomène est visible dans les activités d’assemblage, d’emballage et de sous-traitance de précision. La consolidation intra-sectorielle pourrait s’accélérer, avec des reprises susceptibles de préserver les savoir-faire, mais pas toujours l’emploi dans son intégralité.
Lecture sectorielle : facteurs de vulnérabilité
Les moteurs identifiés derrière la hausse par secteur :
- Industrie manufacturière : coûts énergétiques, dépendances import, carnet de commandes étalé.
- Services aux entreprises : ajustement des budgets clients et pression concurrentielle.
- Construction : renchérissement des intrants, ralentissement des mises en chantier.
- Commerce : consommation sous contrainte, recomposition des circuits de distribution.
- Agroalimentaire et transports : volatilité des intrants, délais de paiement et intensité capitalistique.
Procédures collectives : redressements en hausse, liquidations en retrait
Un signal de moindre gravité apparaît dans la structure des procédures. La part des redressements judiciaires s’établit désormais à 30 % des dossiers, contre moins de 25 % en 2021 et 2022.
Leur volume progresse de 10,7 % sur un an, tandis que les liquidations judiciaires directes ne croissent plus qu’à +2,8 %. Ce rééquilibrage offre un temps de respiration aux structures viables mais fragilisées, en leur permettant d’envisager une restructuration ou une reprise d’activité.
La remarque de terrain va dans le même sens : quand la qualité du passif est encore redressable et que l’outil productif reste compétitif, le mandat ad hoc ou la conciliation peuvent préparer une entrée en procédure plus ordonnée, puis un plan de continuation. Cela ne gomme pas la sévérité du cycle, mais réduit la casse immédiate sur l’emploi et la valeur d’actifs.
Signal des praticiens : fenêtre de tir pour les reprises
Les administrateurs et mandataires judiciaires constatent une hausse des projets de cession ou de reprise ciblée lorsque la valeur commerciale des fonds de commerce subsiste. Dans ce cadre, la montée des redressements se lit comme une option additionnelle laissée aux entreprises pour recalibrer leur dette et sécuriser l’outil de production, en évitant la liquidation sèche.
Comme l’indique Thierry Millon, « Ce dernier trimestre pourrait, à défaut d’inverser la tendance, enrayer l’hémorragie et ouvrir la voie vers l’amélioration attendue pour 2026. »
Le redressement judiciaire gèle le passif antérieur et organise la poursuite de l’activité sous contrôle du tribunal, avec l’appui d’un administrateur judiciaire. Il peut déboucher sur un plan échelonnant la dette, ou sur une cession des actifs pour préserver l’activité et l’emploi. Il constitue un outil clé de sauvegarde du potentiel économique d’une entreprise viable.
Trajectoire macroéconomique jusqu’en 2026 : hypothèse de stabilisation
Plusieurs éléments de contexte éclairent la dynamique. Un rapport de la DGE publié en juin 2025 relève le rôle de chocs exogènes persistants, entre tensions géopolitiques et demande atone, pour expliquer la remontée des faillites. L’INSEE observe un léger fléchissement du rythme des défaillances au troisième trimestre, évolution cohérente avec l’idée d’une stabilisation graduelle si les conditions financières s’assouplissent.
Dans cette perspective, un rapport d’Allianz Trade anticipe la poursuite de la hausse jusqu’à la mi-2025, puis une stabilisation en 2026, soutenue par la détente des taux d’intérêt et un redressement progressif de la consommation. Cette hypothèse suppose toutefois que l’environnement international reste maîtrisable et que la transmission des baisses de taux se matérialise dans le coût du crédit aux entreprises.
Du côté des politiques publiques, un communiqué relayé par la DGE fait état de mesures de soutien en direction des TPE et PME, combinant aides fiscales et moratoires de dettes, susceptibles d’atténuer l’impact en 2026. Ces dispositifs, ciblés sur les trésoreries courtes, pourraient lisser les pics de défauts dans les secteurs les plus exposés, en particulier dans l’industrie manufacturière, toujours sous pression de la concurrence internationale.
Mesures gouvernementales : amortisseurs potentiels en 2026
Les annonces publiques évoquent des leviers centrés sur l’allègement temporaire de charges et l’étalement des dettes. Si leur calibration se confirme, elles devront cibler finement les entreprises en capacité de redressement, pour maximiser l’effet d’entraînement sur l’emploi. Un suivi trimestriel par filière serait pertinent afin d’évaluer l’impact réel sur les procédures et d’ajuster rapidement le tir.
Le cumul glissant additionne les défaillances sur les 12 derniers mois, mois par mois. C’est l’indicateur le plus robuste pour capter une tendance, car il lisse les pics saisonniers. Une inflexion à la baisse sur plusieurs mois suggère un retournement plus durable, à interpréter avec les données de trésorerie et de crédit.
Signaux faibles à suivre au T4 2025
- Part des redressements dans les procédures ouvertes, indicateur avancé de reprise d’entreprises.
- Rythme des liquidations directes et dispersion sectorielle des dossiers.
- Délais de paiement observés dans les comptes fournisseurs et clients des PME industrielles.
- Coût du crédit et accès aux lignes court terme pour les TPE exportatrices.
- Évolution des carnets de commandes dans la construction et les services aux entreprises.
Impacts chiffrés sur l’emploi en 2025 : points de rupture et zones de résilience
Le décompte d’environ 10 000 emplois menacés sur les 46 défaillances d’entreprises de plus de 100 salariés au T3 2025 illustre la sensibilité du marché du travail aux défaillances de grands acteurs. Le risque est accentué dans les territoires où l’économie locale s’articule autour d’un nombre réduit d’employeurs industriels, d’autant plus lorsque la sous-traitance est captive.
Pour autant, la progression des redressements judiciaires ouvre des voies de continuité économique via les reprises partielles ou la cession d’actifs. Les bassins d’emploi capables d’absorber rapidement les compétences, grâce à un tissu de PME dynamiques, amortissent mieux le choc. À ce titre, la coordination entre les tribunaux de commerce, les repreneurs potentiels et les dispositifs publics de formation est un facteur concret de résilience.
Les chiffres du troisième trimestre démontrent un pic saisonnier atypique en septembre, compatible avec un effet rattrapage d’affaires mises en pause pendant l’été. Si ce profil devait se répéter sur la fin d’année, les besoins en accompagnement des salariés concernés augmenteraient mécaniquement, notamment dans l’intérim industriel et la logistique, souvent premiers touchés lors des pertes de marchés.
Effet domino sur les chaînes d’approvisionnement
Le défaut d’un donneur d’ordre entraîne une raréfaction subite des commandes chez les fournisseurs de rangs 1 et 2. Les stocks, au lieu d’amortir le choc, se transforment en immobilisations coûteuses. Dans ce contexte, l’échelonnement des créances et les mécanismes assurantiels jouent un rôle crucial pour éviter la casse chez les sous-traitants les plus dépendants, typiquement les ateliers de petites séries et les prestataires de maintenance industrielle.
Lecture juridique et financière : ce que disent les dossiers
Dans la pratique, la bascule vers le tribunal résulte souvent d’un cumul de facteurs : dégradation de trésorerie, conflit de priorisation des paiements, négociations bancaires trop lentes et contraction de l’activité. L’augmentation de la part des redressements laisse penser que davantage d’entreprises entrent plus tôt en procédure, avant la rupture d’exploitation, et tentent de préserver la valeur.
À l’instruction, les tribunaux arbitrent entre poursuite d’activité et cession. La hausse mesurée des redressements et le ralentissement des liquidations directes signalent un environnement où la valeur de continuation reste identifiée dans un nombre croissant de dossiers. Les acteurs publics et parapublics conduisent, de leur côté, des actions d’appui pour préserver les savoir-faire et structurer des reprises lorsque la rentabilité post-restructuration est crédible.
Enfin, le climat décrit par Altares ne prête pas à l’euphorie. « L’économie française est plongée dans un épais brouillard », résume Thierry Millon, venant tempérer l’optimisme modéré induit par la décélération du rythme d’augmentation. La lecture conjointe des séries INSEE et des suivis Altares appelle une prudence déterminée en gestion des risques.
Vers 2026 : stabilisation possible, vigilance requise
L’hypothèse d’un reflux des défaillances en 2026, soutenue par la détente monétaire et une reprise graduelle de la consommation, ne vaut qu’à condition que les signaux observés au T3 se prolongent. Le rééquilibrage des procédures en faveur du redressement judiciaire en est un premier marqueur favorable, mais la trajectoire reste conditionnée à la capacité des entreprises à refinancer leur exploitation et à maintenir leurs marges dans un environnement de demande heurtée.
Pour le management, l’enjeu est d’orchestrer une fin d’année robuste en pilotant de près le besoin en fonds de roulement et les délais clients. L’année 2026 pourrait ouvrir la porte à une stabilisation, à condition d’une exécution rigoureuse et d’une mise en musique effective des mesures de soutien annoncées pour les TPE et PME.
Rendez-vous en 2026 pour mesurer si l’accalmie promise se traduit dans les comptes et devant les tribunaux.